Dans un article, publié sur Middle East Monitor, Jassim Al-Azzawi analyse la crise silencieuse en Egypte qui maintient « une nation en proie à des tensions économiques et institutionnelles exacerbées ». Pour le journaliste, ce silence n’est pas un signe d’approbation populaire mais plutôt « le bruit de la peur, un tic-tac avant que la pression ne déborde ».
L’Égypte est depuis longtemps une énigme pour le monde, un paradoxe déconcertant depuis plus d’une décennie. De l’extérieur, elle apparaît comme un “exemple” de stabilité dans le monde post-Printemps arabe. Mais ce calme imposé maintient une nation en proie à des tensions économiques et institutionnelles exacerbées. Dans ce pays de sable infini et d’histoire ancienne, un terrible compromis a été conclu.
Après l’espoir fugace et chaotique de la révolution, une population effrayée et épuisée a accueilli la main de fer du président Abdel Fattah el-Sissi. Le régime a consolidé son emprise sur le pouvoir et dissimulé des problèmes plus profonds : une bombe démographique à retardement, le chômage, une dette insoutenable et une corruption toxique qui ronge les fondations du pays.

La main de fer du président Abdel Fattah el-Sissi
Si vous interrogez la jeunesse égyptienne, le taux de chômage officiel de 6,1 % ne sonne pas juste. Il cache une sombre réalité. Près de deux Égyptiens sur trois au chômage appartiennent à la tranche d’âge des 15-29 ans, et les diplômés universitaires représentent un peu moins de la moitié des chômeurs, selon l’Agence centrale égyptienne pour la mobilisation publique et les statistiques (CAPMAS). C’est un paradoxe démographique : des jeunes diplômés sans domicile fixe.
Depuis 2011, le pays a opté pour de grands projets d’infrastructures de type militaire, une nouvelle capitale et de vastes autoroutes, au détriment d’investissements plus prudents. Ces projets sont principalement financés par des prêts étrangers massifs. Les emprunts extérieurs s’élèvent actuellement à plus de 260 milliards de dollars, dont plus de 52 milliards de dollars de dettes envers des organisations multilatérales, dont le FMI et la Banque mondiale.
La situation actuelle place l’Égypte dans une situation budgétaire précaire. Le ratio dette/PIB a atteint 94 % en 2016 et s’élève à 84,5 % en 2025. Tous ces emprunts ont constitué une fausse garantie tout en hypothéquant l’avenir du pays, à l’image d’un couple achetant une piscine à crédit sans financer les études de ses enfants.
L’éviction des Frères musulmans en 2013 a conduit à une « certaine » stabilité politique. Les Égyptiens, lassés de l’instabilité, ont accueilli sans opposition la main de fer du président Abdel Fattah el-Sissi. Un accueil au prix fort. Le régime a progressivement démantelé les systèmes démocratiques, réprimé l’opposition et soumis la société civile à une surveillance constante. Les arrestations arbitraires et la censure des médias sont désormais monnaie courante.

Le silence imposé est le bruit de la peur
En étouffant la dissidence et le débat, le gouvernement a créé un vide institutionnel, rendant de plus en plus difficile l’évaluation de l’humeur de la population et le traitement des griefs avant qu’ils ne dégénèrent. Le calme apparent pourrait céder sous la pression. La presse a été muselée, la dissidence est réprimée par des arrestations arbitraires et les institutions de la société civile ont été étouffées. Ce silence n’est pas un signe de consensus ; c’est le bruit de la peur, un tic-tac avant que la pression ne déborde.
L’Égypte se classe 130e sur 180 pays selon l’Indice de perception de la corruption de Transparency International, avec un maigre 30 sur 100. Il ne s’agit pas de quelques brebis galeuses, mais d’un problème systémique. Rien qu’en mars 2025, 62 cas de corruption ont été signalés, principalement au sein des administrations locales et du secteur financier. Il s’agit d’une taxe omniprésente sur l’économie, qui décourage les investissements étrangers et l’innovation, pourtant essentielle pour créer des emplois et rompre le cycle de l’endettement.
Les Égyptiens étrangers ont envoyé 23,7 milliards de dollars entre janvier et octobre 2024, soit une augmentation de 45,3 % par rapport à la même période de l’année précédente. Cet afflux est vital, mais il constitue un profond paradoxe. Malgré une profonde loyauté nationale, les expatriés hésitent encore à investir ou à se réinstaller. La corruption institutionnelle et l’inefficacité des institutions juridiques les en dissuadent.
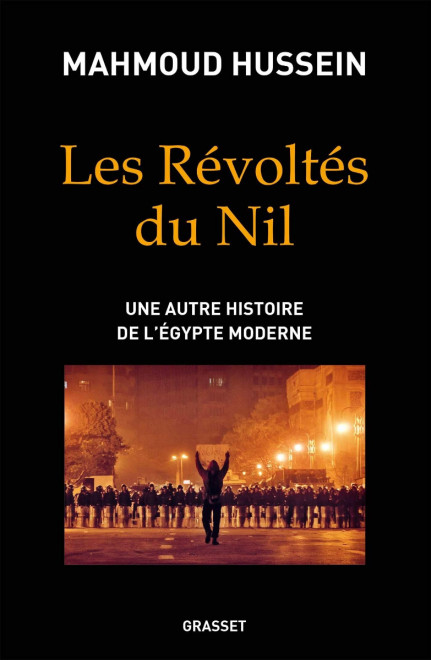
La dépendance de l’Egypte à Israël et aux USA
La faiblesse stratégique de l’Égypte va au-delà du canal de Suez. Sa stratégie énergétique constitue un renversement spectaculaire. Puissance énergétique régionale exportatrice de gaz naturel, l’Égypte importe désormais du gaz du gisement israélien Léviathan. Un renversement qui témoigne d’une profonde faiblesse stratégique. Cette dépendance complique les politiques et les stratégies, car l’approvisionnement en gaz peut être réduit en cas de tensions régionales, ce qui peut impacter l’économie et les industries égyptiennes.
Dans les années 1950 et 1960, l’Égypte de Nasser proclamait : « Aucune voix ne doit être plus forte que celle de la bataille », subordonnant la démocratie à la lutte armée contre Israël. Nasser expliquait ainsi à son peuple que les libertés démocratiques étaient un luxe inabordable ; la liberté de la presse, les droits de l’homme et de véritables élections attendraient la libération de la Palestine. Des décennies plus tard, rien ne se produisit et l’Égypte stagne toujours.
Cette paralysie sert des intérêts particuliers. Deuxième bénéficiaire de l’aide américaine et dotée d’une armée soutenue par les États-Unis, l’Égypte constitue un État client crucial qui soutient la politique régionale américaine. Si l’Égypte s’affranchissait de la corruption et instaurait une véritable démocratie, les conséquences seraient sismiques. Irakiens, Syriens, Tunisiens et citoyens d’autres pays arabes assisteraient à la transformation de l’Égypte et se demanderaient : « Pourquoi ne pourrions-nous pas faire de même ? ».

Fonder des conditions stables et démocratiques
Une Égypte démocratique et prospère déclencherait un effet domino, remettant en cause les dirigeants autoritaires de toute la région et sapant l’emprise américaine sur le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord. L’Égypte de 2025 est une réalité contradictoire : l’hégémonie politique remplace le consensus, le progrès économique est anéanti par la dette et la corruption, et les voix de la diaspora réclament espoir et retenue.
La question n’est pas de savoir si l’Égypte survivra – son histoire témoigne d’une incroyable capacité de survie. La question est de savoir si elle sera réellement capable de prospérer. La victoire ne viendra pas de mégaprojets et de la force militaire, mais de la refonte des institutions, du rétablissement de la confiance dans un contrat social rompu et d’une nouvelle image de leadership qui élève l’enthousiasme de la population plutôt que de le réprimer. La mission essentielle de l’Égypte est de créer des conditions stables, plutôt que de simplement masquer la crise qui couve.
Jasim Al-Azzawi



