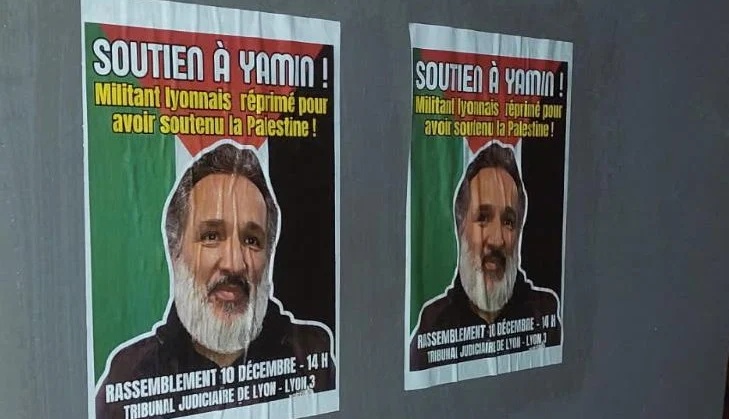Héritier de la pensée de Muhammad Iqbal, Manzoor Ahmed est l’un des grands intellectuels musulmans du sous-continent indien. Arslan Akhtar nous introduit à sa pensée dans un texte à lire sur Mizane.info.
Le texte qui suit est tiré de Manzoor Ahmed (1998), un des nombreux continuateurs du poète-philosophe Muhammad Iqbal dans le sous-continent indien. Né en 1934, Ahmed demeure peu connu en France, bien qu’il soit considéré au Pakistan comme l’un des grands penseurs islamiques contemporains.
Esprit précoce et polyvalent, il obtint des diplômes en philosophie, mathématiques et physique à Londres, avant d’enseigner ces disciplines aux États-Unis. Il est souvent présenté comme un pionnier de la philosophie islamique moderne, dont les travaux portent principalement sur la philosophie de la conscience et la philosophie du langage, dans une veine analytique anglo-saxonne qu’il a cherché à articuler avec la tradition métaphysique islamique.
Dans ces extraits, Ahmed propose une réflexion sur l’évolution du problème de l’existence dans la philosophie moderne, depuis Galilée et Descartes jusqu’à Hume et la pensée contemporaine, montrant comment la science et l’empirisme ont progressivement séparé connaissance et être, jusqu’à réduire l’homme et le monde à de simples objets de calcul.
« Prenons, par exemple, le problème de l’existence dans la philosophie moderne. Il s’agit d’un problème cosmologique, qui surgit avec la question de la nature que nous devons attribuer à cette existence dont nous faisons partie. C’est un problème cosmologique parce qu’il conduit à la discussion des possibilités de construire une conception générale du monde fondée sur les données de l’expérience. Sa valeur réelle réside dans la signification et l’ampleur de l’expérience sur laquelle elle repose ou dans la cohérence et la consistance de la construction elle-même. »
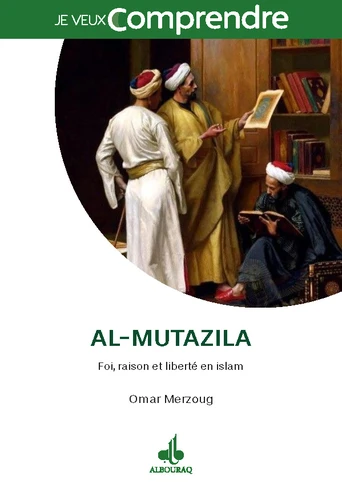
Avec l’avènement d’une nouvelle époque, lorsque Kepler, Copernic et Bruno provoquèrent une sorte de révolution et une nouvelle manière d’aborder différents problèmes, une question importante se posa. L’image du monde donnée par la perception immédiate est totalement différente de ce qu’est réellement le monde, ce qui mène à une opposition entre existence et connaissance.
La solution de Galilée consiste à dire que cette différence entre connaissance et existence disparaît dans une certaine mesure dans la forme de connaissance la plus claire que nous possédions, à savoir la connaissance mathématique. « Ici, la connaissance humaine participe de la nécessité avec laquelle Dieu pense les vérités qui sous-tendent le contenu de l’existence. »
L’impact du développement scientifique, qui a créé le problème de la subjectivité des qualités sensibles et une séparation entre connaissance et existence, s’est cristallisé sur une période de cinquante ans. On ressentit le besoin de systématiser la richesse des faits, des pensées et des nouvelles découvertes d’une part, et d’autre part, de les ramener à des notions simples. Cela fit émerger plus fortement le problème de l’existence.
Bruno l’avait déjà abordé du point de vue du nouveau schéma du monde, mais avec l’explication mécanique moderne de la nature, la pensée se trouva confrontée au problème de l’esprit et à la relation entre le physique et le mental. Parallèlement, des exigences apparurent pour que la religion soit réinterprétée à la lumière des nouvelles connaissances.
Descartes dut faire face à ce problème difficile et important. Sa formation au collège jésuite a pu l’orienter vers la sauvegarde de l’existence de Dieu, et l’impact de la Renaissance l’a obligé à rendre compte du monde causal et mécanique. Afin d’établir un équilibre entre les deux et éviter un conflit, il devait, d’une part, sauver la philosophie — et donc la religion — en trouvant un principe fondamental, une maxime, un point de départ exempt de doute, qui pourrait servir de base à des déductions ultérieures ; d’autre part, pour rendre compte de la raison scientifique et mécanique, il fut contraint de la dériver d’une maxime subjective et psychologique.
Cela est vrai pour presque tous les grands systèmes élaborés avant l’apparition de l’école empirique anglaise : tous partaient de la conviction que la clarté de la pensée suffisait à rendre compte de l’existence.
L’école empirique anglaise a inversé cet ordre, en abordant d’abord le problème de la connaissance avant celui de la métaphysique. La nature de l’existence n’était plus tenue pour acquise, mais, en procédant selon la clarté de la pensée comme norme, l’existence est désormais subordonnée à l’épistémologie.

Ainsi, la conception de la substance s’est dissoute entre les mains de George Berkeley, pour ensuite disparaître totalement avec David Hume. Avec la disparition de la substance, la « notion d’existence » s’évanouit également, car elle ne correspond à aucune impression.
Penser une chose et la penser comme existante revient au même. Ainsi, un empirisme poussé à l’extrême atteint son apogée. Récemment, certaines tentatives ont été faites pour résoudre ce problème, qui s’opposent aussi bien aux systèmes constructivistes rationalistes qu’aux approches empiriques.
Lorsque Heimann fonde l’existence sur la formule Respondo ergo sum, cela n’a de sens que dans le contexte et pour le but qu’il vise. Pour lui, le problème central de notre époque (par opposition à celui de Hume ou de Descartes) est que les activités humaines, qu’elles soient philosophiques ou artistiques, sont devenues trop techniques et ont perdu leur enracinement dans l’existence humaine.
Elles ne peuvent retrouver ce fondement par l’instrumentalisme ou la technologie, où les idées ne sont que des définitions d’opérations ou des plans d’action, plutôt qu’un flux de conscience subjective ; où la quête de certitude, qui caractérisait le début de l’époque moderne, entre dans une nouvelle phase affirmant que des valeurs sûres ne peuvent être réalisées qu’en perfectionnant les méthodes d’enquête et d’action ; où la connaissance la plus précieuse est celle des techniques permettant d’atteindre ou de restaurer les valeurs.
Ce système « irrationnel » de pensée et de vie, développé par la société industrielle occidentale et ses représentants philosophiques, a donné naissance à un mécanisme logique et naturaliste qui remet en question la liberté individuelle ; en tant que rationalisme analytique, il transforme tout, y compris l’homme lui-même, en objet de calcul et de contrôle.
Arslan Akhtar