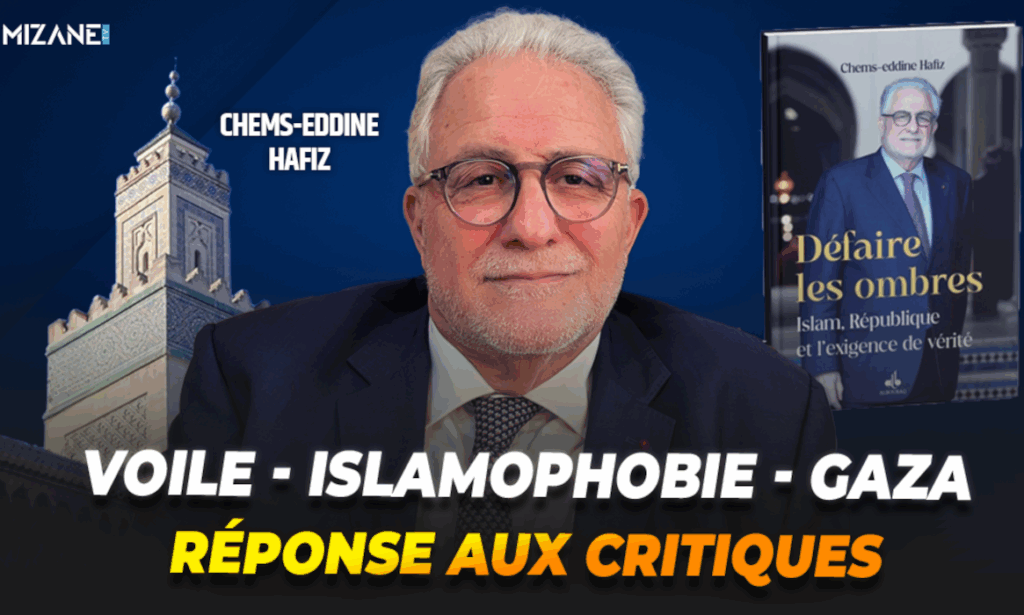Musa Mumtaz expose dans un court texte les grandes lignes théoriques des deux métaphysiciens musulmans médiévaux, Suhrawardi et Ibn ‘Arabi, sur le monisme ou non-dualisme.
Le Coran, fondement scriptural de l’islam, affirme sans équivoque le tawhid – l’unicité absolue et intransigeante de Dieu – comme principe métaphysique fondamental . Pour la compréhension humaine, il cherche également à définir Dieu à travers des degrés ou perfections suprêmes de qualités que l’on trouve de manière limitée chez les humains.
Le « non-dualisme absolu »
Cela a souvent conduit les théologiens musulmans à concevoir Dieu, entité fondamentalement non humaine, d’une manière quelque peu humaniste. Cette habitude est encore renforcée par la tendance innée des humains à attribuer des qualités humaines à des entités non humaines et à revêtir la divinité ineffable de voiles insondables, par pur désespoir. Cependant, cette idée « humanisée » de Dieu a longtemps préoccupé les théologiens et les philosophes musulmans.
Ce dilemme a donné au monisme une place dans la riche tradition philosophique de l’islam. Il faut avant tout comprendre le monisme dans son sens général, où il peut être qualifié de « non-dualisme absolu ». En général, le monisme affirme l’existence d’une réalité suprême, unique et absolue, qui sous-tend tous les autres phénomènes de l’univers. À partir de cette définition fondamentale, le monisme a été divisé et appliqué à différentes écoles de pensée.
Le monisme dans le monde islamique
Par exemple, les traditions philosophiques grecque et hindoue antiques ont toutes deux développé de riches interprétations et adaptations du monisme. Parmi les présocratiques, les pythagoriciens ont développé l’une des premières formes de monisme que nous connaissons encore aujourd’hui – une idée connue sous le nom de monade . Mais nous examinerons ici une tradition du monisme méconnue et sous-représentée : le monisme dans le monde islamique.
Alors que les philosophes luttent contre la frustration de tenter de comprendre la nature ineffable de la réalité, de nombreux intellectuels musulmans de premier plan ont au moins tenté de résoudre ce dilemme épineux. Parmi eux, Ibn Arabi et Shihabuddin Suhrwardi, deux intellectuels éminents de la philosophie islamique.
L’lilluminationisme de Suhrawardi
Suhrawardi, né en Perse au XIe siècle, fut exécuté pour hérésie en raison de son idée originale de Hikmat Al Ishraq – la sagesse illuminative. Ses œuvres ont donc été marginalisées et minutieusement examinées par l’ensemble du spectre de l’islam traditionnel. Ses écrits, profondément influencés par Ibn Sina, le néoplatonisme et l’aristotélisme, ont finalement ouvert la voie à une nouvelle école de pensée mystique, l’Illuminationnisme.
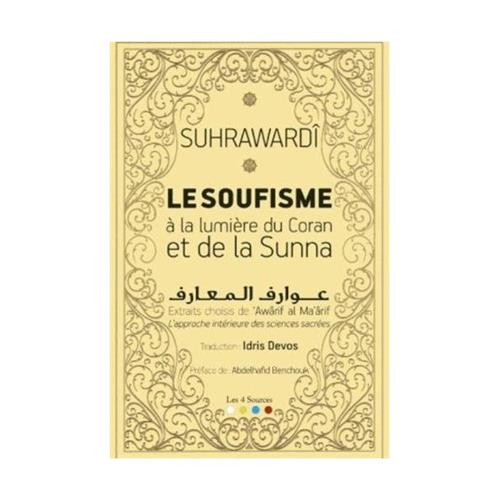
Son idée fondamentale est que la réalité est lumière divine ( Nur ), qui s’affaiblit à mesure qu’elle s’étend de Dieu, donnant naissance à des manifestations immatérielles, matérielles et corrompues de Dieu, constituant finalement la réalité unique. Suhrwardi propose en outre une structure hiérarchique de gradations, avec des degrés de manifestation et d’intensité, et souligne l’importance de l’interaction entre les dimensions ésotériques ( Batin ) et exotériques ( Zahir ) de la réalité, c’est-à-dire entre ce qui est visible et ce qui est caché à la perception.
L’unicité vue par Ibn ‘Arabi
Suhrawardi insiste sur l’importance de l’expérience directe et de l’intuition, et ses idées ont de solides fondements gnostiques ( Irfani ). Ses idées s’alignent également sur le concept très célèbre mais ambigu de Wahdatal-Wujud d’Ibn Arabi , qui affirme que Dieu est la seule réalité universelle et que la création est un réseau complexe et continu d’interconnexion avec Dieu.
Ibn Arabi, né au XIIe siècle de notre ère en Ibérie (Espagne) sous autorité arabe, est considéré par certains comme « Cheikh Al Akbar » (« Le plus grand cheikh ») et par d’autres comme « Docteur Maximus » (« Le plus grand professeur »). Sa pensée révolutionnaire s’est forgée au sein de sa propre école de pensée, les Akbariens.
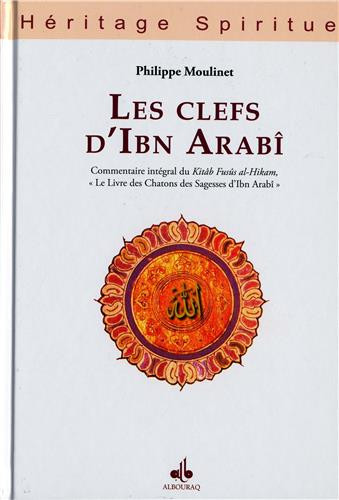
Contrairement à Suhrwardi, Ibn Arabi n’utilise pas l’idée d’une lumière métaphysique ni aucune autre possibilité élémentaire comme explication archétypale. Au sommet de son système philosophique se trouve plutôt l’idée de l’unité de l’existence.
Cette idée profonde dissout la dichotomie entre le monde perçu et son créateur, suggérant que l’univers et Dieu ne sont pas des entités distinctes, mais des aspects entrelacés d’un tout unifié et indivisible, sans distinction fondamentale entre la création et le créateur.
Le Barzakh, ligne de connexion
Néanmoins, Ibn Arabi aborde la différence entre Mahiyya (Qu’est-ce que c’est) et Wujud (C’est cela), tout en maintenant la distinction entre la réalité sous-jacente et les choses qui existent dans le monde des apparences, ou Mawjudat . De plus, Ibn Arabi introduit le concept de Barzakh , un domaine métaphysique où l’unité et la multiplicité interagissent, soulignant ainsi l’importance de la nature relationnelle ( Talluq ) de l’existence, qui est un état d’interconnexion sans faille.
Ses idées sont souvent interprétées à tort comme un panthéisme hérétique, même si Ibn Arabi établit une divergence claire avec cela, en disant par exemple que les humains sont des manifestations d’Allah, mais pas identiques à Lui.
Les idées d’Ibn Arabi et de Suhrwardi ont essentiellement jeté les bases du développement doctrinal du mysticisme islamique que nous connaissons sous le nom de soufisme ; et bien que leurs interprétations profondes de la réalité fassent encore l’objet de débats approfondis, elles peuvent néanmoins être considérées comme deux des figures les plus talismaniques de la pensée islamique médiévale.
Musa Mumtaz est un essayiste et commentateur politique basé à Lahore, au Pakistan.