Découvrez sur Mizane.info la notion de pensée frontalière, une lecture contemporaine du soufisme confrontée aux écueils du colonialisme culturel. Une chronique en deux parties de Mujib Abid.
Cet article explore comment l’écriture inspirée du soufisme au sein de la diaspora afghane – et plus particulièrement la poésie – constitue une forme de production de savoir décolonial. En exil, les écrivains afghans ne sont pas de simples individus disloqués, mais des agents épistémiques œuvrant en marge des cadres dominants.
À mesure que les diasporas afghanes s’étendent – souvent par le biais de déplacements involontaires et de régimes frontaliers racialisés – s’étend un imaginaire littéraire transnational qui bouleverse les récits coloniaux et nationalistes de l’identité, de l’islam et de l’appartenance. À travers le prisme du soufisme, ils mettent en œuvre ce que Walter Mignolo appelle la pensée frontalière : un savoir né aux confins des empires, façonné par des histoires de déplacements, de résistance et de résilience spirituelle.
La pensée frontalière et le tournant décolonial
Forgée par Mignolo , la pensée frontalière désigne les formes de savoir qui émergent des failles de la colonialité – un savoir façonné par le mouvement transfrontalier, le refus des épistémologies eurocentristes et l’attention portée à la pluriversité pour imaginer des futurs alternatifs et décoloniaux. Elle s’inspire de penseurs comme Abdelkebir Khatibi , dont les notions d ‘« autre pensée » et de « double critique » insistent sur la critique des fondamentalismes occidentaux et non occidentaux depuis une position d’extériorité.
Les fissures et les craquelures, en elles-mêmes, comme le rappelle Catherine E. Walsh , ne sont « pas la solution, mais la possibilité d’autres choses, celles qui existent, émergent et prennent forme et perdurent sans cesse ». L’objectif n’est donc pas simplement la critique, mais la transformation : imaginer un monde au-delà des systèmes de pensée singuliers et totalisants.
Au sein de la pensée musulmane, cette ouverture épistémique trouve son expression dans l’islam traditionnel, notamment à travers le soufisme. L’islam traditionnel , incarné et pratiqué par une majorité de fidèles musulmans à travers le monde, puise ses racines dans la métaphysique classique, les lectures ésotériques et l’expérience spirituelle. Il constitue une troisième voie vers la dichotomie étouffante souvent établie par la recherche occidentale, qui appréhende l’islam exclusivement en termes politiques, une vision binaire entre modernisme islamique (« islam modéré ») et fondamentalisme islamique (« islam radical »). Il est à la fois historique, intellectuel et vécu.
L’héritage soufi de l’Afghanistan et sa répression
En Afghanistan, la tradition soufie – que Seyyed Hossein Nasr théorise comme le courant islamique traditionnel et qu’Idries Shah a tant œuvré à rendre accessible à un public international – est profondément ancrée. Depuis plus de mille ans, le tasawuf coexiste de manière dynamique avec la jurisprudence hanafite dominante et les coutumes locales ( sunat-hai mardumi ), tant tribales qu’urbaines, islamiques que préislamiques. Cette cohabitation a donné naissance à une forme afghane d’islam distinctive – ésotérique, flexible, poétique et profondément ancrée dans des approches locales et non hiérarchisées de l’organisation du pouvoir.
La poésie, en particulier, est au cœur de cette épistémologie spirituelle. Les traditions poétiques afghanes incluent les styles khorasani et irakien, très formalisés, l’école bedil ( bedil shinasi ), mystique et plurielle, et diverses formes populaires. Comme l’a observé le célèbre historien littéraire afghan Haidari Wujudi : « La poésie est la perle éclatante qui éclaire chaque recoin de l’histoire. »
Malgré sa profondeur et sa continuité, l’islam traditionnel en Afghanistan a été maintes fois attaqué – par les puissances coloniales, par l’élite nationaliste modernisatrice et par les régimes autoritaires. Des réformateurs du début du XXe siècle, comme Mahmoud Tarzi, ont qualifié ce mode de connaissance de dépassé, déclarant : « Le temps de la poésie est révolu. Voici venu l’ère de l’automobile, du rail et de l’électricité. » Ce techno-utopisme a aligné le nationalisme afghan sur des logiques de développement eurocentriques, marginalisant l’islam ésotérique au profit du rationalisme scientifique et de la modernité bureaucratique.
Plus tard, lors de la « révolution » communiste d’avril 1978 , la littérature elle-même devint un terrain de contrôle de l’État (et de ses adversaires modernistes et islamistes). Comme le souligne Wali Ahmadi , tant l’État que ses adversaires islamistes instrumentalisèrent les intellectuels comme instruments de commandement. La complexité de l’expression soufie – son ambiguïté, son intériorité et son refus de se conformer – fut systématiquement étouffée.
Guerre, exil et persistance du savoir poétique
Les décennies de conflit qui ont suivi – occupation soviétique, guerre civile, régime taliban, intervention américaine – ont entraîné des ravages et des déplacements massifs. Plus de six millions d’Afghans ont été contraints à l’exil. Selon le Migration Policy Institute , plus de 90 % d’entre eux vivent aujourd’hui dans les pays voisins, tandis que d’autres sont dispersés à travers le monde. En Australie, la migration afghane remonte aux communautés chamelières ghanéennes du XIXe siècle . Mais les arrivants modernes – surtout après les années 1980 – sont principalement venus comme réfugiés, souvent soumis aux politiques frontalières australiennes strictes, racialisantes et sécuritaires.
Comme le souligne Border Criminologies, les frontières, en contrôlant les déplacements et en imposant des sanctions aux organismes, peuvent devenir des lieux de violence. Il peut s’agir de violence directe – en Australie, on peut penser aux camps de détention terrestres et extraterritoriaux, où, comme l’a souligné avec force Behrouz Boochani , un « état d’exception » est instauré, permettant d’étendre et de fermer la souveraineté à volonté. Mais il peut aussi s’agir de violence structurelle et culturelle.
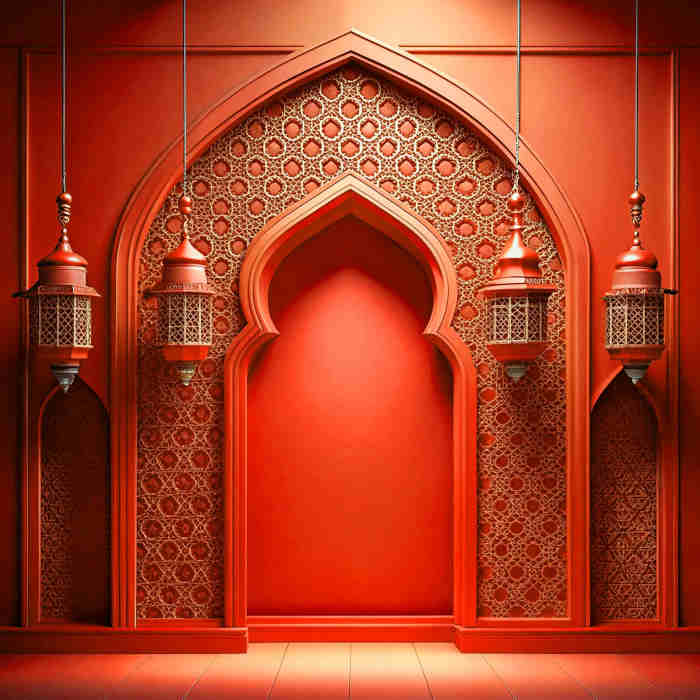
Structurelle, car les demandeurs d’asile et les réfugiés ont un accès limité aux droits, aux ressources et aux opportunités, tandis que leurs vulnérabilités existantes sont exacerbées (voir Segrave et Vasil sur l’impact des régimes frontaliers sur la sécurité des femmes migrantes en Australie).
Culturelle, car les migrants sont réduits au silence, leur gnose et leurs réalités ontologiques entièrement absorbées ou systématiquement marginalisées par un courant dominant assimilationniste, et pourtant, d’une certaine manière, rien de tout cela ne semble « mal ». Cette triade violente est mise en œuvre contre la poésie et les lettrés des réfugiés afghans.
Malgré cela, les communautés afghanes d’Australie continuent de produire une riche œuvre culturelle. Mi-2023, plus de 78 000 Afghans d’origine vivaient en Australie, dont des milliers évacués après la chute de Kaboul en 2021. Parmi eux figurent des poètes, des musiciens, des journalistes et des érudits, dont beaucoup s’inspirent des visions du monde soufies pour articuler des savoirs ancrés dans l’intuition , la spiritualité et la pensée frontalière.
Ces écrivains évoluent souvent en dehors du champ littéraire australien dominant. Leurs œuvres, généralement en dari ou en pachtoune, sont rarement traduites ou publiées par les institutions dominantes. Ils s’appuient plutôt sur des réseaux transnationaux informels : livres imprimés à Kaboul ou à Téhéran, manuscrits envoyés par des proches, poèmes diffusés via WhatsApp ou partagés dans des salons littéraires virtuels.
Écrivant depuis des espaces communautaires de banlieue ou chez eux – souvent confrontés aux pressions de la précarité, du travail et de la famille – ces poètes sont doublement marginaux : périphériques à la fois à leur nouvelle patrie et à leurs centres ancestraux. Et pourtant, ils persistent.
Il s’agit d’une économie d’autoédition, ancrée dans la mémoire collective et l’urgence spirituelle. Les auteurs offrent des livres, récitent des poèmes lors de rassemblements communautaires et contribuent à un dialogue transnational qui transcende les frontières et les institutions. Leur travail ne cherche pas à s’intégrer aux espaces culturels dominants ni aux récits marchands. Il s’adresse à tous, par-delà les langues, les générations et les géographies.
L’écrivain soufi exilé se situe entre les mondes. Son savoir ne se situe ni clairement dans le passé, ni pleinement dans l’avenir. Il surgit de l’entre-deux : dans les significations cachées des Écritures, dans la perte d’une patrie, dans l’intimité d’un verset mémorisé, dans le rassemblement d’inconnus sur Zoom à l’aube.
Il s’agit d’ une réflexion sur les frontières comme pratique vécue – ni nostalgique ni utopique, mais obstinément présente. C’est un refus d’abandonner la poétique au royaume de « ce qui fut » et une insistance sur le fait que le sacré, le beau et le vrai circulent encore dans notre présent fracturé.
Mujib Abid






