Symbole universel de pureté et de réceptivité spirituelle, la Vierge Marie occupe une place unique à la croisée des traditions. Figure de transparence et d’obéissance au Verbe divin, elle incarne un archétype du féminin sacré que l’époque moderne semble avoir oublié. Cette méditation d’Arslan Akhtar explore sa signification métaphysique, en contraste avec les dérives du féminisme contemporain.
“O Mariyam (Marie), voici, Allah t’a choisie et purifiée, il t’a choisie parmi toutes les femmes de l’univers.” (Qur’an 3:42)
“Nous lui avons insufflé notre souffle, nous avons fait d’elle et de son fils un Signe pour les univers.” (Qur’an 21:91)
Ces versets, dans la traduction inspirée de feu André Chouraqui, résument à eux seuls la place unique qu’occupe Marie, mère de Jésus (paix et bénédictions sur eux), dans la vision islamique du monde : à travers eux s’exprime l’une des plus hautes affirmations de la pureté féminine et de la sainteté universelle.
Outre les nombreux versets qui lui sont consacrés, le Qur’an consacre à cette figure une sourate entière portant son nom, la sourate 19, signe que la Vierge, loin d’être marginale, incarne une réalité métaphysique et initiatique centrale dans la perspective traditionnelle de l’Islam.
L’appréciation chrétienne
Certains auteurs chrétiens n’ont pas manqué de remarquer la profonde dévotion que le Qur’an accorde à Marie, y voyant un pont inattendu entre la spiritualité islamique et la théologie mariale. C’est le cas de Michel Dousse, théologien et essayiste français, fin connaisseur du dialogue islamo-chrétien.
Dans son livre désormais de référence Marie la musulmane, il écrit (pp. 102–103) :
« La sourate “Maryam” (19) baigne dans une lumière d’intimité et de réminiscence silencieuse qui rappelle ce que Luc notait dans l’Évangile : que “Marie conservait avec soin tous ces souvenirs et les méditait en son cœur” (Lc 2 : 19). […] L’intimité sereine qui en émane est cependant austère, même rude.
[…] La ferveur de cette sourate 19 n’est pas celle, lumineuse, des grandes liturgies et des hymnes que peut évoquer la sourate 3, mais celle, cachée, du renoncement et du silence, d’un désert choisi. »

Dans l’exégèse spirituelle, Marie apparaît comme l’archétype de la réceptivité pure, le symbole même de la matière sanctifiée par l’Esprit divin. En elle, la grâce céleste s’unit à la substance terrestre sans mélange ni confusion : elle devient ainsi le miroir transparent de la Volonté divine. Son élection n’est pas le fruit d’un mérite humain, mais une manifestation du principe de pureté originelle (tahara), principe féminin dans l’ordre cosmique, dont elle est la personnification.
Au commencement était le silence
Dans la doctrine islamique, la Vierge n’est pas seulement la mère du Messie, elle est le signe du pouvoir créateur de Dieu opérant sans intermédiaire, la preuve que la Parole divine (kalima) se communique directement à la créature réceptive.
Elle est, pour ainsi dire, la terre virginale où germe le Verbe, ce qui explique pourquoi la tradition islamique la tient pour irréprochable, immaculée et continuellement préservée de toute souillure.
On pourrait dire encore que, par sa pureté originelle, Marie incarne le silence primordial d’où jaillit le Verbe. En elle, toute agitation de l’âme est abolie : elle devient la vacuité lumineuse où la Parole divine trouve à s’incarner sans obstacle. Ce symbolisme du silence, non pas absence, mais plénitude contenue, rejoint la sagesse des grandes traditions spirituelles d’Orient, pour lesquelles le silence est la matrice de la connaissance, le lieu où la Vérité s’engendre avant de se dire.
On songe ici au Zen, où l’éveil naît précisément de cette vacuité silencieuse (mu), non du raisonnement discursif, car c’est dans le dépouillement absolu du moi que la Réalité ultime se révèle d’elle-même, sans effort, comme une lumière qui n’a jamais cessé de briller.
Une “icône” qui n’a pas besoin d’iconographie
C’est pourquoi l’iconographie chrétienne et, plus encore, la mariolâtrie propre au catholicisme dévotionnel paraissent, du point de vue métaphysique, altérer le symbolisme primordial de la Vierge. Celle-ci, au lieu d’être contemplée comme principe de réceptivité pure, devient un objet de sentiment religieux, une figure mise en avant dans l’ordre psychologique plutôt que reconnue dans sa fonction ontologique.
Même certains penseurs orthodoxes contemporains, tels Léonide Ouspensky ou Paul Evdokimov, ont relevé ce glissement : l’icône, conçue à l’origine comme fenêtre vers l’invisible, tend souvent à devenir, dans la pratique populaire, objet de dévotion émotionnelle, voire d’esthétisme profane. L’image n’est alors plus symbole — c’est-à-dire signe qui relie — mais idole qui retient.
Ainsi, l’iconographie mariale, lorsqu’elle cède à la douceur sentimentale ou à la complaisance plastique, ne révèle plus la Vierge comme transparence de la Grâce, mais la fige en effigie de tendresse humaine.
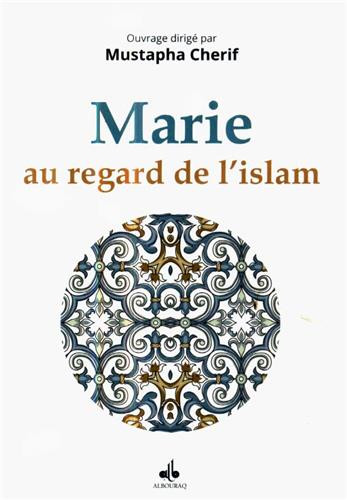
Or, la Vierge n’est pas à adorer, ni même à exalter humainement : elle est à contempler comme transparence, l’instant silencieux où le Verbe se manifeste sans appropriation. Elle ne se situe pas dans le domaine de l’affectif, mais dans celui du symbolisme métaphysique, où la forme visible ne vaut que par sa capacité à s’effacer devant la Présence qu’elle exprime.
En la personnifiant au point d’en faire une idole de piété, on voile paradoxalement ce qu’elle signifie : la matière sanctifiée, humble et passive devant l’Acte divin, principe de toute théophanie.
Ce n’est pas la Vierge représentée qu’il faut aimer, mais la lumière silencieuse qui passe à travers elle, comme à travers tout être devenu pure transparence au Divin.
Le féminin contre le féminisme
Sa figure, profondément honorée dans toutes les formes d’orthodoxie islamique, représente donc le sommet de la féminité spirituelle — non pas la femme dans sa fonction sociale ou naturelle, mais dans sa fonction ontologique, celle de recevoir la lumière et de la refléter intégralement.
Dans la hiérarchie des signes divins (ayat Allah), Marie se situe comme un pont entre l’humain et le céleste, entre la création et la Parole incréée. De fait, dans l’Islam traditionnel, Marie est objet de vénération silencieuse plutôt que de culte formel : sa sainteté n’appelle pas l’adoration, mais la contemplation.
Elle demeure, pour les initiés comme pour les simples croyants, le modèle de la pure soumission à la Volonté divine, l’âme vierge qui, en se vidant de tout “moi” égotique, devient demeure de la Parole et témoin de la Miséricorde.

Cela nous ramène à notre thèse principale : la figure de la Vierge, dans sa signification métaphysique, constitue un antidote spirituel au féminisme moderne, dont l’expansion traduit moins une libération authentique qu’une inversion des principes.
Là où Marie incarne la féminité principielle, pure, réceptive, ordonnée à la transcendance, le féminisme érige la contestation de tout ordre hiérarchique comme une fin en soi.
Les quatre vagues du féminisme
- Première vague (fin XIXᵉ – début XXᵉ siècle) : portée par Mary Wollstonecraft, Emmeline Pankhurst ou Olympe de Gouges, elle revendique les droits civiques et politiques (éducation, droit de vote, égalité légale). C’est la phase libérale du féminisme, encore ancrée dans un certain humanisme moral.
- Deuxième vague (années 1960–1980) : sous l’influence de Simone de Beauvoir (Le Deuxième Sexe) et Betty Friedan (The Feminine Mystique), elle déplace le combat vers la libération sexuelle et sociale, redéfinissant la femme non plus comme complémentaire, mais comme autonome vis-à-vis du principe masculin.
- Troisième vague (années 1990–2000) : représentée par Judith Butler (Gender Trouble) ou bell hooks, elle introduit la notion de genre et la critique du “patriarcat symbolique”. Le féminisme se pluralise en discours intersectionnels, postcoloniaux, queer.
- Quatrième vague (depuis les années 2010) : essentiellement numérique et militante (#MeToo, cyberactivisme), elle devient mouvement global de contestation morale, fondé sur l’émotion et la visibilité, souvent détaché de toute réflexion métaphysique.
Face à cette succession de ruptures, la Vierge Marie apparaît comme la contre-image absolue : elle ne revendique pas, elle reçoit ; elle ne s’affirme pas contre, elle s’offre à ; elle ne détruit pas l’ordre, elle en manifeste la transparence.
Sa pureté est puissance, non par domination, mais par accord total avec le Principe. Là où le féminisme moderne voit l’émancipation dans la négation du masculin, la Vierge, au contraire, révèle la féminité comme véhicule du divin, participation silencieuse et lumineuse à l’Acte créateur.
Là où le féminisme moderne tend à confondre la dignité du féminin avec l’agitation de l’activité, la Vierge manifeste que la puissance authentique de la femme réside dans sa passivité principielle — non pas inertie, mais réceptivité féconde, accord parfait à l’Acte créateur.
Le centre immobile
Dans la perspective traditionnelle, cette “passiveté” n’est pas une faiblesse : elle est le lieu même où se réfléchit la volonté divine, la transparence qui permet au Verbe de se manifester.
Pour emprunter une métaphore taoïste, la Vierge est semblable au centre immobile de la roue, autour duquel tout tourne sans qu’il tourne lui-même. Ce centre immuable ne s’oppose pas au mouvement ; il en est le principe silencieux, la source invisible qui le rend possible.
Ainsi, dans toute la sagesse d’Orient, le féminin correspond à la non-action (wu-wei), c’est-à-dire à l’accord total avec le rythme du Ciel, à l’absence d’intervention égotique.
Cette intuition n’est pas étrangère à la philosophie antique : Aristote, dans sa Métaphysique, décrit Dieu comme le “moteur immobile”, cause première de tout mouvement sans être Lui-même mû.
Il s’agit ici, bien sûr, d’une analogie et non d’une identité : la Vierge ne saurait être confondue avec le Principe premier, mais elle en est, à l’échelle cosmique, le reflet symbolique — l’image de la réceptivité immobile où l’Acte divin trouve à se manifester sans résistance.
Cette idée du centre immobile, source silencieuse du devenir, sera reprise par les néoplatoniciens, notamment Plotin et Proclus, pour qui toute la multiplicité émane de l’Un sans que celui-ci ne se modifie ni ne s’altère.
C’est dans cette même perspective que le féminin principiel, miroir du Principe, agit sans agir, engendre sans s’agiter : il est l’axe immobile autour duquel se déploie la manifestation, la demeure tranquille où l’Esprit descend pour donner forme au monde.
Ainsi, Marie ne fait pas, elle est.
Elle incarne, dans sa pure passivité, le pouvoir créateur de la réceptivité absolue — ce pouvoir qui, loin d’être inférieur, est celui qui donne naissance au Verbe.
Arslan Akhtar





Une réponse
Quel rapport avec e féminisme ? L’une est lumière l’autre de chair et de sang …