Chercheur en sciences islamiques à l’Université de Groningue, Joshua J. Little estime dans une étude historique dont Mizane.info publie de larges extraits que la canonisation du Coran par Uthman est la thèse la plus solide défendue à ce jour en histoire et en codicologie.
Depuis plus d’un siècle, les savants occidentaux débattent de l’identité du premier dirigeant ou homme d’État musulman qui a canonisé le Coran1, établissant le type de texte standard du texte consonantique sous-jacent (rasm) présent dans presque tous les manuscrits coraniques2. La tradition historique islamique est unanime pour identifier ʿUthmān b. ʿAffān (r. 24-35/644-656) comme le dirigeant en question, une opinion initialement approuvée par les fondateurs européens du XIXe siècle de l’étude occidentale moderne de l’islam primitif 3.
En 1911, cependant, ce consensus fut remis en question par Paul Casanova, qui rejeta l’historicité de la canonisation ʿUthmānique et identifia à la place al-Ḥajjāj b. Yūsuf (m. 95/714), le tristement célèbre gouverneur au service du calife omeyyade ʿAbd al-Malik b. Marwān (r. 65-86/685-705), véritable canonisateur du Coran.4 Le consensus ʿUthmānique est resté dominant pendant le demi-siècle suivant 5 mais il a dû désormais faire face à un éventail d’hypothèses révisionnistes Ḥajjājiennes : al-Ḥajjāj aurait corrigé les erreurs du canon consonantique d’ʿUthmān et recanonisé le texte 6 ; et/ou al-Ḥajjāj aurait modifié ou expurgé le contenu du canon consonantique d’ʿUthmān et recanonisé le texte 7 ; ou encore al-Ḥajjāj, plutôt que ʿUthmān, aurait produit le texte consonantique canonique.8 De plus, il existait également une opinion selon laquelle al-Ḥajjāj aurait clarifié l’orthographe du canon consonantique de ʿUthmān en ajoutant des signes diacritiques.9
Parallèlement à ces positions ʿuthmāniques et Ḥajjājiennes opposées, deux nouvelles hypothèses ont été introduites en 1977 : la première par John Wansbrough, qui a soutenu que le texte coranique ne s’est cristallisé qu’aux environs des années 800 de notre ère, au début de la période abbasside 10 ; et la seconde par John Burton, qui a soutenu que Muḥammad lui-même (mort en 11/632) était le véritable canonisateur du Coran.11 Aucune de ces deux opinions n’a cependant eu beaucoup de succès, celle de Wansbrough en particulier ayant fait l’objet de nombreuses critiques dans les années 1990 et 2000.12 Seules les hypothèses ʿUthmānique et (diverses) Ḥajjājiennes ont perduré au XXIe siècle, la première continuant d’occuper une position plus dominante dans le domaine.13
Méthodologie et objectifs de l’étude
Le présent article, qui est le premier d’une série tripartite, vise à (1) identifier et résumer les principaux arguments formulés par les chercheurs occidentaux pour et contre l’historicité des implications respectives d’ʿUthmān et d’al-Ḥajjāj dans la production du texte coranique canonique ; (2) étayer et compléter ces arguments par des arguments et des commentaires si nécessaire, en comblant certaines lacunes dans les études existantes ; et (3) comparer et évaluer les forces et les faiblesses desdits arguments.
Tout au long de cette étude critique, trois conclusions clés se dégageront : premièrement, que les partisans de (toutes les versions de) l’hypothèse Ḥajjājienne n’ont pas réussi à s’engager de manière adéquate dans les sources primaires et secondaires pertinentes ; deuxièmement, que les preuves disponibles soutiennent et confirment massivement l’hypothèse ʿUthmānique ; et, troisièmement, que les preuves disponibles, au mieux, ne soutiennent que faiblement, et au pire contredisent fortement, toutes les versions de l’hypothèse Ḥajjājienne. En d’autres termes, sur la base des preuves disponibles, il ne fait guère de doute que c’est ʿUthmān, et non al-Ḥajjāj, qui a canonisé le Coran.
Arguments en faveur d’ʿUthmān
Pour commencer, les partisans de l’hypothèse ʿUthmānique dans le monde universitaire occidental ont développé au moins neuf arguments distincts en faveur de cette thèse (énumérés et désormais désignés par U1, U2, U3, etc.) :
U1. Hossein Modarressi et Gregor Schoeler ont tous deux soutenu que le consensus unanime des premiers musulmans concernant la canonisation d’ʿUthmānique témoigne d’une véritable mémoire collective ou s’y rattache.14
U2. Behnam Sadeghi et Nicolai Sinai ont tous deux soutenu qu’il aurait été extrêmement difficile pour les musulmans après l’époque d’ʿUthmān – divisés par régions et par sectes – de converger collectivement ou unanimement vers un récit faux et secondaire concernant la canonisation du Coran, ce qui signifie que le consensus ʿUthmānique reflète plus probablement une véritable mémoire historique.15
U3. Friedrich Schwally (très brièvement) et Sadeghi (plus en détail) ont tous deux essentiellement soutenu que l’acceptation de la canonisation ʿUthmānique par des factions anti-ʿUthmāniques remplit les critères de dissemblance et d’embarras. De ce point de vue, des factions anti-ʿUthmāniques comme les chiites et les ibadites n’auraient probablement pas accepté un récit ʿUthmānique jusqu’alors inédit faussement créé par une autre faction, et n’auraient probablement pas créé un tel récit elles-mêmes, de sorte que leur acceptation à contrecœur s’explique au mieux en postulant : que ʿUthmān a effectivement canonisé le Coran ; que cet événement a été vu ou vécu par tous et chacun ; et que la canonisation d’ʿUthmān devint ainsi un fait incontestable reconnu par toutes les factions, y compris les factions hostiles – surtout les chiites et les ibadites – qui émergèrent ou se cristallisèrent après le meurtre d’ʿUthmān.16
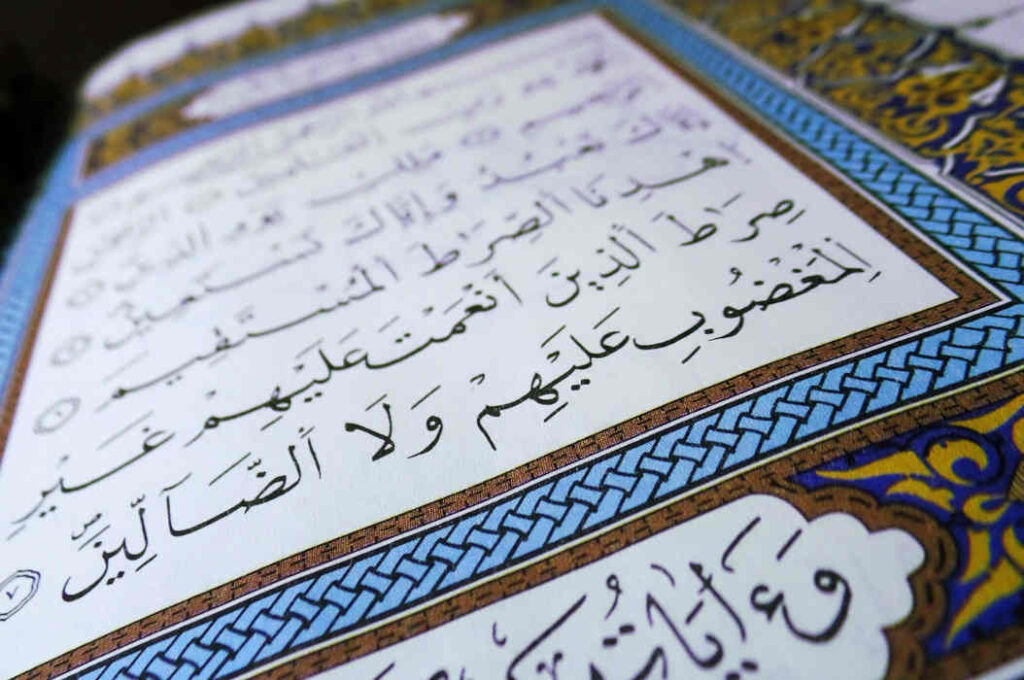
U4. Sadeghi (plus en détail) et Sinai (moins en détail) ont tous deux soutenu : que la canonisation du Coran est évidente à partir de l’universalité et de l’uniformité d’un seul type de texte dans les archives manuscrites coraniques ; que cette canonisation a dû être un événement public d’une grande importance religieuse et politique ; que l’identité de celui qui a procédé à cette canonisation a donc dû entrer dans la connaissance publique ou la mémoire collective de la première communauté musulmane dans son ensemble ; qu’une information aussi fondamentale n’a pas pu être oubliée et écrasée avec succès et de manière cohérente dans l’ensemble de la communauté, dans toutes les régions et toutes les sectes ; que le consensus musulman primitif concernant l’occurrence d’une canonisation ʿUthmānique est le seul candidat pour être cette connaissance publique durable de la canonisation du Coran ; et que le consensus musulman primitif concernant l’occurrence d’une canonisation ʿUthmānique est donc probablement né d’une véritable mémoire collective de la canonisation réelle du Coran par ʿUthmān.17
U5. Schoeler et Sinai ont tous deux soutenu que l’hostilité largement rapportée des premiers récitants musulmans du Coran (qurrāʾ) envers la canonisation d’ʿUthmān s’explique mieux comme un compte rendu globalement précis de la réaction authentique d’un groupe social ou d’une profession dont les intérêts ont été minés par les actions d’ʿUthmān ; et que d’autres rapports saluant la canonisation d’ʿUthmān s’expliquent mieux comme des réponses apologétiques à cette controverse historique.18
U6. Schoeler a soutenu que personne n’aurait faussement créé les rapports des variantes mineures qui caractérisaient les codex coraniques qu’ʿUthmān a envoyés dans différentes provinces dans le cadre de son projet de canonisation, de sorte que les rapports en question doivent refléter des observations authentiques des codex canoniques d’ʿUthmān.19
U7. Sadeghi a soutenu – sur la base de recherches antérieures de Theodore Nöldeke et Michael Cook – que les variantes susmentionnées des copies régionales d’ʿUthmān forment des stemmata compatibles avec le scénario de la copie à partir d’un seul archétype ; que ces rapports enregistrent donc probablement les variantes réelles d’un véritable ensemble de manuscrits copiés à partir d’un seul archétype ; que les premiers musulmans ont ainsi préservé avec précision certains détails infimes de l’histoire du Coran ; que ces mêmes premiers musulmans étaient unanimes à identifierʿUthmān comme celui qui a canonisé le Coran et produit les copies régionales susmentionnées ; que des informations plus fondamentales ou générales sur l’histoire du Coran, comme l’identité de son canonisateur, auraient été beaucoup plus faciles à préserver pour les premiers musulmans, ou beaucoup plus susceptibles d’avoir été préservées par eux, que de tels détails infimes ; ce qui signifie que le consensus musulman primitif concernant le fait fondamental ou général de la canonisation d’ʿUthmān est probablement également exact. En bref, il s’agit d’un argument a fortiori : si les premiers musulmans ont pu consigner avec précision certains détails infimes de l’histoire du Coran, alors il est d’autant plus probable qu’ils avaient raison dans leur consensus concernant la canonisation d’ʿUthmān.20
U8. Hythem Sidky a soutenu que le consensus musulman traditionnel selon lequel ʿUthmān a produit quatre copies régionales de son Coran canonique – une pour Médine, une pour la Syrie, une pour Koufa et une pour Bassorah – est confirmé par une analyse stemmatique des premières variantes de manuscrits coraniques ; qu’il est peu probable qu’il s’agisse d’une coïncidence ; que l’existence de quatre copies régionales originales n’a pas pu être déduite ultérieurement sur la base des preuves manuscrites ; et donc, que le consensus musulman traditionnel à ce sujet doit provenir d’une mémoire collective de la production effective par ʿUthmān de quatre codex régionaux dans le cadre de son projet de canonisation.21
U9. Sidky a soutenu que la copie originale du Coran canonique que ʿUthmān a envoyée en Syrie aurait été envoyée à la ville de Ḥimṣ en particulier ; que Ḥimṣ a été éclipsée par Damas en tant que principale ville syrienne immédiatement après la mort de ʿUthmān (c’est-à-dire avec l’ascension de Muʿāwiyah et de la dynastie omeyyade à Damas) ; qu’un rapport ultérieur et faux sur la copie syrienne originale du Coran canonique devrait donc mentionner Damas plutôt que Ḥimṣ ; et que le rapport selon lequel ʿUthmān aurait envoyé une copie à Ḥimṣ remplit ainsi le critère de dissemblance et reflète de manière plausible un souvenir archaïque (pré-omeyyade) selon lequel ʿUthmān l’aurait effectivement fait.22
Examen des contre-arguments et réponses aux critiques
Stephen Shoemaker et Guillaume Dye, deux éminents sceptiques de l’hypothèse ʿutmānique, ont largement répondu aux trois premiers arguments (U1-3), chacun faisant appel d’une manière ou d’une autre au consensus des premiers musulmans.23 En particulier, Shoemaker et Dye soutiennent : qu’un consensus musulman précoce sur un point antérieur de l’histoire pourrait en fait être le produit d’une sorte de faux récit secondaire ;24 que le pouvoir et l’influence de l’État omeyyade pourraient expliquer la propagation et la prédominance du récit ʿutmānique à travers les diverses sectes et régions de l’islam primitif ;25 et que les premiers musulmans n’étaient pas unanimes sur l’identité du canonisateur coranique en Quoi qu’il en soit,26
Shoemaker et Dye ont certainement raison de souligner la possibilité qu’un consensus musulman ancien – unanime ou non – concernant un point historique antérieur puisse être erroné,27 même si certains des exemples cités par Dye pour illustrer cette possibilité – par exemple, que les premiers musulmans ont collectivement oublié que Mahomet est en réalité mort après 11/632 – sont extrêmement douteux et très contestés.28
Cependant, l’affirmation selon laquelle les premiers musulmans n’étaient pas unanimes sur l’identité du canonisateur du Coran est tout simplement fausse : dans pratiquement tous les cas connaissables d’une source islamique ancienne qui raconte ou mentionne le canonisateur du Coran, ʿUthmān est identifié comme tel.29
En revanche, les sceptiques comme Shoemaker et Dye n’ont pu avancer que (1) des désaccords concernant l’état pré-ʿUthmānique du texte coranique 30 (2) des désaccords concernant des détails spécifiques de la canonisation 31 (3) divers rapports faisant état de l’application du texte uthmanique par al-Ḥajjāj et de son envoi de nouvelles copies de ce texte à certaines provinces 32 et (4) une importante source historique ancienne – le Kitāb al-Ṭabaqāt al-kubrā d’Ibn Saʿd (m. 230/845) – qui ne contredit pas explicitement le récit uthmanique de base, mais omet simplement de le mentionner, ou de le mentionner spécifiquement dans les sections consacrées à ʿUthmān et à son assistant Zayd b. Thābit, ou pour citer en particulier le célèbre rapport d’Ibn Shihāb al-Zuhrī.33 Ce n’est que dans les sources chrétiennes que nous trouvons une réelle dissidence par rapport au consensus ʿUthmānique, comme nous le verrons plus loin.34
De plus, concernant une hypothétique réécriture omeyyade de la mémoire collective musulmane de l’histoire du Coran, Shoemaker et al. n’ont jusqu’à présent pas réussi à expliquer exactement comment cela aurait pu être réalisé, en particulier compte tenu des divisions régionales et sectaires de l’islam pendant la période omeyyade.35 Certes, un vague appel au pouvoir et à l’influence de l’État omeyyade ne suffira pas, en particulier compte tenu de la survie de toutes sortes de récits et d’opinions anti-omeyyades et contre-omeyyades disséminés dans la tradition historique islamique.36
En fait, l’idée que les Omeyyades possédaient le pouvoir de contrôler la mémoire et l’opinion musulmanes primitives semble totalement incompatible avec notre image générale de la dynastie, comme l’a souligné Sadeghi : a souligné : « Relativement décentralisés et continuellement confrontés à la rébellion et à la dissension, les Omeyyades avaient du mal à préserver leur autorité politique sur leur domaine. »37 Sadeghi appuie ce point en faisant a fortiori appel au célèbre échec de l’inquisition rationaliste instituée par al-Maʾmūn (r. 198-218/813-833) : Si même la dynastie abbasside ultérieure s’est avérée incapable de contrôler facilement la doctrine islamique et l’opinion musulmane, quelles chances avait la dynastie omeyyade, relativement plus faible et moins centralisée ? 38
Enfin, il convient de reconnaître que les appels respectifs de Schoeler et de Sadeghi (U6-7) aux variantes qui caractérisaient les copies du Coran canonique qu’ʿUthmān envoyait aux provinces sont contestés par Marijn van Putten, qui reconnaît que les variantes en question auraient pu provenir de « n’importe quel groupe de manuscrits interdépendants copiés les uns des autres ». (c’est-à-dire pas nécessairement celui d’ʿUthmān) ;39 et par Sidky, qui soutient que les premiers savants musulmans ont en fait obtenu leur connaissance de ces variantes en examinant des copies ultérieures des manuscrits originaux.40

En d’autres termes, les arguments de Schoeler et de Sadeghi reposent tous deux sur l’hypothèse qu’il existe une sorte de lien inhérent entre (1) la préservation exacte de ces variantes et (2) leur attribution rétrospective à ʿUthmān, de sorte que l’exactitude de la première peut être transférée à la seconde. Selon Sidky, cette hypothèse semble être fausse : la connaissance des variantes qui caractérisaient les copies régionales originales du Coran canonique semble avoir été obtenue sur la base de l’observation directe de manuscrits ultérieurs, tandis que la connaissance de leur provenance ʿUthmānique ultime semble avoir été supposée ou déduite sur la base du consensus traditionnel selon lequel ʿUthmān a canonisé le Coran et en a envoyé des copies dans les provinces.
Les premiers savants musulmans qui ont émis cette hypothèse ou cette déduction avaient probablement raison ; mais leur exactitude à cet égard ne peut être vérifiée que sur la base d’autres considérations (c’est-à-dire les autres arguments décrits ci-dessus), indépendamment de la précision avec laquelle ils ont consigné les variantes des premiers manuscrits coraniques.
La solidité de l’hypothèse ʿuthmānique
En bref, il existe actuellement neuf arguments en faveur de l’hypothèse ʿutmānique, faisant appel à divers arguments : (U1) au consensus unanime des premiers musulmans à ce sujet. (U2) l’accord à ce sujet des musulmans divisés par région et par secte ; (U3) l’accord à ce sujet même des musulmans qui méprisaient ou critiquaient ʿUthmān ; (U4) le caractère public d’un tel événement ; (U5) la controverse précoce provoquée par le projet d’ʿUthmān ; (U6–7) les rapports sur les variantes mineures dans les codex d’ʿUthmān ; (U8) la congruence entre une analyse stemmatique des premières variantes de manuscrits coraniques et le consensus des premiers savants musulmans concernant le nombre de manuscrits d’ʿUthmān ; et (U9) le caractère vraisemblablement archaïque d’un rapport sur l’envoi d’un codex par ʿUthmān à Ḥimṣ.
Les sceptiques de l’hypothèse ʿuthmānique n’ont répondu qu’aux trois premiers de ces arguments, bien que leurs contre-arguments soient généralement faibles. Parallèlement à cela, des critiques valables peuvent être formulées à l’encontre des sixième et septième argument.
En l’état actuel des choses, cependant, l’hypothèse ʿutmānique demeure solidement justifiée : elle est étayée par de multiples types de preuves, notamment des récits et des variantes manuscrites ; elle s’appuie sur des considérations historiques plus larges relatives aux divisions communautaires et à la notoriété publique ; elle est étayée par des récits et des sources islamiques de provenances régionales et sectaires diverses, remplissant ainsi le critère d’attestation multiple et indépendante ; elle est étayée par des sources anti-ʿutmāniques, remplissant ainsi les critères de dissemblance et de confusion ; et elle est étayée par au moins un récit qui résiste aux attentes historiques ultérieures (concernant la localisation du codex syrien d’ʿUthmān), remplissant là encore de manière plausible le critère de dissemblance.
Il n’est probablement pas exagéré d’affirmer que la canonisation du Coran par ʿUthmān est l’un des faits les mieux attestés de l’histoire islamique primitive.
Joshua J. Little
Joshua J. Little est chercheur au Département des origines juives, chrétiennes et islamiques de l’Université de Groningue. Il est titulaire d’un master en études et histoire islamiques et d’un doctorat en études asiatiques et moyen-orientales de l’Université d’Oxford. Ses recherches portent sur les origines, la transmission et la régionalité du hadith ; la critique du hadith proto-sunnite ; les méthodes modernes d’analyse du hadith, notamment l’analyse isnad-cum-matn ; et la collecte et la canonisation du Coran.
Notes :
1 Par « canonisation », j’entends l’événement ou le processus par lequel un texte spécifique (ou une version spécifique d’un texte) (1) se diffuse au sein d’une communauté ; (2) acquiert un statut dominant ou officiel dans cette communauté ; et (3) se fixe aux yeux de la communauté et, dans une large mesure, dans sa transmission et sa préservation effectives – autorisant, bien sûr, les erreurs de copistes et même l’interpolation occasionnelle. (Ce dernier processus mentionné, par lequel un texte devient fixe, est parfois appelé « codification ».) L’aspect doctrinal et normatif supplémentaire de la canonisation, par lequel un texte est considéré comme une – ou comme la – source définitive des doctrines juridiques et théologiques pour la communauté, n’est pas l’objet du présent ouvrage. Voir notamment Neuwirth, « Qurʾan and History », 2, 13, à cet égard. Pour des discussions connexes, voir Donner, « The Qurʾān in Recent Scholarship », 41 ; Dye, « Pourquoi et comment se fait un texte canonique ? », 56–62, 85 ; idem, « Le corpus coranique », 850–56, 860, 887–889.
2 Pour diverses observations concernant l’uniformité générale de ce type de texte dans les manuscrits coraniques, voir Muir, The Life of Muhammad, 1:xiv–xv ; Nöldeke, Sketches, 53–54 ; Hurgronje, Mohammedanism, 27–28 ; Lammens, L’Islam, 44–45 [= Islām, 38] ; Cook, The Koran, 117 ; Sadeghi et Bergmann, « Codex », 364 ; Aʿẓamī, Ageless Qurʾan Timeless Text, passim ; Van Putten, « La grâce de Dieu », p. 272.
3 E. g., Weil, Historisch-Kritische Einleitung in den Coran, 46-54 ; Muir, La vie de Mahomet, 1 :xi–xiv ; Nöldeke, Geschichte des Qorâns, 204 ff.; Sprenger, Das Leben et die Lehre des Moḥammad, 1 : 58-59 ; Weil, Geschichte der islamischen Völker, 28-29 [= Une histoire des peuples islamiques, 32-33] ; Muir, Le Corân, 38-40 ; Nöldeke, Croquis, 49 ff.; Goldziher, Vorlesungen über den Islam, 203-4 [= Introduction à la théologie et au droit islamiques, 169].
4 Casanova, Mohammed, 103-42.
5 E. g., Margoliouth, Développement précoce, 37 ; Mingana et Lewis, Feuilles de trois anciens Qurâns, xx ; Caetani, Annali dell’Islam, 7 : 388-418 [= « ʿUthman et la recension du Coran »] ; Schwally, « Betrachtungen » ; Nöldeke et Schwally, Geschichte des Qorāns, 2:47 ff. [= L’Histoire du Coran, 251 ff.] ; Lammens, L’Islam, 44–45 [= Islām, 38] ; Jeffery, « Progrès dans l’étude du texte coranique », 7–8 ; Levi della Vida, « ʿOthmān b. ʿAffān », 1009, col. 2 ; Jeffery, Matériaux, 8 ; Nöldeke et al., Geschichte des Qorāns, 3:1 et suiv. [= L’histoire du Coran, 389 et suiv.] ; Gibb, Mahometanism, 49 ; Blachère, Introduction, 52 et suiv. ; Bell, Introduction, 42–43 ; Bell et Watt, Introduction de Bell, 42–44.
6 Jeffery, « Le texte de Ghevond », 298 n48 ; Blachère, Introduction, 75 ff., esp. 77-78, 90-91.
7 Abbott, L’essor de l’écriture nord-arabe, 47–49 ; Dietrich, « al-Ḥadjdjādj b. Yūsuf », 41.
8 Mingana, « La transmission du Coran selon les auteurs chrétiens » ; Crone et Cook, Hagarism, 18.
9 Nöldeke, Geschichte des Qorâns, 305 et suiv., notamment 307–8 ; Margoliouth, « Variations textuelles », 336, 339 ; Jeffery, « Le texte de Ghevond », 298 n° 48 ; Bell, Introduction, 43 ; Bell et Watt, Introduction de Bell, 47–48.
10 Wansbrough, Études coraniques, 43 et suiv.
11 Burton, Collection.
12 E. g., Crone, « Deux problèmes juridiques », 17–18 (dont n° 48) ; Hoyland, Seeing Islam, 550 (dont n° 26) ; Whelan, « Témoin oublié » ; Donner, Récits, int. et ch.1 ; Motzki, « Collection » ; Neuwirth, « Caractéristiques structurelles, linguistiques et littéraires », 100 ; Sinaï, « Quand le squelette consonantique du Coran a-t-il atteint sa clôture ? Partie 1 », 275 ; Van Putten, « La grâce de Dieu », 271 ; Sidky, « Régionnalité », 135–136 ; Tottoli, Le Coran, 3 ; Lindstedt, Muḥammad, 14 et suiv. 13 Pour quelques ouvrages récents, voir ci-dessous.
14 Modarressi, « Early Debates », 13–14 ; Schoeler, « Codification », 787. Voir aussi Welch, « al-Ḳurʾān : 3 », 405, col. 2.
15 Sadeghi et Bergmann, « Codex », 365–366 ; Sinaï, « Quand le squelette consonantique du Coran a-t-il atteint sa clôture ? Partie II », 509–510 ; idem, Le Coran, 46. Pour des points connexes, voir Hurgronje, Mohammedanism, 26–28 ; Kara, « Contemporary Shiʿi Approaches », 123–134. De manière moins directe, voir Donner, Narratives, intro.
16 Schwally, « Betrachtungen », 324–25 ; Sadeghi et Bergmann, « Codex », 365–66. De manière moins directe, voir Donner, Narratives, intro. D’une certaine manière, cela répond à la question soulevée dans Sinaï, « Partie II », 511 n7 : « Jusqu’à quand, au début du VIIIe siècle, pouvons-nous remonter avec certitude à l’hypothèse chiite selon laquelle le rasm standard a été promulgué par ʿUthmān ?» Sur la base des arguments de Schwally, Sadeghi et Donner, nous pouvons déduire que l’hypothèse chiite en question remonte à l’époque d’ʿUthmān lui-même. Cet argument s’appliquerait même si les sources chiites, ibadites, etc. obtenaient leurs rapports sur la canonisation ʿUthmānique de sources proto-sunnites comme al-Zuhrī : Il est inattendu que des sources anti-ʿUthmān acceptent et citent de tels rapports inopportuns ou controversés de leurs adversaires et rivaux, à moins que lesdits rapports ne soient au moins largement cohérents avec leurs propres mémoires communautaires sectaires (chiites, ibadites, etc.). Pour certaines sources chiites qui mentionnent ou citent des rapports sur la canonisation ʿUthmānique, voir Sulaym [attr.], Kitāb Sulaym, 210, 416 ; Ibn al-Aʿtham, Futūḥ, 2:407 ; Yaʿqūbī, Taʾrīkh, 2 : 196-97. Pour certaines sources ibāḍites qui mentionnent ou citent des rapports sur la canonisation ʿUthmānic, voir Barrādī, al-Jawāhir al-muntaqāh, 73 ; Qalhātī, al-Kashf wa-l-bayān, 2 : 210-11 ; Izkawi, Kashf al-ghummah, 2:160. Toutes ces sources ibadites, ainsi que le Mukhtaṣar conservé dans le Hinds Xerox, citent ou rédigent le Kitāb Ṣifat aḥdāth ʿUthmān, un ouvrage ibadite « oriental » qui « n’a probablement pas été écrit bien avant les années 150/770 ». Voir Crone et Zimmermann, The Epistle of Sālim, 189–90 (y compris n° 7). Pour une source khārijite (bien que consignée dans une source sunnite), voir Ṭabarī, Annales, 2e série, 1:516. Voir aussi Hagemann, The Khārijites in Early Islamic Historical Tradition, 126, 241. Pour d’autres rapports et déclarations hostiles recensés dans des sources sunnites, voir Schoeler, « Codification », 787 ; Sinaï, « Partie II », 511 ; Anthony et Bronson, « Did Ḥafṣah Edit the Qurʾān ? », 112.
17 Sadeghi et Bergmann, « Codex », 366 ; Sinaï, « Partie II », 510–11. Il ne s’agit pas ici de dire que toute la mémoire collective est vraie, mais plutôt qu’un fait d’une telle ampleur et d’une telle importance n’a pas pu être uniformément oublié et effacé dans de telles conditions.
18 Schoeler, « Codification », 787–88 ; Sinaï, « Partie II », 511–12 ; idem, Le Coran, 46–47. Voir également Margoliouth, Early Development, 37 ; Caetani, Annali dell’Islam, 7:409 ff. [= « ʿUthman et la recension du Coran », 382 ff.] ; Jeffery, Matériaux, 8 ; etc.
19 Schoeler, « Codification », p. 788.
20 Sadeghi et Bergmann, « Codex », 367-370. Pour les stemmates en question, voir Nöldeke, Geschichte des Qorâns, 242 n1 ; Nöldeke et al., Geschichte des Qorāns, 3:15 [= L’Histoire du Coran, 399-400] ; Cuisinier, «Stemma».
21 Sidky, « Régionnalité », notamment 182–183. Il convient de noter qu’il existe des rapports contradictoires concernant le consensus historique des savants musulmans concernant le nombre et la destination des maṣāḥif d’ʿUthmān. Par exemple, Makkī, Ibānah, affirme que l’opinion selon laquelle ʿUthmān a produit sept maṣāḥif est soutenue par davantage de transmetteurs que celle selon laquelle il en a produit cinq, tandis qu’al-Dānī, Muqniʿ, affirme que l’opinion selon laquelle ʿUthmān a produit quatre maṣāḥif – pour Médine, Syrie, Koufa et Bassorah, respectivement – est la plus solide et celle à laquelle adhère la majorité des savants. L’affirmation d’Al-Dānī est corroborée par al-Labīd al-Tūnisī, al-Durrah al-ṣaqīlah, 212-213, qui affirme que l’opinion correcte et bien connue est que seulement quatre maṣāḥif ont été produits, autres que le muṣḥaf privé de ʿUthmān ; et par Ḥusayn b. ʿAlī al-Rajrājī (cité dans Shirshāl, Dirāsah, dans Ibn Najāḥ, Mukhtaṣar, 1:139), qui affirme que l’opinion bien connue, à laquelle adhère la majorité des savants, est que ʿUthmān a produit quatre maṣāḥif (pour Médine, Syrie, Koufa et Bassorah, respectivement). Cela semble contredit par Ibn Ḥajar, Fatḥ al-bārī, 17:40, qui affirme que l’opinion bien connue est que ʿUthmān a produit cinq maṣāḥif ; mais cette contradiction est probablement illusoire. Si nous nous tournons vers al-Jaʿbarī, Jamīlat arbāb al-marāṣid, 1:369–70, qui opérait au Caire un siècle avant Ibn Ḥajar et dont les déclarations sur ce sujet pourraient ainsi éclairer les sources d’Ibn Ḥajar, nous trouvons un commentaire pertinent d’un célèbre poème d’al-Shāṭibī. Dans ce commentaire, al-Jaʿbarī précise que le poème d’al-Shāṭibī décrit la production par ʿUthmān de cinq maṣāḥif basés sur le ṣuḥuf de Ḥafṣah : (1) une copie privée pour lui-même ; (2) un exemplaire médinois ; (3) un exemplaire koufanique ; (4) un exemplaire basranien ; et (5) un exemplaire syrien. Par la suite, avec une note d’incertitude, le poème mentionne également : (6) un exemplaire mecquois ; (7) un exemplaire baḥrāni ; et (8) un exemplaire yéménite. Enfin, après avoir clarifié le poème, al-Jaʿbarī affirme que les cinq premiers exemplaires (c’est-à-dire les exemplaires médinois, syriens, koufaniques et basraniens, ainsi que la copie privée d’ʿUthmān) sont acceptés, tandis que les trois derniers (c’est-à-dire les exemplaires mecquois, baḥrāniens et yéménites) sont contestés. En bref, l’opinion majoritaire des savants islamiques classiques semble avoir été que ʿUthmān a produit quatre exemplaires régionaux. Il existait une certaine incertitude quant à la production d’un cinquième codex, mais s’agissant d’une copie privée destinée uniquement à ʿUthmān, elle est sans pertinence pour notre propos : la majorité des savants musulmans classiques semblent avoir admis que seuls quatre exemplaires régionaux (respectivement pour Médine, Syrie, Koufa et Bassorah) ont été produits, quatre copies publiques du Coran dans les principaux centres provinciaux, d’où s’est répandu le type de texte conventionnel. Il se trouve que ce point de vue semble également être attribué aux autorités les plus anciennes (Ibn Shabbah, Taʾrīkh, 3:997–998, citant Abū Muḥammad al-Qurashī ; Ibn Abī Dāwūd, Maṣāḥif, 34, citant Ḥamzah al-Zayyāt), ce qui renforce l’idée que le consensus découle d’une mémoire communautaire ancienne. 22 Sidky, « Régionalité », 171, 183.
23 Il convient toutefois de noter que ni Shoemaker ni Dye n’interagissent directement avec Schwally, Modarressi, Schoeler et Sadeghi sur ces points. Leurs réponses sont plutôt dirigées contre Welch, Donner et Sinai.
24 Dye, « Pourquoi et comment se fait-il un texte canonique ? », 72-73, 80 ; idem, « Le corpus coranique », 867-870 ; Shoemaker, Creating the Qurʾan, 34-35. Voir aussi idem, The Death of a Prophet, 156-158.
25 Shoemaker, Creating the Qurʾan, 37-38, 48-49, 59. Voir aussi De Prémare, Aux origines du Coran, 72-73 ; Shoemaker, La Mort d’un Prophète, 148, 158 ; Dye, « Pourquoi et comment se fait-il un texte canonique ? », 74 ; idem, « Le corpus coranique », 871.
26 Shoemaker, La Création du Coran, e. g., 17–18, 24 et suiv.
27 De même, Motzki, « Collection », 13 ; Sadeghi et Bergmann, « Codex », 366.
28 Cf. Shaddel, « Périodisation et le futūḥ ».
29 Je fonde cette affirmation sur les déclarations explicites de Schwally et al. à cet effet ; sur ma propre étude exhaustive de la littérature occidentale et arabe sur ce sujet ; et sur l’incapacité totale de sceptiques très motivés à identifier ne serait-ce qu’un seul contre-exemple convaincant. La chose la plus proche d’une exception que j’ai trouvée est une version déformée du « lien commun » du ḥadīth d’Abū Isḥāq sur la canonisation ʿUthmānic (c’est-à-dire une version déformée de celui-ci dans laquelle ʿUmar a été ajouté et ʿUthmān a été omis), discutée dans la deuxième partie de cet article.
30 Dye, « Pourquoi et comment se fait un texte canonique ? », 72 ; idem, « Le corpus coranique », 869 ; Cordonnier, Création du Coran, ch. 1.
31 De Prémare, Aux origines du Coran, ch. 4 ; Dye, « Pourquoi et comment se fait un texte canonique ? », 74-80 ; idem, « Le corpus coranique », p. 870-82 ; Shoemaker, Création du Coran, 29. Voir aussi Blachère, Introduction, 52 ff. ; Burton, Collection, ch. 7 ; Comerro, Les traditions sur la constitution du muṣḥaf de ʿUthmān ; Sinaï, « Partie II », 512 ; etc.
32 Voir la section sur Ḥ
33 Voir diversement Casanova, Mohammed, 109-10 ; De Prémare, Aux origines du Coran, 78-80 ; idem, « ʿAbd al-Malik », 201 ; Dye, « Pourquoi et comment se fait un texte canonique ? », 78 ; idem, « Le corpus coranique », p. 879-80 ; Cordonnier, Création du Coran, 26 ff. Cf. Ibn Saʿd, Ṭabaqāt, 2 : 343-44 (indirectement) ; ibid., 3 : 502 (y compris une version abrégée du « lien commun » du rapport d’Ibn Sīrīn, discuté dans la partie 2 de cet article) ; ibid., 5:233 (discuté ci-dessous). Cf. Voir également Fudge, « Le scepticisme comme méthode », 6.
34 Voir à nouveau la section sur Ḥ3–4, ci-dessous.
35 Par exemple, considérons l’enquête régionale et sectaire suivante attribuée au descendant abbasside Muḥammad b. ʿAlī (m. 125/744), dans anon., Akhbār, 206 : « Quant à Koufa et à la plaine alluviale [qui l’entoure], [les gens] y sont partisans de ʿAlī et de ses descendants. Quant à [les gens de] Bassorah et la plaine alluviale [qui l’entoure], [ils sont] partisans de ʿUthmān qui professent l’abstention [de la violence] et qui disent : « Sois un serviteur de Dieu qui est tué, plutôt qu’un serviteur de Dieu qui tue. » Quant à al-Jazīrah, [ses habitants] sont des Ḥarūriyyah renégats [c’est-à-dire des Khawārij], des Bédouins qui sont presque incroyants, et des musulmans qui ont un caractère [similaire] aux chrétiens. Quant au peuple de Syrie, il ne reconnaît personne [comme légitime personne] en dehors des Āl Abī Sufyān ; [ils sont caractérisés par] une obéissance aux Banū Marwān, et [par] une hostilité profondément enracinée envers nous, et [par] une ignorance croissante. Quant aux gens de La Mecque et de Médine, [une affinité envers] Abū Bakr et ʿUmar les a vaincus. » (Voir aussi Ibn Qutaybah, ʿUyūn al-akhbār, 1:204, et les sources citées dans Daniel, Khurasan, 63 n24, bien que ces dernières semblent toutes dépendre de l’anonyme Akhbār et/ou d’Ibn Qutaybah.) Bien sûr, cette étude ne survit que dans les sources de la période abbasside, mais les divisions clés qui y sont décrites existaient déjà vers 700 de notre ère. En d’autres termes, à l’époque d’Abd al-Malik et d’al-Ḥajjāj, il y avait déjà des chiites de diverses sortes à Koufa ; des proto-ibadites à Bassorah ; des Khawarijites dans diverses régions ; des ʿUthmāniyya non-omeyyades à Médine et Bassorah ; des Murjiʾah à Koufa ; etc. Voir notamment Crone, Medieval Islamic Political Thought, passim ; Wilkinson, Ibâḍism, ch. 5 ; Haider, The Origins of the Shīʿa.
36 Pour un exemple chiite, voir Yaʿqūbī, Mushākalat al-nās, 199–202. Pour un exemple de Khārijī, voir Crone et Hinds, le calife de Dieu, annexe 3. Pour des exemples abbassides, voir Ṭabarī, Annales, 3e série, 4 : 2175-76 (citant al-Muʿtaḍid bi-Llāh) ; Jāḥiẓ, Rasāʾil, 2 : 10-11. Pour d’autres exemples, voir Ṭabarī, Annales, 2e série, 2 : 1086-1087 (citant al-Shaʿbī et Saʿīd b. Jubayr) ; et 2e série, 3 : 1391-93 (citant Ḥasan al-Baṣrī). Pour une discussion de certaines de ces dernières sources, voir Donner, « Umayyad Efforts », p. 194-196.
37 Sadeghi et Bergmann, « Codex », 366.
38 Ibid. On pourrait objecter que, si les Omeyyades étaient plus faibles que les Abbassides, le gouvernement d’ʿUthmān l’était encore plus, ce qui rendait encore moins probable sa capacité à contrôler l’opinion et la mémoire musulmanes primitives. C’est sans doute vrai, mais aussi hors de propos : personne n’a prétendu qu’ʿUthmān ait imposé à la communauté musulmane primitive une fausse mémoire qui aurait éclipsé toutes les mémoires antérieures. En effet, s’agissant de l’opinion publique à l’époque d’ʿUthmān, les sources islamiques dressent un tableau résolument contrasté : le coran et d’autres auraient critiqué la canonisation d’ʿUthmān (voir U5, ci-dessus) ; certains habitants de Kufa ont activement résisté à ses efforts (voir Ḥ3–4, ci-dessous) ; et il existe même des accusations – dans les rapports chiites en particulier – selon lesquelles le texte de ʿUthmān était corrompu ou déficient (voir la discussion sur ¬Ḥ10, ci-dessous).
39 Van Putten, « La grâce de Dieu », 273.
40 Sidky, “Regionality,” 138, 182.



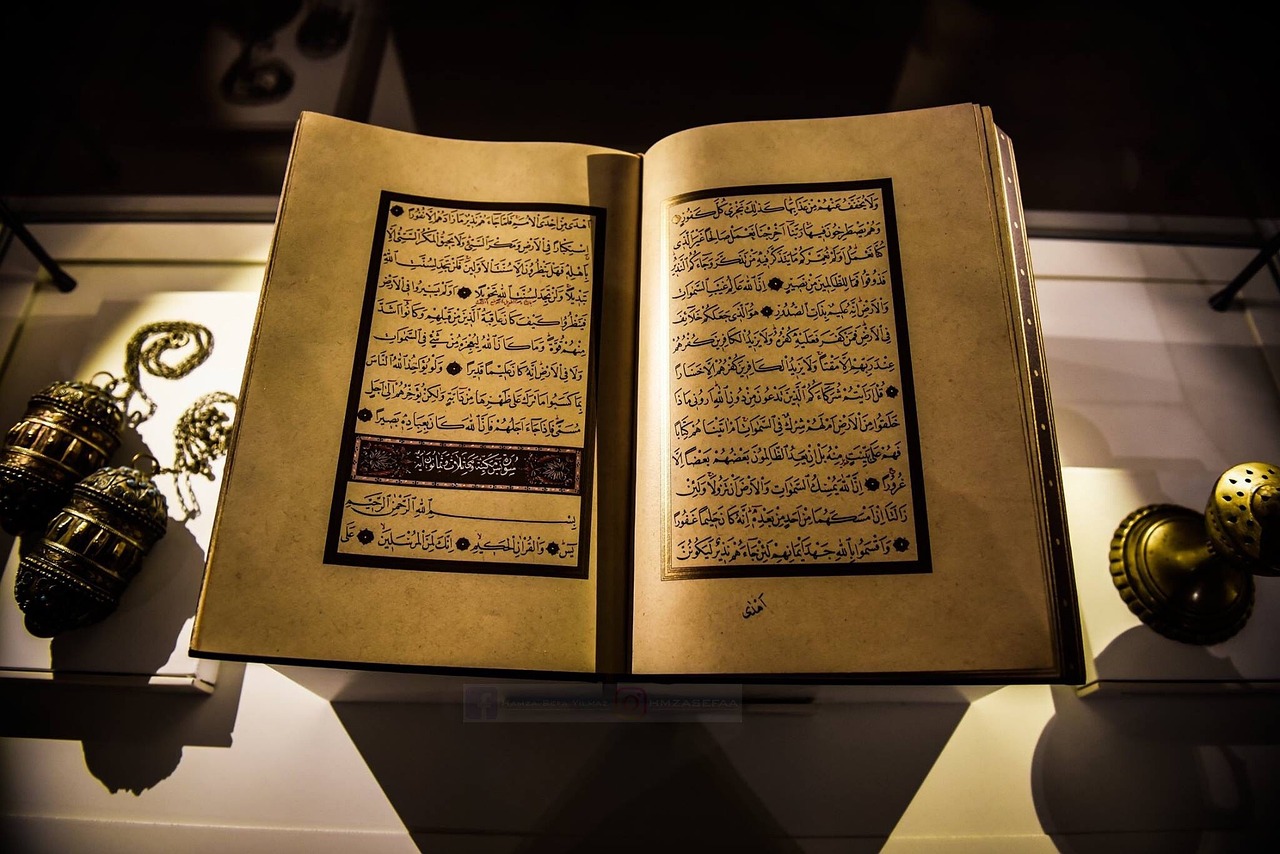
Une réponse
La transmission par écrit du Coran n’est qu’une des 2 voies de fixation du Texte, et la moindre (un simple support). Le « Coran » ne devient « Coran » que lors de son articulation psalmodiée (« Qur’ân » = « lecture »). La voie de transmission orale (la plus importante) est une piste de recherche éminemment intéressante et facilement testable à travers le monde aujourd’hui : perfection de la mémorisation, mais aussi de la psalmodie, étude des chaînes de transmission intergénérationnelle, des variantes acceptées etc. Nécessitant une immersion anthropologique de terrain.
Les résultats pourraient être ainsi mis en parallèle avec ce que rapporte la tradition musulmane : confrontation neutre en aval qui peut stimuler des débats passionnans. Le scepticisme radical en amont -justifiable en méthodologie- encourage encore trop souvent (dans la ligne de l’orientalisme fondateur) les tentatives vaines de démontrer systématiquement l’inverse de ce qui est rapporté par le consensus de la tradition en question, constituant alors le péché suprême des sciences humaines : le jugement de valeur, par la dénégation de principe de la fiabilité, voire de l’intégrité des acteurs initiaux de cette tradition (cf Max Weber).