Arslan Akhtar nous livre une belle réflexion dans cet article où il explore les connexions entre les travaux des logiciens Gödel et Lupasco et la perspective métaphysique de l’islam résolument unitaire.
Le XXᵉ siècle, souvent perçu comme celui du triomphe de la raison scientifique, a paradoxalement vu naître en son sein les pensées qui en ont révélé les limites internes.
Des logiciens comme Gödel ou Lupasco ont montré que la logique elle-même, lorsqu’elle se pousse à son extrême, finit par s’ouvrir sur l’inexprimable, sur un ordre de réalité que la raison ne peut enfermer.
Ce constat rejoint, sous une autre forme, la vision islamique du savoir, pour laquelle la raison est un instrument précieux mais subordonné à une vérité plus haute, celle de l’Unité divine (tawhid), principe d’où procède et vers lequel retourne toute connaissance.
La logique de la logique selon Gödel
Kurt Gödel (1906–1978) est considéré comme l’un des plus grands logiciens du XXᵉ siècle, car il a profondément bouleversé notre manière de comprendre la logique et les mathématiques.
En 1931, il formule ses célèbres théorèmes d’incomplétude, qui montrent qu’à l’intérieur de tout système logique assez puissant (comme celui des mathématiques), il existera toujours des vérités que ce système ne pourra pas démontrer par lui-même. En d’autres termes, la logique a ses propres limites, il y a des choses vraies que la “raison pure” ne peut pas prouver.
Gödel s’est aussi intéressé à des questions philosophiques et religieuses. Il voyait dans ses résultats logiques une preuve indirecte que la réalité ne se réduit pas à ce que l’on peut démontrer, et que certaines vérités pourraient dépasser le cadre des mathématiques ou de la raison humaine.
Il a même proposé une preuve logique de l’existence de Dieu, souvent appelée “preuve ontologique de Gödel”, s’inspirant des travaux du philosophe médiéval Anselme de Cantorbéry et du rationaliste Leibniz; Gödel a cherché à reformuler leur idée en utilisant le langage rigoureux de la logique mathématique moderne.
L’idée de base est la suivante : si l’on définit Dieu comme un être possédant toutes les propriétés positives possibles (comme la perfection, la bonté, la toute-puissance, etc.), alors il est logiquement nécessaire qu’un tel être existe. En effet, si l’existence est considérée comme une propriété positive, alors un être qui possède toutes les perfections doit aussi posséder l’existence.
Autrement dit, Gödel ne cherchait pas à prouver l’existence de Dieu par des arguments empiriques ou religieux, mais à montrer, à travers un raisonnement logique abstrait, que l’idée même d’un être parfait implique logiquement son existence, à condition d’accepter les définitions et les axiomes de départ.
Dans un certain sens, Gödel a fait pour la logique ce que d’autres penseurs et scientifiques ont accompli dans d’autres domaines au XXᵉ siècle, il a montré que la science n’épuise pas toute la réalité, et qu’il existe des limites à une vision purement matérialiste du monde.
En physique, des figures comme Albert Einstein, Niels Bohr ou Werner Heisenberg ont remis en question l’idée d’un univers entièrement déterministe. La relativité et la mécanique quantique ont montré que l’observateur, la probabilité et même le hasard jouent un rôle fondamental, ouvrant la porte à une vision du monde où tout n’est pas strictement mécanique.
En biologie, des penseurs comme Francisco Varela ont souligné que la vie ne se réduit pas à une machine chimique ; elle obéit à des principes d’organisation, d’information et de finalité que la seule matière ne suffit pas à expliquer. Certains biologistes y ont vu une dimension quasi spirituelle ou téléologique de la vie.
En logique et en mathématiques, outre Gödel, plusieurs chercheurs du XXᵉ siècle ont révélé les limites internes de la rationalité formelle : Alan Turing, en étudiant les machines et la calculabilité, a prouvé qu’il existe des problèmes que même un ordinateur idéal ne pourra jamais résoudre, soulignant ainsi les bornes du raisonnement algorithmique ; Alfred Tarski a mis en évidence que la notion de vérité ne peut pas être entièrement définie à l’intérieur d’un système logique donné, mais nécessite un niveau de langage supérieur; enfin, John von Neumann et Roger Penrose ont chacun, à leur manière, suggéré que la pensée humaine dépasse les processus purement mécaniques, ouvrant la réflexion sur une dimension non réductible à la matière ou au calcul.
Ensemble, ces travaux ont fait émerger une idée commune, selon laquelle la logique et les mathématiques ne sont pas closes sur elles-mêmes, mais pointent vers quelque chose de plus vaste, une dimension du vrai qui échappe à la pure formalisation, et que certains interprètent comme un espace pour le spirituel ou le transcendant.
Gödel et le musulman moderne
Gödel présente un intérêt particulier pour le lecteur musulman, non seulement parce que son œuvre porte en elle une dimension religieuse implicite, perceptible à travers ses réflexions sur les limites de la raison et la possibilité d’une vérité transcendante, mais aussi pour des raisons plus personnelles et biographiques.
En effet, seulement trois ans avant sa mort, Gödel fit une remarque significative, rapportée par le logicien Hao Wang (1921–1995), un de ses proches collègues à Princeton, dans son ouvrage A Logical Journey: From Gödel to Philosophy (1996, p. 148) :
4.4.3 I like Islam: it is a consistent [or consequential] idea of religion and open-minded. (J’aime l’islam : c’est une conception cohérente [ou logique dans ses conséquences] de la religion, et ouverte d’esprit.)
Cette phrase, brève mais remarquable, suggère que Gödel percevait dans l’islam une harmonie entre rationalité et foi, et peut-être une forme de cohérence interne qu’il recherchait lui-même dans sa philosophie et sa logique.
Cette formule est trop brève pour nous permettre de connaître précisément la vision que Gödel avait de l’islam. Cependant, on peut raisonnablement supposer que ce qui l’a attiré est l’idée centrale du tawhid, soit l’unicité absolue et transcendante de Dieu.
Cette notion, qui affirme que toute réalité procède d’un principe unique, souverain et rationnellement ordonné, aurait sans doute résonné avec la sensibilité philosophique de Gödel. En effet :
– Le tawhid propose une vision logiquement cohérente du monde, il unifie la multiplicité du réel sous un principe d’ordre et de sens. Pour un logicien attaché à la consistance interne des systèmes, cette unité fondamentale ne pouvait qu’éveiller son intérêt.
– Il met aussi en avant un Dieu rationnel et nécessaire, non arbitraire, un être dont l’existence fonde celle du monde, idée proche de la conception gödelienne de la nécessité logique et ontologique.
– Enfin, le tawhid refuse toute séparation radicale entre raison et foi, il affirme une cohérence intellectuelle du divin, ce qui rejoint la démarche même de Gödel, qui cherchait à penser Dieu à travers la rigueur logique plutôt qu’à travers la simple croyance.
Ainsi, si l’on suit cette hypothèse, ce que Gödel appréciait dans l’islam n’était pas seulement une tradition religieuse particulière, mais une structure rationnelle du divin, une conception où l’unité, la cohérence et la transcendance se rejoignent dans une même idée.
Bien sûr, on pourrait proposer une critique métaphysique de cette lecture de Gödel. En effet, le fait qu’il opère dans le cadre du formalisme mathématique le conduit à adopter une approche avant tout rationaliste, où la vérité suprême reste envisagée sous l’angle de la logique et de la cohérence interne des systèmes.
Or, dans la perspective de la métaphysique traditionnelle, telle qu’elle est comprise dans l’islam classique, la raison, si haute soit-elle, ne constitue pas le sommet de la connaissance. Elle n’est qu’un instrument subordonné à l’intellect pur (al-‘aql au sens métaphysique du terme), qui saisit directement les principes premiers.
Ainsi, là où Gödel cherche, à travers la logique, à entrevoir les limites du rationnel et à suggérer l’existence d’un ordre transcendant, l’islam traditionnel affirme d’emblée cet ordre comme réalité première, dont la raison n’est qu’un reflet partiel.
De ce point de vue, on pourrait dire que Gödel s’approche, sans le savoir peut-être, d’une intuition métaphysique universelle, mais qu’il la formule encore dans les catégories du formalisme moderne, plutôt que dans la plénitude symbolique et ontologique de la tradition métaphysique islamique.
Lupasco et le “tiers inclus”
Gödel n’est pas le seul logicien dont la pensée puisse intéresser un lecteur musulman. D’autres figures majeures de la logique et des mathématiques ont, chacune à leur manière, touché les limites de la raison formelle et ouvert la réflexion vers un horizon plus métaphysique. Whitehead, par exemple, après avoir fondé la logique symbolique avec Russell, a développé une vision organique du monde proche de l’idée d’une création continue (process creation).
Mais j’aimerais m’arrêter sur Stéphane Lupasco (1900–1988), logicien et philosophe d’origine roumaine naturalisé français, dont la pensée se situe à la croisée de la science, de la logique et de la métaphysique. Chercheur marginal mais visionnaire, il a proposé une refonte complète de la logique classique à travers son idée du “tiers inclus”, en opposition au principe du “tiers exclu” qui domine la logique depuis Aristote.
Dans la logique aristotélicienne, reprise et systématisée par Leibniz, le principe du tiers exclu stipule qu’entre une proposition et sa négation, il n’existe aucune troisième possibilité : une chose est ou n’est pas, A ou non-A. Ce principe a fondé la pensée rationnelle occidentale, orientée vers la distinction nette, la non-contradiction et l’identité absolue des concepts.
Lupasco, s’inspirant des découvertes de la physique quantique et des paradoxes du réel, a contesté cette structure binaire. Selon lui, la réalité n’obéit pas toujours à une logique d’exclusion mais souvent à une logique de complémentarité dynamique : à côté de A et non-A, il existe un état tiers, à la fois potentiel et actualisable, qu’il nomme le tiers inclus (T).
Autrement dit, A et non-A ne s’annulent pas, ils coexistent dans une tension vivante, et leur interaction engendre une nouvelle dimension de réalité. Cette idée est proche de ce que certaines traditions appellent l’unité des contraires, où les oppositions ne sont pas abolies mais résolues dans un plan supérieur de conscience.
Sur ce point, Lupasco rejoint indirectement des intuitions déjà présentes chez Héraclite (la lutte des contraires comme principe du devenir) ou chez certains métaphysiciens prémodernes comme Nicolas de Cues (coincidentia oppositorum). Il anticipe aussi des approches contemporaines en physique et en philosophie de la complexité, où l’opposition binaire ne suffit plus à décrire la réalité.
Pour un lecteur musulman ou métaphysicien, cette logique du tiers inclus évoque l’idée coranique de réalité en tension, entre visible et invisible, apparent et caché (zahir et batin), qui ne s’opposent pas mais s’unissent dans l’unicité divine (tahwid). Là où la logique classique découpe, Lupasco propose une logique du vivant, plus conforme à la dynamique du réel et à la nature paradoxale de l’existence.
La logique de l’Islam
Ainsi, qu’il s’agisse de Gödel ou de Lupasco, on retrouve une même intuition métaphysique : la raison humaine, lorsqu’elle explore jusqu’à ses propres limites, découvre qu’elle ouvre sur quelque chose qui la dépasse. Le premier, à travers l’incomplétude, révèle que toute logique renvoie à un ordre de vérité supérieur ; le second, par le tiers inclus, montre que la réalité elle-même excède la séparation rigide du vrai et du faux.
Or, cette reconnaissance d’un au-delà de la raison formelle trouve un profond écho dans la vision islamique du monde, où la réalité ultime ne se laisse jamais enfermer dans la dualité. Le Qur’an lui-même exprime cette tension vivante entre les contraires, unis dans l’Unité divine (tawhid).
Il est le Premier et le Dernier, l’Apparent et le Caché, et Il est savant de toutes choses.
(Sourate 57, verset 3)
Ce verset résume à lui seul ce que ni la logique de Gödel ni celle de Lupasco ne peuvent formaliser : la coïncidence des opposés en Dieu, où toute contradiction s’évanouit dans la plénitude de l’Être.
De même, le Qur’an rappelle :
Tout ce qui est sur elle [la terre] s’efface,
et subsiste la Face de ton Seigneur, Plein de Majesté et de Générosité.
(Sourate 55, versets 26–27)
Ici se clôt notre démarche : la raison, poussée à son extrême par les grands logiciens modernes, finit par rejoindre, sans le dire explicitement, le pressentiment de l’Unité absolue, que la révélation islamique affirme dès son origine.
Là où la logique touche à son seuil, la métaphysique, et avec elle la foi, reprend le flambeau de la connaissance.
Ce que la logique découvre à son terme, la révélation le dit à son commencement : il n’est de vérité qu’une, et toute multiplicité n’est qu’un reflet de l’Un, al-Haqq, la Réalité absolue.
Arslan Akhtar



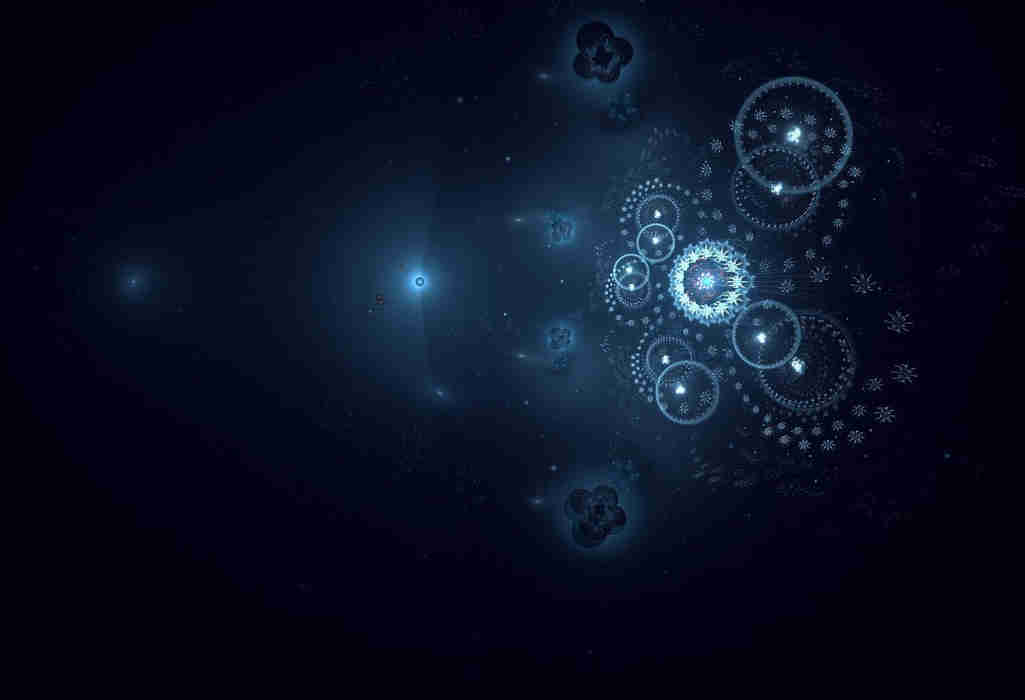
Une réponse
Oui! <>.
Cet article est très important car entre dans les profondeurs pour démontrer les limites de la science. Du reste, la science n’est-elle pas tirée des paroles divines?