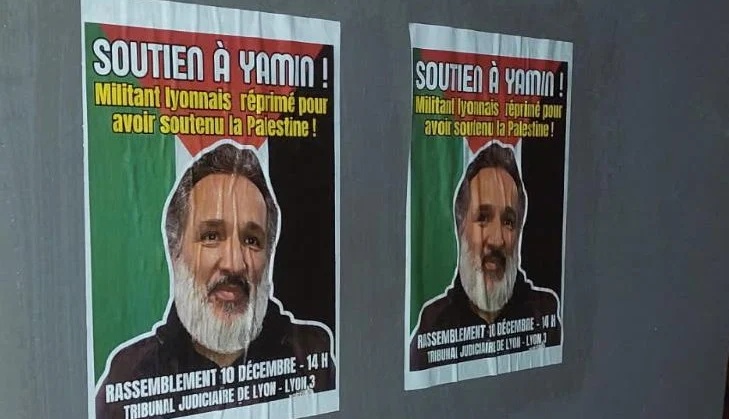Face aux défis de la modernité, la pensée islamique cherche à renouveler ses fondements éthiques. La rencontre entre le philosophe Taha Abderrahmane et le juriste médiéval Abū Isḥāq al-Shāṭibī éclaire cette quête. Un article en trois parties signé Eva Kepplinger.
Le nombre de voix qui appellent à des réformes dans différents domaines de la pensée islamique moderne est considérable. Les réformes sont jugées nécessaires afin de créer une pensée et une compréhension islamiques qui répondent aux besoins des musulmans dans le monde d’aujourd’hui et qui soient capables de relever les défis de la modernité d’un point de vue islamique.
Des chercheurs, tels que Khaled Abou El Fadl (2006, 269), estiment que pour pouvoir répondre de manière adéquate aux défis de la modernité, une nouvelle pensée éthique est nécessaire, et cette pensée devrait être le fondement d’autres disciplines comme le droit. Ce chapitre vise à étudier le concept éthique de l’iʾtimāniyya (dépôt de confiance) développé par le philosophe marocain Taha Abderrahmane.
La notion d’iʾtimāniyya se réfère au terme amāna (confiance, responsabilité) qui, selon de nombreux théologiens musulmans, renvoie à l’idée qu’avant le commencement de la vie sur terre, Dieu a proposé à toute la création d’accepter la responsabilité de vivre selon la volonté de Dieu sur terre. Tous ont décliné de porter ce fardeau, à l’exception de l’espèce humaine qui l’a accepté (ʿAbd al-Raḥmān 2012, 449).
Dans ce chapitre, les idées éthiques d’Abderrahmane concernant les êtres humains, leur relation avec Dieu et leur responsabilité éthique seront comparées aux idées d’un savant dont la contribution est aujourd’hui considérée comme indispensable dans la pensée juridico-éthique contemporaine, à savoir la pensée des maqāṣid (finalités) du savant andalou Abū Isḥāq al-Shāṭibī (m. 790/1388).
Les deux savants ont en commun de traiter, dans leur pensée, à la fois de l’éthique et du droit. Par conséquent, les idées du philosophe éthicien Abderrahmane, qui détient également certaines opinions dans la discipline de la théorie du droit islamique, seront comparées aux idées du juriste al-Shāṭibī, qui se concentre sur la théorie du droit mais qui a également des considérations éthiques.
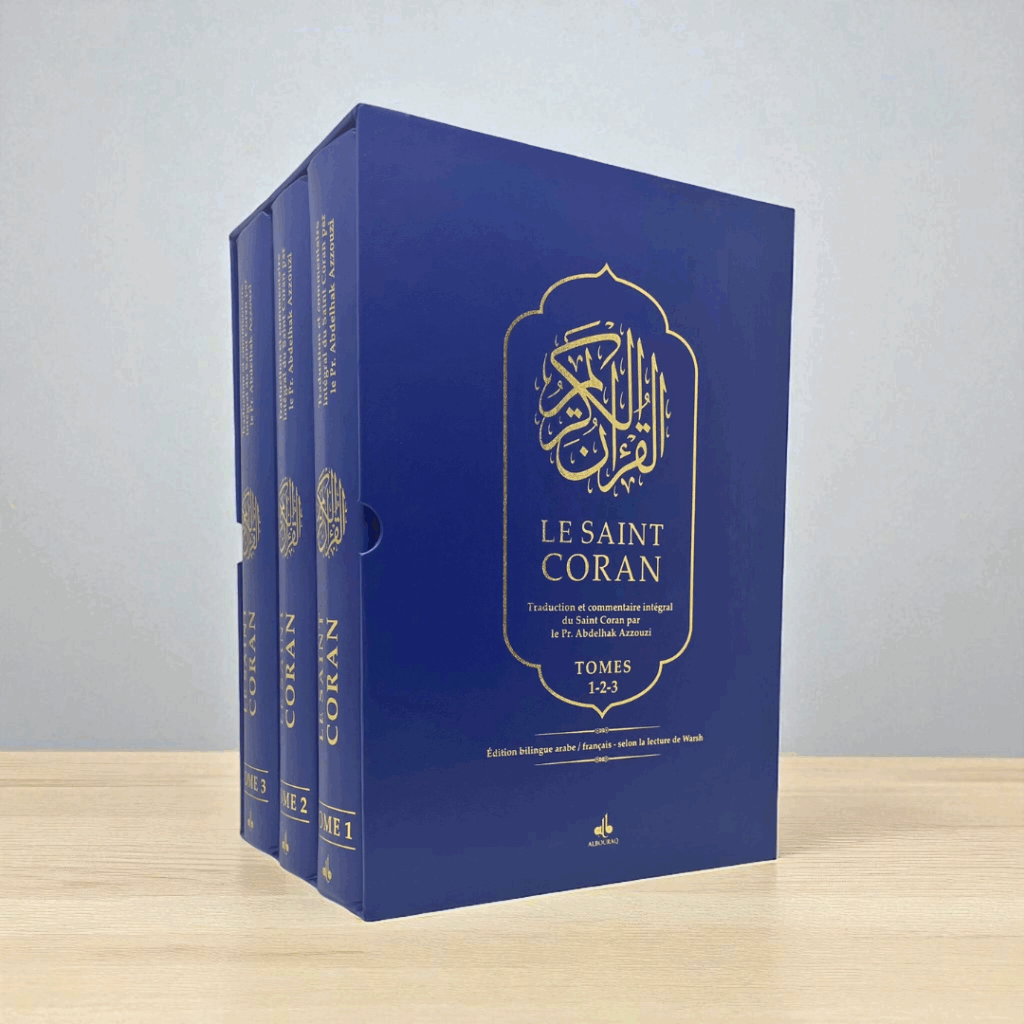
Ainsi, le chapitre vise d’abord à comparer les aspects éthiques du concept religio-philosophique de l’iʾtimāniyya avec les aspects éthiques des idées des maqāṣid d’al-Shāṭibī, afin de détecter les points communs et les différences dans la pensée des deux réformateurs.
Il vise également à comparer leur pensée juridique et celle des maqāṣid, et enfin à présenter des réflexions pour le débat actuel sur le rôle de l’éthique dans le droit, et plus précisément dans la pensée juridique, pour éviter d’assimiler la loi Sharia au droit positif moderne.
Ce résultat sera atteint après avoir suivi cette structure : d’abord, les biographies d’Abderrahmane et d’al-Shāṭibī seront présentées. Ensuite, un bref aperçu de la théorie de l’iʾtimāniyya et de la pensée des maqāṣid sera donné.
Suivra une discussion de la théorie de l’iʾtimāniyya concernant l’humanité et sa relation avec Dieu, qui sera ensuite commentée par les considérations éthiques d’al-Shāṭibī. Enfin, les aspects juridiques de la pensée d’Abderrahmane seront comparés à ceux d’al-Shāṭibī et les points communs des deux savants dans les domaines de la pensée juridique et des maqāṣid seront soulignés.
1 Taha Abderrahmane et Abū Isḥāq al-Shāṭibī : Un aperçu biographique
1.1 Taha Abderrahmane
En tant que philosophe éthicien, Abderrahmane appelle à un renouveau moral et spirituel dans le monde arabo-islamique. Ce renouveau devrait par conséquent être étendu au monde globalisé (Hashas 2015, 72). Il est convaincu du besoin mondial de plus de solidarité entre les religions, les peuples, les philosophies et les cultures.
Afin de réaliser sa vision de formuler un projet éthique de pensée, il travaille depuis 2000 à l’élaboration d’une théorie qu’il appelle iʾtimāniyya (paradigme de la déposition de confiance), ou al-naqd al-iʾtimānī (critique de la déposition de confiance). Les points centraux de sa pensée sont sa critique de la modernité occidentale séculière, l’esprit de la religion et sa pratique (Hashas 2015, 73).
Pour une compréhension adéquate de la théorie de l’iʾtimāniyya, un fait particulier semble central : l’affiliation d’Abderrahmane à l’ordre soufi marocain de la Boutchichiya. Cette affiliation pourrait être la raison de certains motifs soufis dans ses convictions personnelles et ses écrits, tels que le motif du cœur, de la purification, de la sincérité de l’intention, et une division binaire de l’existence entre le monde du visible et de l’invisible (Ben Driss 2002, 203).
Pour exprimer sa conviction de ce dernier, Abderrahmane parle d’al-ʿālam al-marʾī (le monde du visible) et d’al-ʿālam al-ghaybī (le monde de l’invisible). La purification de l’âme et du caractère est également un motif récurrent dans sa pensée, qu’il semble considérer comme un prérequis pour tout changement fondamental et positif.
Par exemple, lorsqu’il parle du cœur, il dit qu’il y a des choses dans l’univers qui ne peuvent être conçues qu’avec la baṣīra (clairvoyance spirituelle) et non avec le baṣar (la vue). Afin de former la baṣīra, les êtres humains ont besoin d’un entraînement et d’une éducation spirituels (Ben Driss 2002, 47).
Cet élément soufi se retrouve également dans les écrits d’Abderrahmane, comme lorsqu’il parle d’un éducateur (murabbī) qui devrait accompagner les gens dans leur développement spirituel et personnel.
1.2 Abū Isḥāq al-Shāṭibī
Le savant malikite Abū Isḥāq Ibrāhīm b. Mūsā b. Muḥammad al-Lakhmī al-Shāṭibī al-Gharnāṭī est né à Grenade, la capitale de la dynastie des Nasrides, où il fut enseigné par de grands savants tels qu’Ibn Lubb (m. 782/1380) et Abū ʿAbdullāh al-Maqqarī (m. 759/1358). Il est rapporté qu’il a agi en tant que prédicateur (khaṭīb) et en tant qu’Imam dans une mosquée et qu’il a également enseigné à la madrasa (université) de Grenade.
De son vivant déjà, il était considéré comme un savant renommé, connu pour sa connaissance profonde des disciplines de la jurisprudence islamique et de la langue.
À l’époque moderne, la renommée réclamée d’al-Shāṭibī revient principalement à son livre al-Muwāfaqāt, considéré comme une œuvre sans précédent qui a tenté de conceptualiser les intentions de la Sharia.
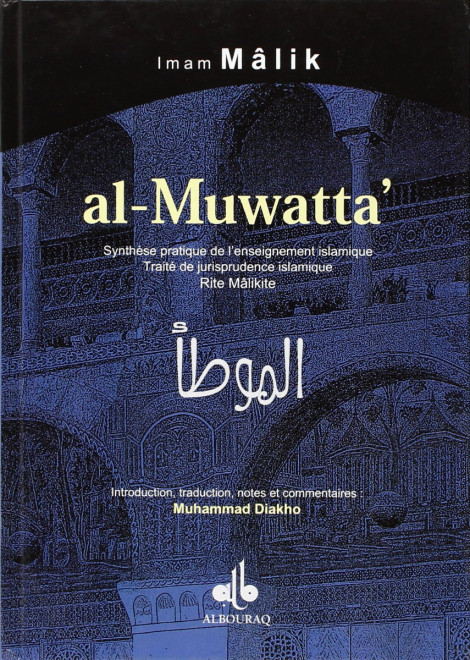
C’est particulièrement sa contribution dans le domaine des maqāṣid qui est intensément adoptée aujourd’hui. Aujourd’hui, son approche est considérée comme une réaction à certaines pratiques juridiques des juristes qui ne regardent pas les intentions possibles derrière les prescriptions divines.
Ses idées sur les maqāṣid sont vues comme exemplaires et nécessaires afin de répondre de manière flexible aux défis de la modernité. Outre ses avancées dans la pensée juridique, son intérêt pour les développements et changements sociaux est également apparent dans ses œuvres.
Par exemple, dans son livre al-Iʿtiṣām, il mentionne certaines pratiques soufies qu’il critique pour ne pas avoir de base théologique et d’explication pour leurs convictions et rituels spirituels spécifiques.
2 Iʾtimāniyya et pensée des Maqāṣid : Un aperçu
2.1 Le concept d’I’timāniyya
Ce concept paradigmatique représente un développement tardif de la pensée d’Abderrahmane, et nombre de ses premiers intérêts et engagements se retrouvent dans ce concept. Sa critique de l’hégémonie occidentale, son influence sur les développements intellectuels locaux, le matérialisme occidental, le sécularisme, sa tentative d’élaborer un concept philosophico-éthique islamique, son intérêt pour le langage, sont tous des thèmes et sujets qui se trouvent en arrière-plan de la théorie de l’iʾtimāniyya d’une manière ou d’une autre.
L’idée de ce concept est construite sur la conviction coranique que les êtres humains ont accepté l’amāna (confiance ou responsabilité) d’être des lieutenants sur terre de la part de Dieu, qu’Il avait offerte à toutes les créatures et qui n’ont pas été capables de la maintenir ou de l’exécuter.
En l’acceptant, les humains ont également accepté les conséquences de la décision : la responsabilité d’agir selon la volonté de Dieu sur terre. Le concept est également fondé sur l’idée que cette vie et le monde de l’invisible (al-ʿālam al-ghaybī) sont connectés et que les êtres humains y sont connectés à travers leurs besoins spirituels ainsi que leurs actes. Abderrahmane conclut qu’en raison de l’interconnexion entre ce monde et le monde de l’invisible, aucune séparation n’est censée être établie entre les affaires mondaines et la spiritualité (ʿAbd al-Raḥmān 2012, 449).
Avec l’iʾtimāniyya, Abderrahmane entend présenter un contre-projet philosophique à la vision du monde occidentale séculière et matérialiste. Il critique les dichotomies qui caractérisent la pensée occidentale, telles que religion vs. politique, divin vs. séculier, physique vs. métaphysique. Abderrahmane vise à surmonter cette dichotomie (Hashas 2015, 67).

Selon lui, cette catégorisation et cette manière de pensée réductionniste mènent à un dilemme moral et à plusieurs formes d’injustice. Il comprend sa philosophie comme globale et elle comprend quatre composantes : la révélation, la raison, l’éthique et l’action (ou la pratique). Afin de travailler à l’élaboration d’une philosophie islamique contemporaine, ces composantes ne sont pas censées être séparées et leur force centripète est essentiellement éthique (Hashas 2015, 67).
Contre la mondialisation de la pensée dichotomique occidentale, il considère comme essentiel que chaque culture soit autorisée à générer sa propre philosophie (voir ʿAbd al-Raḥmān 2005). L’iʾtimāniyya devrait être la philosophie produite par le monde arabo-islamique.
L’aspiration de l’iʾtimāniyya est une philosophie de vie qui convient à chaque personne et que chacun peut pratiquer. Au niveau global, on espère qu’à travers l’iʾtimāniyya, une société pacifique, respectueuse et juste puisse être établie (Hashas 2015, 104).
2.2 La pensée des Maqāṣid d’Abū Isḥāq al-Shāṭibī
Les circonstances juridiques et sociales complexes à l’époque d’al-Shāṭibī exigeaient une nouvelle approche afin de trouver des réponses profondes aux questions de l’époque. Al-Shāṭibī était d’avis qu’il était nécessaire de réfléchir à de nouvelles approches dans la discipline de la jurisprudence et d’essayer de cerner le(s) but(s) des ordres divins. Une fois dévoilés, la loi devrait être formulée selon ces découvertes.
Les questions qui étaient importantes pour ses réflexions étaient les suivantes : « Quelles sont les intentions de Dieu lorsqu’Il révèle la Sharia ? » et « Les êtres humains peuvent-ils savoir avec certitude ce que la Sharia attend d’eux ? » Après avoir étudié les sources islamiques, il était convaincu que Dieu vise à réaliser les intérêts des êtres humains et que la Sharia entend protéger les valeurs suivantes, que des savantss antérieurs de l’Islam ont développées.
Une fois que les buts de la Sharia sont reconnus, tout ijtihād ultérieur doit être conforme à ce principe et la loi doit être formulée en conséquence (Rifāʿī 2004, 238). Si cela n’est pas fait, l’interprétation de la révélation sera restreinte au texte et sera donc séparée de la réalité des affaires humaines (Rifāʿī 2004, 32).
Al-Shāṭibī a présenté ses idées conceptualisées sur la loi dans son œuvre en plusieurs volumes al-Muwāfaqāt. Un volume s’intitule Kitāb al-maqāṣid dans lequel il parle de deux catégories principales de maqāṣid : celles de Dieu et celles du mukallaf, c’est-à-dire la personne religieusement responsable (rationnelle et adulte) (al-Shāṭibī 2006, 7f.).
Il a de nouveau divisé la première catégorie principale en quatre sous-catégories, mais il n’a pas catégorisé la deuxième catégorie principale. Il a appelé la première sous-catégorie l’intention du législateur divin en révélant la Sharia (qaṣd al-shāriʿ fī waḍʿ al-sharīʿa).
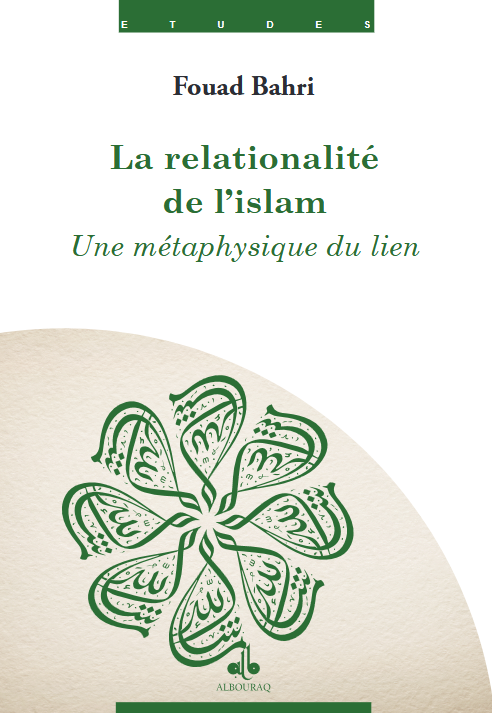
La deuxième intention du législateur divin est qu’elle puisse être comprise par les gens (qaṣd al-shāriʿ fī waḍʿ al-sharīʿa lil-ifhām). La troisième est l’intention de l’obligation envers les commandements de la Sharia (qaṣd al-shāriʿ fī waḍʿ al-sharīʿa lil-taklīf bi-muqtaḍāhā). La quatrième intention est la soumission du mukallaf sous les règles de la Sharia (qaṣd al-shāriʿ fī dukhūl al-mukallaf taḥt aḥkām al-sharīʿa).
Dans la deuxième catégorie principale, al-Shāṭibī parle de l’intention du mukallaf concernant le taklīf (qaṣd al-mukallaf). Le traité d’al-Shāṭibī sur les maqāṣid est devenu très apprécié à l’époque moderne et est considéré comme une théorie par certains savants comme Aḥmad al-Raysūnī (1428/2007), et un thème central dans le discours actuel sur les maqāṣid et le droit.
3 Le concept éthico-philosophique de l’Iʾtimāniyya : Un dialogue entre Abderrahmane et al-Shāṭibī
3.1 L’humanité dans le paradigme de l’Iʾtimāniyya
Le concept de l’iʾtimāniyya suppose que les êtres humains sont une créature spéciale qui diffère fondamentalement du reste de la création. La raison en est qu’ils consistent en deux existences : un corps créé, mortel et une âme immortelle. C’est le corps mortel qui connecte les êtres humains à cette vie (ou : la vie du visible, al-ʿālam al-marʾī).
Dans ce monde, le corps et l’âme se connectent. L’autre monde, le monde de l’invisible, al-ʿālam al-ghaybī, les êtres humains y ont accès uniquement par l’âme (ʿAbd al-Raḥmān 2017, 34).1
Différemment d’Abderrahmane, al-Shāṭibī n’utilise pas des termes tels qu’al-ʿālam al-marʾī, mais il utilise des notions courantes comme cette vie (dunyā) et l’au-delà (ākhira). Il croit que cette vie est éphémère et que l’au-delà dure éternellement. Contrairement à son âme, le corps humain est mortel. Les gens doivent être conscients du fait que cette vie ne dure pas éternellement et qu’ils feraient donc mieux de passer leur temps sagement et de suivre leur religion pour être heureux dans cette vie et dans l’au-delà (al-Shāṭibī 2006, 32).
Parce que l’être humain unit deux réalités : le mortel-sensible (c’est-à-dire le corps) et l’immortel et non-sensible (c’est-à-dire l’âme), Abderrahmane appelle les êtres humains un être d’existence à double dimension (muzdawaj al-wujūd). Mais même lorsque les êtres humains vivent leur vie dans ce monde éphémère, il leur est possible de garder la connexion avec le monde immuable.
Cela est possible parce que, selon Abderrahmane, les êtres humains ont été créés avec une fiṭra. Alors que ce concept islamique est généralement traduit par la nature naturelle donnée par Dieu aux êtres humains, Abderrahmane l’interprète comme une expression d’une mémoire particulière (dhākira sābiqa) des êtres humains.
Cette mémoire particulière signifie que les gens, d’une manière ou d’une autre, se souviennent qu’ils ne consistent pas seulement en un corps mais aussi en une âme et que leur vraie patrie n’est pas ce monde. Puisqu’Abderrahmane suppose que les êtres humains sont plus que de la matière mais qu’ils ont aussi la fiṭra donnée par Dieu, il conclut que la religion est un composant fondamental et indivisible de la vie humaine (ʿAbd al-Raḥmān 2012, 52).
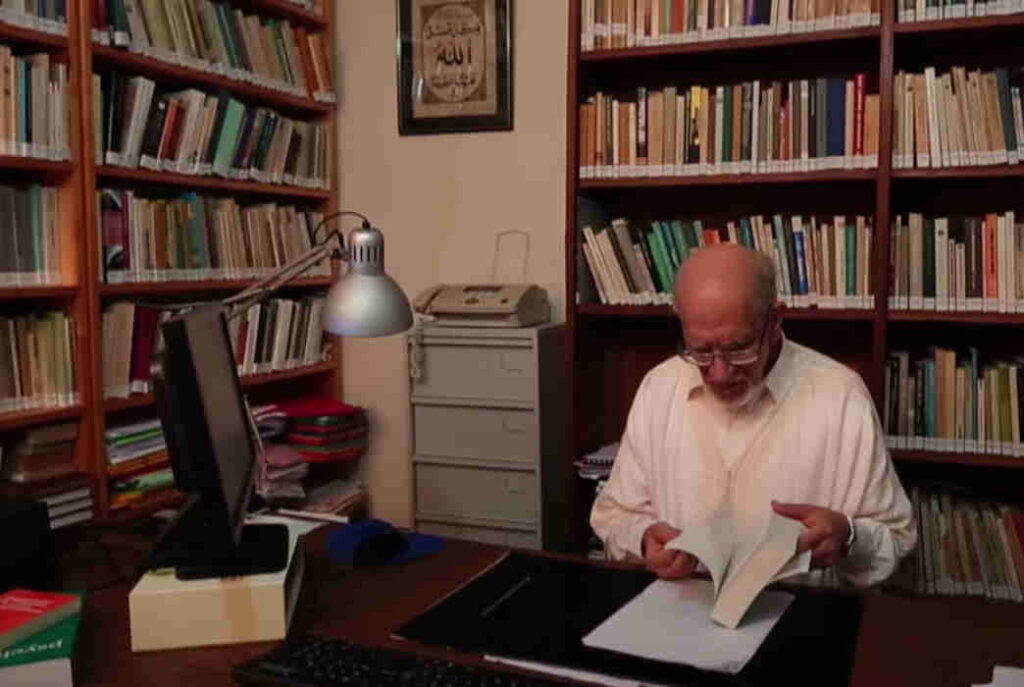
D’une part, Abderrahmane est convaincu de l’existence de cette mémoire particulière, mais il dit, d’autre part, que les êtres humains sont des êtres très oublieux qui oublient à qui ils doivent leur existence et leur subsistance. De plus, le philosophe dit que les êtres humains ont souvent tendance à oublier la particularité de leur création. Cela arrive à cause de la convoitise, de l’égoïsme et de la soif de pouvoir et de souveraineté des gens (ʿAbd al-Raḥmān 2012, 14).
Pour protéger les gens de leur oubli, l’iʾtimāniyya offre aux êtres humains un mode de vie qui diffère de la vision matérialiste occidentale. Elle aide les gens à se souvenir de leur position extraordinaire dans la création et leur rappelle que, selon la vision islamique, le progrès et la vraie productivité ne sont pas représentés par l’accumulation de biens et par la réalisation d’intérêts mondains ; cette vie devrait être avant tout une quête d’amélioration morale (ʿAbd al-Raḥmān 2012).
Si la vision du monde des gens est étroite à cause de la vue dominante exclusivement matérialiste, l’iʾtimāniyya est supposée élargir la vision que les gens ont d’eux-mêmes et du monde en général. Parce que cette vie et le monde de l’invisible sont connectés par la philosophie de vie de l’iʾtimāniyya et parce qu’un lien entre les activités mondaines et la spiritualité et la relation avec Dieu est établi à travers cette éthique de l’amāna, Abderrahmane déclare son interprétation de l’Islam comme une philosophie englobante, qui comprend tous les aspects de la vie humaine (Abderrahmane 2008, 87).
Différemment d’Abderrahmane, al-Shāṭibī ne mentionne pas de concept éthique particulier. Mais le savant parle de l’idée islamique de la nafs (âme appétitive) des gens qui doit être contrôlée. Si cela n’est pas fait, ils suivent leurs désirs et leur convoitise, dévient du chemin d’Allah et nuisent à leur vie dans les deux mondes (al-Shāṭibī 2006, 292).
Pour éviter cela, la dunyā (vie) devrait être comprise comme un moyen d’obtenir le salut dans l’au-delà et non comme un but de satisfaire tous les besoins éphémères (al-Shāṭibī 2006, 63). Bien qu’Abderrahmane et al-Shāṭibī aient des approches différentes de la question, ils arrivent à la même conclusion : il est clair que la nafs doit être contrôlée et que la religion, la spiritualité et le salut sont ce que les êtres humains doivent rechercher afin de jouir du bonheur dans ce monde et dans l’au-delà.
Eva Kepplinger