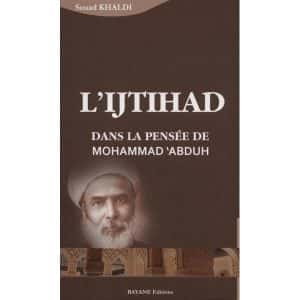Un des points centraux de la pensée islamique contemporaine tourne autour de l’idée qu’il faudrait « rouvrir les portes de l’ijtihâd » (effort de réflexion) progressivement fermées par l’establishment religieux. Partout dans le monde, y compris en France, savants et intellectuels musulmans appellent à mettre fin à la sclérose intellectuelle dont souffrirait l’Islam depuis plusieurs siècles. Cependant, par bien des aspects, les notions de « fermeture des portes de l’ijtihâd » et de déclin intellectuel sont en réalité des légendes – au sens étymologique – nées dans les cercles orientalistes et salafis, comme plus de trois décennies de recherches historiques et islamologiques le montrent[1]. Un article exclusif de Daoud Riffi, professeur agrégé et chercheur en histoire du monde arabe, que Mizane.info publie en deux parties.
Chaque manifestation de rigidité ou d’inadaptation à la modernité de la part de musulmans suscite le retour d’une injonction récurrente : il faut « rouvrir les portes de l’ijtihâd », afin de sortir la communauté musulmane de la sclérose intellectuelle dans laquelle elle aurait lentement sombré.

Quand l’ijtihâd a-t-il été fermé, quand le déclin intellectuel a-t-il commencé ? Pour des intellectuels musulmans ou des orientalistes, tel Joseph Schacht, le 9e siècle serait la date « de fermeture ».
Le déclin commencerait ainsi quant à lui dès le 10e siècle.
L’idée qu’un déclin intellectuel fut provoqué par « la fermeture des portes de l’ijtihâd » n’est pas nouvelle : elle est théorisée au 19e siècle par les orientalistes et les intellectuels arabes de ce qu’on appelle la « Renaissance arabe » (Nahda).
Des intellectuels qui tentent de trouver une réponse à la question qui revient sans cesse alors, telle une antienne : « Pourquoi les musulmans sont-ils en retard, et pourquoi les non-musulmans sont-ils en avance ? »[2]
Traumatisés par les multiples défaites militaires subies par l’Empire ottoman depuis la fin du 18e siècle, constatant sa crise économique et son retard technique par rapport à l’Europe, atterrés par la colonisation qui morcelle les terres de l’Oumma, ces intellectuels de la Nahda vont penser la crise.
Califat ottoman (car dégénéré), juristes (car bornés) et soufis (car hérétiques) sont identifiés comme la cause du mal, symbolisé par une plaie à laquelle tous auraient contribuée : la sclérose intellectuelle, entamée par la fin de la réflexion dynamique (ijtihâd) qui permettait d’extraire des Sources scripturaires (Coran et Ḥadîth) la vérité qui s’y cache.
La pensée moderniste des leaders de la Nahda ainsi que son « paradigme du déclin » seront intégrés, dès la fin du 19e siècle, au sein d’une famille hybride destinée à de multiples ramifications : la salafiyya[3].
Intellectuels de la salafiyya – tel Rashîd Ridâ (m. 1935) – et orientalistes vont ainsi s’entretenir mutuellement dans l’idée que, depuis le 10e siècle, le monde musulman a entamé sa nuit intellectuelle, son « Moyen Âge », au sens propre d’âge moyen et tampon entre un Âge d’or passé et un avenir radieux.
Le préjugé négatif des intellectuels arabes sur la période ottomane – perçue comme période-clef du déclin, à tous les niveaux – entre en résonnance avec un autre apriori, colonial celui-ci, en partie issu de l’orientalisme pictural : l’Orient est un espace à la fois fantasmé et méprisé, perçu comme passif et arriéré.
L’Orient musulman est une ruine ; il dort sur un trésor englouti depuis des siècles, dont les joyaux intellectuels, en particulier andalous, paraissent un monde éteint.

Ce lieu commun orientaliste de la passivité va paradoxalement nourrir l’image que des générations d’intellectuels musulmans auront de leur propre civilisation, entraînant l’histoire de la pensée islamique dans un cercle vicieux de méprise quant à sa profondeur réelle : le mythe du déclin intellectuel est l’enfant de cet improbable couple occidental/oriental.
Depuis la fin des années 1970 on assiste cependant à un renouvellement historiographique vivifiant qui revisite les conclusions plus anciennes.
Celle de « fermeture de l’ijtihâd », et son corollaire du déclin intellectuel, en font partie.
Paradoxe : c’est l’Université occidentale qui revalorise le patrimoine historique de l’Islam dans un sens favorable (y compris pour des périodes tardives) alors que la plupart des intellectuels musulmans sont encore marqués par l’ancien paradigme du déclin.
Après plus de trente ans de recherches, on constate ainsi que les conclusions proposées par les multiples études de cas, monographies, éditions et traductions de textes n’ont finalement pas davantage pénétré la sphère intellectuelle des musulmans que leur base[4].
Après un rapide passage en revue de la nature de l’ijtihâd, mon propos sera donc de livrer une brève synthèse des recherches académiques – historiques et islamologiques – afin de démontrer (1) que la fermeture de l’ijtihâd est une légende ; (2) que la notion de sclérose (ou de déclin) intellectuelle du monde musulman est une fiction répondant à un agenda théologique, social et politique ; et (3) que l’idée selon laquelle l’usage de l’ijtihâd serait une condition du dynamisme intellectuel et du progrès est une illusion, fruit d’un préjugé moderne hérité du 19e siècle.
1- L’ijtihâd : nature, fondements, conditions
Les Sources islamiques (Coran, Ḥadîth) ne constituent pas un manuel de Droit ou de théologie : prescriptions, recommandations, interdictions sont disséminés dans des textes variés et épars.
De ces Sources les savants spécialisés ont extrait des règles – théologiques, juridiques ou spirituelles – qui relèvent tantôt de la loi explicite et à portée universelle, tantôt du principe général mais non explicite, tantôt même d’énoncés soulevant le doute quant à leur statut normatif.
Ces Sources, par leur structure même, prêtent en effet à divergences d’interprétations.
D’abord par les défis que posent la langue arabe : absence de voyelles et même de points diacritiques (dans les premiers siècles), grande polysémie du vocabulaire (les mots sont en fait des racines porteuses de sens variés), caractère dense et très elliptique des expressions, etc.
Ensuite parce que les Textes ne sont pas univoques : contradictions apparentes, fragments qui se complètent ou au contraire se restreignent les uns les autres … déterminer un statut juridique à partir d’un verset/ḥadîth n’est pas toujours chose aisée.
À partir de ces Sources les savants vont donc extraire un ensemble de règles (ḥukm, pl. aḥkâm) ou de preuves et indices (dalîl, pl. adilla) menant aux causes (‘illa, pl. ‘ilal) de ces règles.

Mais l’époque de la révélation coranique n’est pas similaire aux autres époques, de même que les réalités quotidiennes de l’Arabie ne sont pas celles d’autres contrées.
L’extension géographique de l’empire islamique et l’avancée dans l’histoire vont créer des situations inédites non explicitement évoquées dans le Coran et la tradition prophétique, ce qu’on appelle « le silence du Législateur » (c’est-à-dire Dieu et son Prophète).
C’est alors qu’intervient le travail de réflexion afin de tirer une règle d’un Texte ou de trouver une issue à une situation inconnue du vivant du Prophète : c’est l’ijtihâd.
La racine du mot [j-h-d] – la même que celle du mot jihâd – comprend le sens d’effort soutenu, qu’il soit spirituel ou physique (le jihâd), ou encore intellectuel (l’ijtihâd) ; le mujtahid étant celui qui mène cet effort intellectuel.
Le fondement légal de l’ijtihâd est traditionnel : des ḥadîth-s en parlent, notamment le célèbre récit où le Compagnon Mu‘âdh Ibn Jabal, envoyé par le Prophète au Yémen, explique à ce dernier que dans ses jugements, en l’absence de réponse probante dans le Coran et la Sunna prophétique, il mènera un effort de réflexion pour trouver le bon jugement.
L’ijtihâd relève ainsi de l’obligation collective[5] (fard kifâya) : il doit être mené afin d’éclairer le sens du Coran et de la Sunna.
Mais cette obligation de réflexion n’est pas une obligation de résultat : un ḥadîth stipule ainsi que celui qui mène un ijtihâd mais se trompe reçoit une récompense de Dieu ; s’il a raison, il en a deux.
À la mort du Prophète certains Compagnons disséminés géographiquement vont agréger autour d’eux des disciples qui recevront leurs enseignements.
De ces Compagnons et disciples vont progressivement émerger des Écoles théologiques, juridiques et spirituelles[6] dont l’objet est de fournir un ensemble de clefs rigoureuses ouvrant l’accès à une méthodologie d’extraction de règles permettant de gérer la diversité des Sources, et donc des interprétations.
L’ijtihâd, à la fois cause et conséquence de la divergence (ikhtilâf), se devait de reposer sur un ensemble de règles strictes afin de réduire la portée des conflits tout en permettant à la variété d’avis de pouvoir coexister.
Au cours des siècles se cristalliseront donc autour des Écoles, fondées par un Imam[7], une théorie légale (usūl al-fiqh) et un droit positif, offrant aux fidèles un système complet permettant à chacun de suivre les avis juridiques fondés sur les Sources.
Le croyant, incapable par lui-même de tirer des statuts légaux à partir des Textes, suit donc les avis de son École : c’est le taqlîd, l’imitation.
Il faut préciser ici le fait qu’une École n’est pas une doctrine figée et uniforme : elle est un ensemble d’outils permettant de gérer les divergences, mais sans y mettre fin.
Dans tous les domaines – depuis les rites quotidiens jusqu’aux questions sociales – la divergence demeure au sein d’une même École, ce qui donne au fiqh une variété et donc une grande flexibilité et adaptabilité.
On comprend ainsi que l’ijtihâd apparaît très tôt comme un instrument incontournable pour comprendre la loi (fiqh al-shar’îa), comme le résume le savant de l’École chaféite, Shîrâzî (m. 1083) : « Le fiqh, c’est la connaissance des statuts légaux dont la voie [de connaissance] est l’ijtihâd »[8].
On devine ici que « la fermeture » d’un tel instrument – qui est même une obligation légale, on l’a vu – puisse apparaître, aux yeux des oulémas, pour le moins problématique.
On distingue plusieurs niveaux d’ijtihâd, mais deux nous intéressent plus particulièrement : l’ijtihâd absolu et indépendant de toute École (mutlaq) ; l’ijtihâd réalisé dans le cadre d’une École (muqayyad).
Le premier niveau, le plus haut, hisse celui qui le pratique au rang des fondateurs d’Écoles, tels les Imams précités ; tandis que le second niveau assure au mujtahid la capacité à émettre des avis inédits en usant des règles de son École, ou éventuellement d’une autre.
Soulevons d’emblée une confusion dans les débats contemporains : lorsque les auteurs réformistes discutent de la réouverture de l’ijtihâd, le niveau de ce dernier n’est jamais évoqué ; c’est là une source d’erreurs et de mésinterprétations majeures, comme nous le verrons.
Dans les faits, malgré certaines velléités plus oratoires que concrètes[9], c’est toujours un ijtihâd ayant recours à un avis existant déjà dans une des Écoles que choisissent les penseurs réformistes, ce qui montrent que la critique contemporaine d’une faiblesse intellectuelle passée s’appuie, paradoxalement, sur ce que ce passé a produit comme ijtihâd…
Et de même : on doit distinguer l’ijtihâd absolu (qui demande la recréation d’une superstructure intellectuelle et technique) de l’ijtihâd en tant que tel (le fait d’appréhender des cas nouveaux en s’appuyant sur une méthodologie de raisonnement préexistant ou non) ; la nuance est de taille, j’y reviendrai.
2- La « fermeture de l’ijtihâd » : une double impossibilité
La « fermeture » pose avant tout deux problèmes : c’est d’abord une « impossibilité technique » ; ensuite une erreur factuelle.
Impossibilité technique au sens où les sciences islamiques traditionnelles exclues la possibilité même de « fermer » l’ijtihâd ; erreur factuelle, car cela contredit l’histoire intellectuelle du monde musulman. Deux points que nous allons aborder ici.
« Impossibilité technique » d’abord. Parler de « fermeture des portes de l’ijtihâd (insadda bâb al-ijtihâd) » soulève d’emblée quatre questions : la cause de la « fermeture » ; la date présumée retenue (qui doit donc reposer sur un fait) ; l’identité de celui/ceux qui l’ont déclarée ; l’acceptation, par les autres oulémas, de cet état de fait (c’est-à-dire le consensus autour de ladite fermeture).
Or les partisans de la thèse n’avancent aucune réponse à ces questions, sauf une (la première) : la fermeture est toujours annoncée comme un fait sans origine (ni date, ni acteur ; mais pour cause : il n’y en a pas) réputée consensuelle, sans qu’aucune preuve ne soit apportée.
La cause identifiée serait la fossilisation juridique : les savants, à un moment de l’histoire, cessèrent de penser pour se contenter d’imiter (al-taqlîd).
Impossibilité technique donc : j’ai rappelé que l’ijtihâd est assimilé à l’idée même de charia : pour les usulistes (uṣûliyyine, spécialistes des uṣūl-s : fondements du droit), l’ijtihâd est une obligation collective (fard kifâya) qui doit obligatoirement être assumée par au moins une personne dans la Communauté, sous peine de deux choses : encourir la colère divine (pour non-respect d’une obligation) ; voir s’effondrer la charia.

Ce risque d’effondrement, pour les oulémas, est évident : dans la formule de Shirâzî (m. 1083) citée plus haut, l’identification du fiqh à l’ijtihâd est totale : le premier dépend du second.
De même pour le grand savant malékite et muḥaddith Ibn ‘Abd al-Barr (m. 1072) les questions juridiques inédites étant infinies, seuls le qiyâs et l’ijtihâd permettent que la charia puisse répondre aux besoins de la société.
L’une des plus grandes autorités religieuses de l’islam, le polymathe chaféite Jalâl al-Dîn Suyûtî (m. 1505), l’affirme clairement : sans ijtihâd la charia serait anéantie, par conséquent, l’ijtihâd est l’épine dorsale de la charia et sans elle, aucune décision juridique ne peut être prise.
Le seul consensus connu est donc bien celui-ci : pas de fiqh possible sans ijtihâd (Hallaq, 1984). On se demande donc comment il aurait pu être « fermé ».
Méprise historique ensuite. Si l’impossibilité technique d’une fin de l’ijtihâd est l’argument théorique majeur en faveur d’une nécessaire permanence de celui-ci, l’histoire intellectuelle offre quant à elle la preuve par les faits : aucun siècle, aucun ensemble géographique n’ont été dépourvus de mujtahid-s depuis le 9e siècle. Cela aurait été de toute façon impossible.
Pourquoi ? Car à cette époque l’élaboration doctrinale des Écoles n’est de toute façon pas encore achevée. Les Écoles, au 9e siècle, possèdent bien leurs fondements, mais pas les détails.

Il faut attendre les compléments essentiels de grands mujtahid-s postérieurs, justement, qui vont rendre opératifs l’architecture conceptuelle et méthodologique élaborée avant eux, réorganisant, synthétisant, perfectionnant les éléments laissés par leurs aînés : en faisant donc œuvre d’ijtihâd.
L’école hanbalite, par exemple, ne connaît son plein épanouissement qu’avec le grand œuvre d’Ibn Qudâma al-Maqdisî (mort au 13e siècle), qualifié de Cheikh al-Islâm[10] : al-Mughnî.
De même pour l’École hanafite, pourtant la plus ancienne des quatre, et bien qu’elle ait connu un fort développement précoce : aux 11e et 12e siècles, d’importantes réformes et sophistications sont intervenues, donnant davantage de force aux fondements de l’École.
Des figures telles que le grand savant et théologien Al-Juwaynî (m. 1083), et son élève Al-Ghazâlî (m. 1111) seront sources majeures de renouvellement des uṣûl-s de l’École chaféite.
Al-Ghazâlî est unanimement considéré comme le mujaddid – « rénovateur » de la religion – de son siècle, car il a offert une magistrale récapitulation des fondements de l’islam – dans ses trois composantes théologiques, juridiques et spirituelles[11].
Bien plus qu’un simple synthétiseur, il redonna aux uṣûl al-fiqh ses lettres de noblesse, constituant une œuvre fondamentale pour son madhhâb, mais aussi pour le Droit islamique en général, ainsi que pour la théologie.
Son livre Al-Muṣṭafâ est reconnu comme l’ouvrage d’uṣûl le plus riche et méticuleux.
Ce titre de mujaddid est de source prophétique : un ḥadîth indique que chaque siècle verra un mujaddid redonnant fraîcheur à la religion, le tajdîd (« renouvellement »).
Cette annonce prophétique, pour les savants classiques, est d’ailleurs un des arguments rendant nécessaire l’ijtihâd, donc impossible son arrêt, a minima par l’œuvre d’un mujaddid.
Au cours de l’histoire les oulémas vont régulièrement rechercher, pour chaque siècle, le mujaddid correspondant : il s’agira chaque fois des savants ayant le plus marqué leur époque et les décennies suivantes par la grandeur, le caractère séminal et réformateur de leur œuvre.
Ijtihâd et tajdîd, sans être synonymes, sont donc intimement liés. Ainsi, pas un seul siècle sans que, non pas une, mais plusieurs figures intellectuelles n’apparaissent comme remarquables, même si le commun des musulmans les a oubliés aujourd’hui.
Mais certains noms demeurent, y compris dans la mémoire collective de la masse des croyants : comment dire que l’ijtihâd fut fermé au 9e siècle, quand d’immenses figures ont jalonné l’histoire de la pensée islamique postérieure ?
Les noms sont trop nombreux pour être cités dans une liste qui serait fastidieuse, mais rappelons en quelques-uns, en plus de ceux déjà cités : Ibn Taymiyya (m. 1254), figure polémique mais dont la pensée est tout entière portée par la notion d’ijtihâd ; Al-‘Izz ‘Abd al-Salâm (m. 1262), surnommé le « Sultan des oulémas » ; l’imam al-Nawâwî (m. 1277) mort à 44 ans, mais dont l’œuvre considérable est fondamentale ; Ibn Daqîq Al-`Îd (m. 1302) , grand juriste et muḥaddith de renom, considéré comme le mujaddid de son siècle ; Al-Suyûtî (m. 1505), à qui on attribue plus de 900 ouvrages, reconnu lui aussi comme mujaddid, et dont le rôle est central dans plusieurs sciences islamiques ; Al-Munâwî (m. 1621), juriste et muḥaddith, dont une récente et magistrale thèse montre l’ampleur encyclopédique du savoir, y compris dans la philosophie[12] ; Shâh Walî Allâh al-Dihlawî (1762), savant indien qui porta l’ijtihâd avec force (Dallal, 2016 ; Baljon, 1986) tout en transmettant l’héritage métaphysique d’Ibn ‘Arabî (m. 1240) ; al-Shawkânî (m. 1834), issu du zaydisme, qui transcenda les limites chiites/sunnites et, comme Walî Allâh, dynamisa avec vigueur la tradition de l’ijtihâd…
Liste non exhaustive – loin de là – des noms les plus connus pour la période 10e-18e siècles, période pourtant prise, par les partisans de l’idée de « fermeture », comme une ère d’imitation servile (taqlîd) de l’œuvre des anciens.
Ainsi, dès l’introduction à sa remarquable étude sur le dynamisme intellectuel islamique du 17e siècle, l’islamologue américain K. Rouayheb prévient, pour qu’on ne croit pas que les multiples savants encyclopédiques qu’il va citer sont des singularités à leur époque : « La liste des ‘exceptions’ est simplement devenue trop longue pour que l’idée (d’exception) soit prise au sérieux : […] il est grand temps d’arrêter d’élargir la liste des prétendues ‘exceptions’ » [13].
Les évidences sont tellement nombreuses, que l’on ne peut que souscrire au jugement sans appel d’Éric Chaumont (2004) : la « fermeture » est « l’une des inepties les plus fermement ancrées dans l’islamologie juridique (…) L’absurdité de cette thèse a déjà été plusieurs fois démontrée ».
3- Deux confusions qui créent un mythe
La complexité du sujet vient du fait que le mythe de la fermeture repose en fait sur une série d’équivoques aggravées par de coupables intentions.
Car tout n’est pas invention ici : des éléments concrets de l’histoire intellectuelle islamique ont fourni des arguments apparemment probants en faveur de l’idée de déclin, arguments finalement repris, de manière circulaire, par l’orientalisme précolonial/colonial, et les intellectuels de la Nahda puis de la salafiyya.
Revenons, dans cette partie, sur deux confusions principales ayant entretenus le mythe de la « fermeture » : (a) entre ijtihâd en tant que tel et ijtihâd mutlaq ; (b) entre raréfaction des mujtahid-s et fermeture de l’ijtihâd.
1. a) Confusion ijtihâd muqayyad/ijtihâd mutlaq
On l’a vu, il existe différents niveaux d’ijtihâd, du plus haut s’exerçant en dehors de toute École (ijtihâd mutlaq), à un autre plus réduit, au sein d’une ou plusieurs Écoles (muqayyad).
À mesure de l’avancée des siècles, c’est le premier niveau qui est devenu de plus en plus rare, voire résiduel.
Et c’est cette raréfaction qui a donné l’illusion de fin d’ijtihâd tout court, alors que seul un niveau était concerné, et même pas intégralement.
La raison du recul de l’ijtihâd mutlaq est simple : les outils méthodologiques et herméneutiques élaborés par les mujtahid-s avaient donc abouti, au bout de plusieurs siècles, à l’établissement des quatre Écoles majeures.
Elles cristallisèrent alors autour d’elles quasiment toutes les possibilités interprétatives et épuisèrent ainsi, presque mécaniquement, le champ des possibles en matière de réponses.
Ne trouver de solution satisfaisante dans aucune des quatre Écoles, malgré la pluralité d’avis existant entre elles et au sein de chacune d’elles, relèvera bientôt de l’impossibilité[14] : la variété des questions inédites venant à se réduire, l’ijtihâd absolu n’était plus nécessaire.
Il faut déduire de tout cela, note Turki (2002) « que le succès de la mission en question fut si complet qu’au bout d’un siècle d’ijtihâd, elle était considérée comme terminée. Cette fois-ci, les divergences juridiques, ne pouvant pas disparaître complètement, furent au moins maîtrisées, parce que canalisées par la voie des quatre grandes Écoles »[15].
Il serait de toute façon impossible d’imaginer une communauté religieuse renouvelant entièrement sa pensée juridique en continu sur plusieurs siècles : l’architecture méthodologique une fois élaborée, l’étendue historique et géographique sur plusieurs siècles ne pouvait que rendre, à un moment, quasi négligeables les questions n’ayant pas de précédent.
Hormis quelques cas contemporains, comme la bioéthique par exemple, la plupart des situations auxquelles furent confrontés les juristes des derniers siècles avaient un équivalent plus ancien auquel se référer (et donc ouvert à l’analogie, le qiyâs)[16].
En un sens, un ijtihâd intégral, à toutes époques et au plus haut niveau (donc mutlaq) serait le suicide d’une théorie juridique perdant toute stabilité : « Mais quelle religion pourrait-elle prétendre à une activité permanente et novatrice sans discontinuer ? », s’interroge ainsi A-M. Turki.
Mais, a contrario, hormis le fait que des mujtahid mutlaq ont toujours existé[17], il est impensable que le fiqh islamique ait pu se maintenir tant de siècles sans avoir été pourvu d’une capacité à l’auto-renouvellement et à l’absorption consenties des divergences (ikhtilâf), justement permise par la pratique continue de l’ijtihâd : c’est par lui qu’une étonnante permanence juridique, par-delà la diversité, a été rendue possible.
« Quant à nous, écrit Turki, nous préférons nous en tenir à ce qui nous paraît acquis. Les juristes comme corps de savants, n’ont jamais manifesté de désintérêt pour l’ijtihâd. Leurs ouvrages de méthodologie juridique lui consacrent le chapitre final, pour un exposé théorique, mais aussi critique où les différents cas de divergences sont largement analysés, défendus par toutes sortes d’arguments et illustrés par tous genres de cas de figure. Pendant tant de siècles, l’activité avait été continue, même si on pouvait admettre l’idée d’un certain ralentissement, pas général, qui s’accentua à partir du XVIe siècle. Certes, ce qui domine, c’est l’ijtihâd à l’intérieur des Écoles, comme nous le voyons à chaque étape de cette étude. Mais, de là à prétendre que sa porte s’est fermée, pour rester close pendant presque un millénaire, c’est ne reconnaître de valeur qu’a l’ijtihâd absolu »[18].
2. b) Confusion entre réduction des mujtahid-s et fin de l’ijtihâd
Autre élément de méprise : la réduction du nombre de savants revendiquant l’ijtihâd sera confondu avec la fin de l’ijtihâd lui-même.
Concrètement on constate qu’au fur et à mesure des siècles, de plus en plus de savants appellent au taqlîd, le suivisme des avis d’une École.
C’est ce taqlîd qui, dans certains cas, a donné naissance à une rigidification stérile. Deux remarques cependant.
D’abord le taqlîd intégral (celui que ses détracteurs ont appelé « suivisme aveugle ») est le fait non des grands savants, mais de oulémas de plus faible envergure.
Ensuite, et surtout : la raréfaction des mujtahid-s n’était pas le fait d’une rigidité du fiqh, mais de la multiplication des conditions permettant à un savant de faire l’ijtihâd.
En effet, pour être mujtahid il faut maîtriser à un haut niveau de multiples sciences, transmises (maîtrise des Sources et des sciences y afférant) et rationnelles (logique ; lexicographie ; grammaire ; rhétorique, etc.).
Les avis divergent quant à ces conditions, certains savants relativisant certaines d’entre elles.
Ainsi, la question n’a jamais été : « l’ijtihâd est-il fermé ? » mais plutôt : « est-il possible, selon la raison humaine ou la Loi divine, qu’il y ait des époques sans mujtahid ? ».

« C’est ce que croyaient les musulmans, note Hallaq : que l’on était face, non pas à la fin d’un processus légal, mais à la disparition des hommes de science », conformément à un ḥadîth bien connu.
Davantage : Hallaq relève que tout indique, dans les ouvrages juridiques, que la question de cette possible disparition ne concernait en réalité que le mujtahid mutlaq.
C’est ce que montrent de nombreux exemples, dont celui d’Ibn Khaldûn (m. 1405), qui relève qu’on entend par mujtahid celui qui fonde une nouvelle École.
Cette confusion lexicale (ijtihâd muqayyad/mutlaq), relevée par Ibn Khaldûn, fut ainsi la source d’une méprise historique…
Ces deux confusions vont entrer en conjonction, au 19e siècle, avec un « esprit nouveau » : la modernité.
Celle-ci, porteuse de principes par bien des aspects contradictoires avec l’ancienne pensée pluriséculaire, va jeter un regard négatif sur le passé, jugé arriéré.
Dans l’histoire de la pensée islamique s’ouvre alors une nouvelle ère, condamnant l’intellectualité traditionnelle à entrer dans les oubliettes de l’histoire, et donnant naissance à de nouveaux mythes dans lesquels va s’enfoncer la pensée islamique contemporaine.
Daoud Riffi
Notes :
[1] Je dois remercier ici Gregory Vandamme (Université de Louvain) pour sa patiente relecture de mon article, et ses très savantes remarques.
[2] Titre du livre d’un des plus importants intellectuels arabes du « réformisme musulman », Chekib Arslan, édité et préfacé par Rashîd Riḍâ en 1930.
[3] Sur les mots « wahhabisme », « salafisme » et la complexité autour de ces notions, voir Riffi (2019 & 2020). Sur le difficile concept de « réformisme » et ce qu’il recouvre, voir A-L. Dupont et C. Mayeur-Jaouen (2016), p. 48-108. Également, N. Picaudou (2010) [Afin de ne pas alourdir le texte nous ne citerons que le nom et la date d’édition des sources citées, les références complètes se trouvant en bibliographie finale]. Par commodité j’emploierai l’expression « salafisme » (salafiyya) dans son acception large (bien que cela ne soit pas sans griefs) regroupant les différents oulémas et intellectuels rattachés à l’idée de « retour aux sources ». Salafisme peut donc être synonyme de « wahhabisme » et de réformisme, même si la réciproque n’est pas toujours possible (le wahhabisme renvoyant exclusivement aux auteurs se réclamant massivement de l’enseignement d’Ibn ‘Abd al-Wahhâb).
[4] Dans cet article nous nous appuierons notamment sur des auteurs ayant contribué à la remise en cause des anciens paradigmes du déclin et de « fermeture de l’ijtihâd ». Les travaux précurseurs menés par Wael Hallaq entre 1983 et 1986 ; le bilan opéré par Abdel Majid Turki (2002) ; les travaux fondamentaux de Khaled El-Rouayheb et Ahmad Dallal (2018) sur l’histoire intellectuelle des 17e-18e siècles, qui ont achevé, de manière magistrale, de renverser notre vision du passé islamique. De même que l’œuvre tout entière de S.H. Nasr, mais aussi de W. Chittick (notamment : 2007) participe de la remise en cause de l’idée d’un déclin intellectuel du monde musulman, et sur ce que recouvre la notion d’intellectualité. En français, sur l’ijtihâd et le mythe de sa fermeture, en plus de Turki, Éric Chaumont (2004) a livré une succincte et très claire synthèse.
[5] C’est-à-dire qu’il suffit qu’une seule personne s’en acquitte pour que l’ensemble de la Communauté ait répondu à l’obligation. C’est le contraire de l’obligation individuelle (fard ‘ayn) qui doit être réalisée par chacun (telle la prière par exemple).
[6] Ce sont, pour le sunnisme, les trois Écoles de théologie (‘aqîda), les quatre Écoles juridiques (fiqh) et les multiples Écoles spirituelles (confréries soufies, tasawuf). Cette tripartition scientifique repose sur le célèbre « ḥadîth de Gabriel » expliquant ce qu’est la foi (dont dérive la science de la ‘aqida), l’islam (le fiqh) et l’excellence (iḥsân, dont dérive le soufisme).
[7] Les quatre Écoles juridiques existant toujours dans le Sunnisme ayant été fondées par Abū Hanîfa, Mâlik, Shâfî’i et Ibn Hanbal.
[8] Chaumont (2004).
[9] Certains auteurs appellent à faire table rase de la tradition juridique pluriséculaire, mais ne proposent cependant aucun outil méthodologique alternatif concret permettant de sortir d’une architecture théorique et pratique très élaborée. Remplacer un système construit sur plusieurs siècles par un ensemble d’autorités au savoir souvent encyclopédique ne va pas de soi, et nécessite un appareil réflexif qui va bien au-delà des seuls discours programmatiques. J’y reviendrai par la suite.
[10] Titre honorifique octroyé à une autorité religieuse pour sa stature intellectuelle.
[11] Notamment grâce à son opus magnum, Iḥya ‘Ulûm al-Dîn (« Revivification des Sciences de la religion »), dont on a pu dire que si tous les livres sur l’islam devaient disparaître, mais que seul celui-ci demeurait, la Communauté musulmane n’aurait rien perdu.
[12] Dans cette thèse récemment publiée, T. Chouiref (2020) montre notamment que l’idée d’une « mort de la philosophie après Ghazali » est également un mythe. C’est aussi un des mérites du travail d’El-Rouayheb.
[13] Rouayheb (2015), p. 5.
[14] D’où la fameuse formule d’Ibn Taymiyya, pourtant grand partisan de l’ijtihâd : « la vérité se trouve dans les quatre Écoles ».
[15] Notons au passage ceci : c’est sans doute cette conclusion (l’aboutissement méthodologique du fiqh par les Écoles) qui est remise en cause par une partie de « l’école réformiste » (au sens large) au 20e siècle (dont les prémices se trouvent déjà chez Ibn ‘Abd al-Wahhāb, fondateur du wahhabisme) : l’idée étant que les nouveaux penseurs peuvent refonder une pensée juridique totalement inédite, faisant tabula rasa de l’héritage pluriséculaire. Reste à se demander si les moyens intellectuels sont à la hauteur des prétentions.
[16] Même les questions juridiques liées à la présence minoritaire de musulmans en contexte majoritairement non musulman trouvent des exemples passés sur lesquels s’appuyer.
[17] Y compris en plein 20e siècle, avec le Cheikh marocain Ibn Al-Siddiq. Mais, issu d’une grande famille de oulémas prestigieux, il pouvait s’adosser sur une tradition intellectuelle indiscutable, qu’il transcenda plutôt qu’il ne la renversa. La différence entre dépasser les Écoles et les supprimer est de taille : c’est toute la confusion que pose la salafiyya.
[18] Turki, 2002, p. 27.
Bibliographie
– Akkach, Samer (2007), ‘Abd al-Ghani al-Nabulusi: Islam and the Enlightenment, One World
– Baljon, Johannes Marinus Simon (1986) Religion and Thought of Shâh Walî Allâh Dihlawî, 1703–1762, Brill.
– Benzine, Rachid (2004) Les Nouveaux penseurs de l’islam, Albin Michel.
– Chaumont, Éric (2004), « Quelques réflexions sur l’actualité de l’ijtihâd », in Lectures contemporaines du droit islamique, Presses Universitaires de Strasbourg, p. 71-79.
– Chittick William (2007) (à paraître, éditions Tasnîm, 2021), Science of the Cosmos, Science of the Soul : The Pertinence of Islamic Cosmology in the Modern World, One World Publications.
– Chouiref, Tayeb (2020), Soufisme et hadith dans l’Egypte ottomane ; Abd al-Ra‘uf al-Munawi (952/1545 – 1031/1622), IFAO.
– Dupont, Anne-Laure, Mayeur-Jaouen Catherine (2016), Histoire du Moyen-Orient, Armand Colin.
– El-Rouayheb, Khaled (2015), Islamic intellectual history in the Seventeenth Century : Scholarly Currents in the Ottoman Empire and the Maghreb, Cambridge University Press.
– Hallaq, Wael (1984), « Was the Gate of Ijtihâd Closed? », International Journal of Middle East Studies, Vol. 16, No. 1 (Mar., 1984), pp. 3-41.
– Lauzière, Henri (2015), The Making of Salafism. Islamic Reform in the Twentieth Century, Columbia University Press.
– Mayeur-Jaouen, Catherine (2018), « À la poursuite de la réforme : renouveaux et débats historiographiques de l’histoire religieuse et intellectuelle de l’islam, XVᵉ‒XXIᵉ siècle », Annales. Histoire, sciences sociales, 2018, 73/2, pages 317‒358.
– Nasr, Seyyed Hossein (1981), La Connaissance et le Sacré, L’Âge d’Homme.
– Oubrou, Tareq (2016), Ce que vous ne savez pas sur l’islam, Fayard.
– Picaudou, Nadine (2010), L’Islam entre religion et idéologie. Essai sur la modernité musulmane, Gallimard.
– Reichmuth, Stefan (2009), The World of Murtada al-Zabidi, 1732-91 : Life, Networks and Writings, Gibb Memorial Trust.
– Riffi, Daoud (2019), « Comprendre le salafisme », Les Cahiers de l’Islam, mai 2019 (consultable en ligne).
– Riffi, Daoud (2020), « Wahhabisme », in « Les Mots de l’islam », Orient XXI, mai 2020 (consultable en ligne).
– Turki, Abdel-Magid (2002) « Aggiornamento juridique: continuité et créativité ou fiction de la fermeture de la porte de l’ijtihâd? », Studia Islamica, No. 94, pp. 5-65.