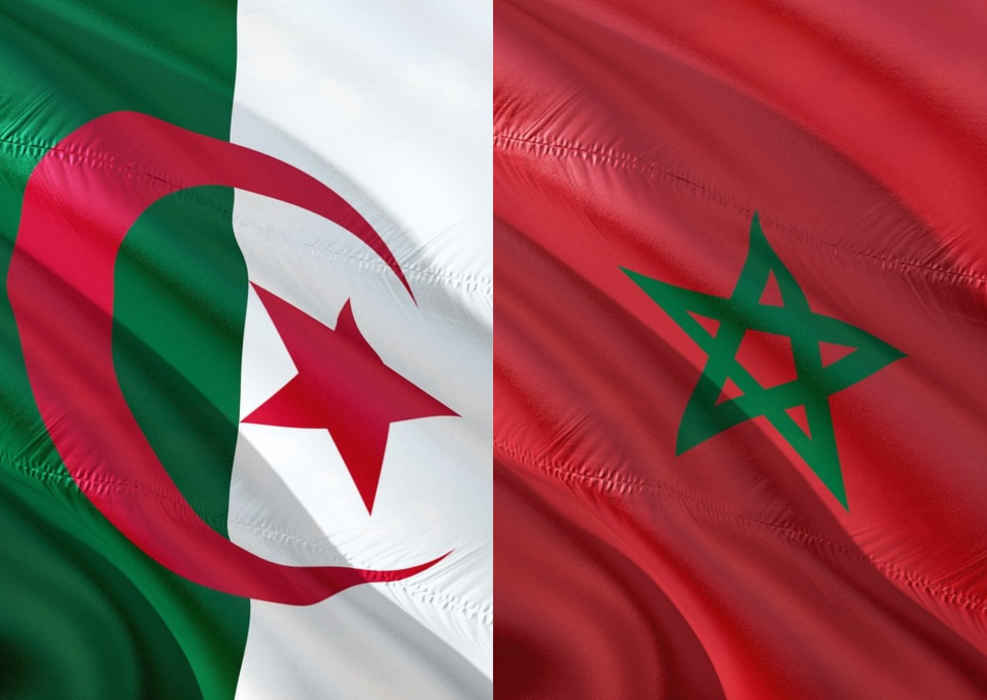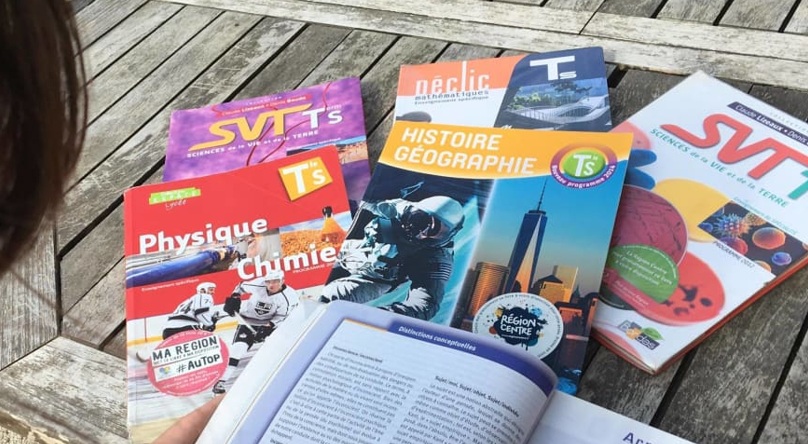En 1973, David Rosenhan dévoile une expérience qui bouleverse la confiance dans le diagnostic psychiatrique, en démontrant à quel point il est difficile de distinguer un malade mental d’un individu sain au sein des institutions. Cette étude, devenue un classique, interroge la crédibilité de la psychiatrie moderne.
En psychiatrie, l’expérience de Rosenhan, menée par le psychologue David Rosenhan en 1973, remet radicalement en cause la validité du diagnostic psychiatrique. Publiée dans Science sous le titre « On Being Sane in Insane Places » (« Être sain d’esprit dans des lieux fous »), cette étude est considérée comme un tournant majeur et une critique implacable des pratiques psychiatriques, ce qui explique sa notoriété.
L’étude comprend deux volets. Dans la première partie, Rosenhan recrute des volontaires en parfaite santé mentale, appelés « pseudo-patients », qui simulent de brèves hallucinations auditives afin d’être admis dans douze hôpitaux psychiatriques américains, répartis sur cinq États. Tous sont acceptés et diagnostiqués comme atteints de troubles psychiatriques. Une fois hospitalisés, ils adoptent un comportement normal et affirment que les hallucinations ont cessé. Malgré cela, le personnel reste convaincu de leur pathologie.
Dans la seconde partie, Rosenhan propose à un hôpital de détecter de faux patients parmi des admissions ordinaires, alors qu’en réalité aucun imposteur n’est envoyé. Le personnel identifie à tort un grand nombre de vrais patients comme des simulateurs.
Ces résultats révèlent l’incapacité à distinguer le sain du malade en milieu psychiatrique, et montrent les effets de la stigmatisation et de la déshumanisation institutionnelle. L’étude questionne fondamentalement la validité du diagnostic psychiatrique et l’influence du contexte hospitalier.
Les pseudo-patients
David Rosenhan et sept volontaires en bonne santé (un étudiant, trois psychologues, un psychiatre, un pédiatre, un peintre, une femme au foyer) se font passer pour malades en appelant pour obtenir un rendez-vous, affirmant entendre des voix disant « empty » (« vide »), « hollow » (« creux »), et « thud » (« bruit sourd »). Aucun autre symptôme n’est évoqué. Ils utilisent de faux noms et, pour ceux travaillant dans le milieu médical, mentent sur leur profession afin d’éviter un traitement particulier. Les autres éléments biographiques restent exacts.
Ils sont admis dans des hôpitaux variés (ruraux, urbains, prestigieux, privés), la majorité est diagnostiquée schizophrène, sauf un, admis dans une clinique privée, diagnostiqué psychose maniaco-dépressive. Leur séjour dure de 7 à 52 jours (moyenne 19), et tous ressortent avec un diagnostic de schizophrénie « en rémission », ce que Rosenhan interprète comme la preuve d’une stigmatisation durable.
Les pseudo-patients prennent des notes sur le fonctionnement hospitalier, activité interprétée par le personnel comme un comportement pathologique. En revanche, plusieurs vrais patients perçoivent la supercherie : 35 sur 118 expriment des doutes.
Humiliation et déshumanisation
Leurs dossiers médicaux montrent que tout comportement était systématiquement réinterprété comme signe de maladie. Une infirmière qualifie la prise de notes de « travail d’écriture » suspect, et la biographie ordinaire des pseudo-patients est retravaillée à l’aune des théories de la schizophrénie.
Prévus pour ressortir d’eux-mêmes, ils devront finalement faire appel à un avocat, car aucun ne peut quitter l’hôpital sans accepter le diagnostic et prendre des antipsychotiques, qu’ils rejettent discrètement. Les soignants ne remarquent pas ces refus de traitement, même si le phénomène est consigné comme fréquent.
Durant leur séjour, les pseudo-patients dénoncent la déshumanisation : objets fouillés, intimité bafouée, toilettes surveillées, et contacts réduits avec les médecins (moyenne de 6,8 minutes par jour). Certains soignants, selon eux, adoptaient même des attitudes humiliantes ou agressives, surtout hors présence de collègues. Rosenhan rapporte :
« J’ai dit à mes amis, j’ai dit à ma famille, “Je peux sortir quand je peux sortir, c’est tout. Je serai là pour quelques jours et je sortirai.” Personne ne savait que je resterais deux mois… La seule façon de sortir a été de confirmer qu’ils [les psychiatres] avaient raison. Ils ont dit que j’étais malade, “Je suis malade mais je vais mieux”. C’était l’affirmation de leur point de vue sur moi. »
— The Trap, BBC
Les imposteurs inexistants
Un grand centre hospitalier, persuadé de ne pas pouvoir se tromper, relève le défi lancé par Rosenhan : identifier de potentiels pseudo-patients parmi 193 admissions sur trois mois. Résultat : 41 patients sont considérés comme imposteurs et 42 comme suspects. Pourtant, Rosenhan n’avait envoyé personne. Ce fiasco amène à conclure que « tout procédé de diagnostic qui se prête trop facilement à de telles erreurs ne peut pas être fiable ».
Publié dans Science, l’article de Rosenhan provoque un séisme. Certains psychiatres, comme Robert Spitzer, estiment que l’étude surestime les failles diagnostiques, car « si je buvais une pinte de sang et allais vomir à l’hôpital, personne ne douterait d’un ulcère ». La critique porte moins sur l’admission des pseudo-patients que sur la rigidité du diagnostic ensuite, qui transforme tout comportement en preuve de maladie.