Belle chronique de Mahdi Amri sur la manière dont nous devons concevoir notre rapport à la technique de l’IA pour conserver et cultiver notre part d’humanité et éviter l’aliénation. A lire sur Mizane.info.
Ce qui m’a frappé ces dernières années, c’est que ma relation à l’intelligence artificielle n’a pas commencé au moment où j’ai commencé à l’utiliser, mais bien lorsque j’ai perçu sa présence croissante dans les détails silencieux de mon quotidien, sans annonce ni permission. Je pensais jadis que l’homme convoquait la machine lorsqu’il en avait besoin. J’ai découvert qu’elle se glissait dans nos manières de vivre avant même que nous en prenions conscience.
Le rythme de la parole a changé, la forme du silence aussi, et l’attente de la réponse n’est plus tournée vers l’être humain, mais vers l’interface. Le mot désormais transite par des écrans sans chair ni souffle, pourtant l’homme leur confie son intimité comme si ces dispositifs lui prêtaient une écoute authentique. Alors je me suis interrogé : cherchais-je une oreille capable d’entendre, ou une voix qui ne conteste pas ? Ne me réfugiais-je pas dans la neutralité de la machine pour me dispenser de la vulnérabilité que suppose l’échange humain ?
La rencontre est dévoilement
Dans ce temps régi par les médiations numériques, il devient difficile de distinguer entre une parole née de l’expérience vécue et une parole engendrée par le calcul. La présence humaine ne réside pas seulement dans une voix, mais dans une proximité, une brûlure, un regard qui dévoile ce que le langage tente de dissimuler. Et l’on comprend que la rencontre n’est pas un simple acte d’information : elle est dévoilement, risque, offrande.

C’est pourquoi, au terme de chaque conversation numérique, je sens qu’il manque quelque chose, qu’un reste non-dit demeure suspendu. Car la parole, lorsqu’elle n’est pas habitée, demeure vide, et l’homme, lorsqu’il ne se découvre pas dans l’œil de son semblable, reste étranger à lui-même.
Le dialogue est pourtant l’un des sommets de l’agir humain, puisqu’il est ce moment où l’on donne de soi et où l’on reçoit du sens, du souffle, de la présence de l’autre. Or, le dialogue a changé de nature : il n’est plus le passage de sens entre deux êtres, mais la translucidité d’un texte qui circule entre deux écrans. La chaleur du geste, l’hésitation d’une pensée qui naît, la stupeur d’une idée qui se forme, tout cela s’estompe.
Qu’est-ce que la solitude ?
Dans les salles de cours, je voyais autrefois la compréhension surgir d’un regard soudain, d’un silence qui respirait, d’une surprise qui unissait les esprits. Aujourd’hui, ces étincelles s’évanouissent derrière des visages lissés par les filtres des écrans et des voix qui se désagrègent dans la compression numérique. La communication est devenue un flux continu, mais paradoxalement habitée par la séparation : elle rassemble en surface ce qu’elle disjoint en profondeur. L’homme n’apprend pourtant pas avec son intellect seul, mais avec sa sensibilité, son souffle, ses hésitations, ses élans.
Ainsi, il peut vivre au milieu d’une marée de mots et demeurer pourtant radicalement seul : car la solitude ne naît pas de l’absence des autres, mais de l’absence d’écho. Je ne plaide pas pour une fuite hors de la technique, mais pour un recentrement du sens. La machine relie, certes ; mais elle ne crée pas l’intime. Elle fluidifie l’échange, mais ne transmet pas la chaleur de l’expérience. Or, le sens ne se donne que dans la co-présence des vulnérabilités.
Ce qui, en l’Homme, est incorruptible
Le défi véritable réside alors dans la manière dont nous nous percevons au sein de ce temps numérique. La machine ne rivalise avec l’homme que lorsque celui-ci oublie qu’il est un être de sens avant d’être un agent d’efficacité. S’il réduit son existence au rendement et à la vitesse, il devient semblable à l’outil qu’il a façonné. Ainsi, le vivre-ensemble à l’ère de l’intelligence artificielle ne se conquiert pas par la multiplication des réseaux, mais par la restauration de l’esprit de rencontre : cette lenteur habitée qui permet l’émergence de ce qui ne se calcule pas.

Le ralentissement n’est pas un retard, mais une sauvegarde de l’âme ; la vitesse, malgré sa séduction, n’engendre qu’une compréhension superficielle. La voie d’une relation équilibrée à la technique passe par l’examen de l’intention : pourquoi parlons nous ? À qui offrons nous nos mots ? Quel sens cherchons nous à faire advenir ?
Si l’intention se clarifie, la parole devient pont ; si elle se corrompt, les mots se dissipent sans trace. Notre relation à l’intelligence artificielle est l’épreuve même de ce que nous sommes : ou bien nous préservons la lumière intime qui habite le cœur et orientons la technique vers l’éveil de la conscience ; ou bien nous l’abandonnons, et alors la technique se substitue à la conscience. Tant qu’une voix silencieuse persiste en nous, tant qu’un regard s’ouvre, tant qu’un cœur s’émeut, le monde des machines ne pourra effacer ce qui, en l’homme, est incorruptible. J’en témoigne, et que cela soit entendu.
Mahdi AMRI
Professeur de l’Intelligence Artificielle, Institut Supérieur de l’Information et de la Communication (ISIC), Rabat, Maroc.
A lire également :
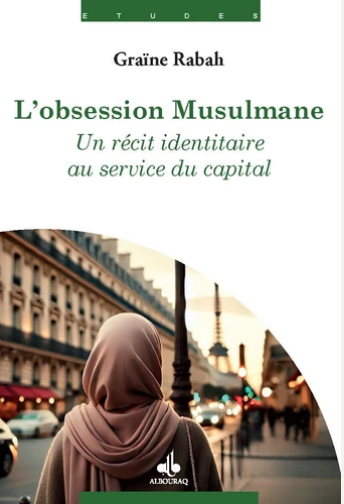



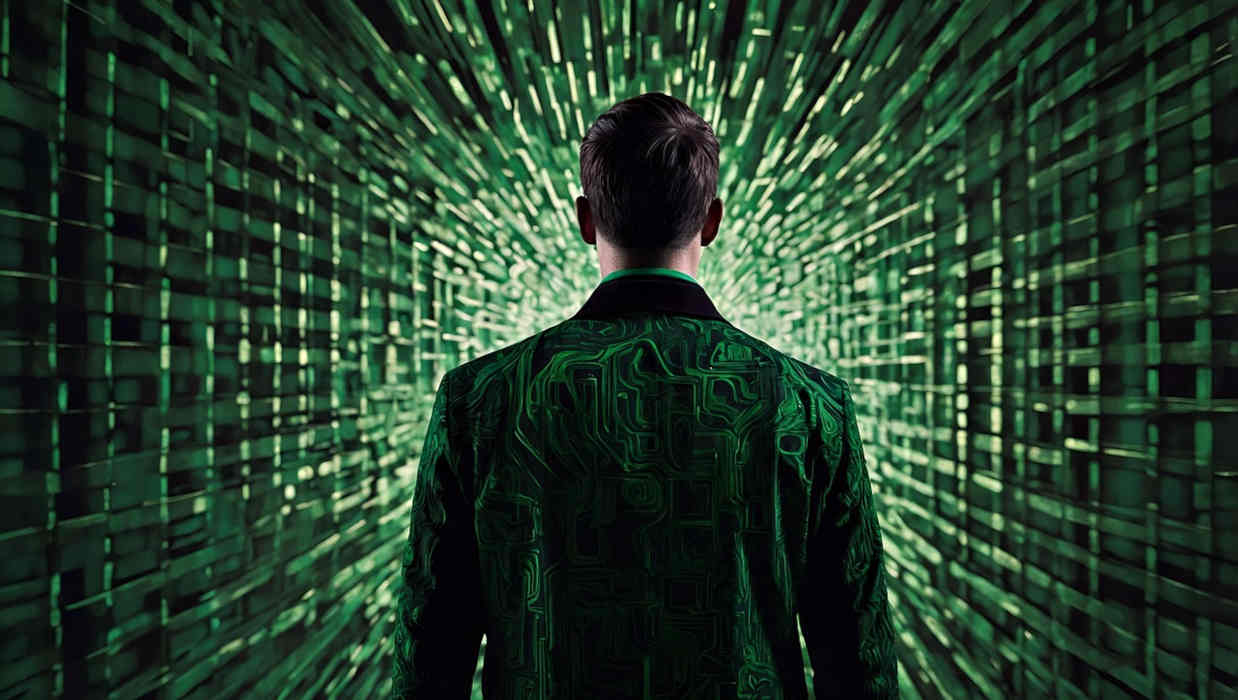


Une réponse
L’IA mourra l’être humain demeurera .. il est déjà question dans les médias de mort de l’IA