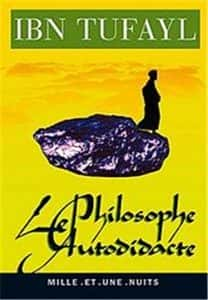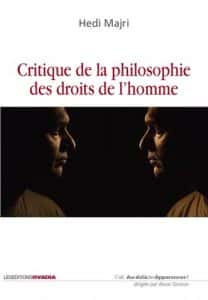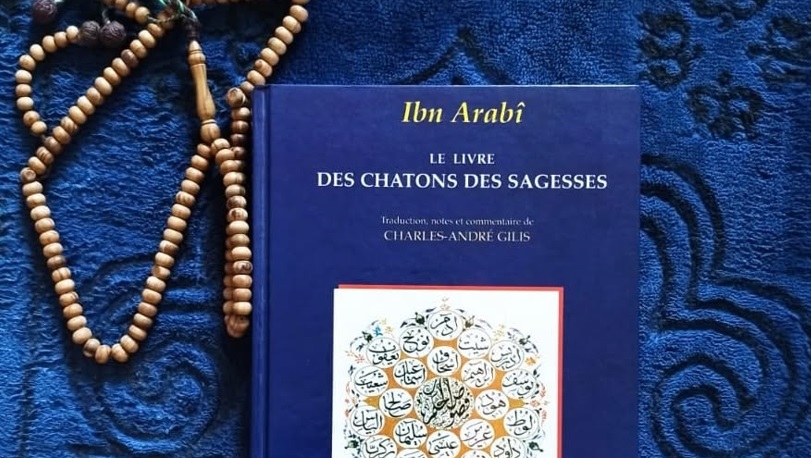La tradition des droits naturels s’oppose-t-elle au fondement divin d’une conception du droit ? L’Etat providence est-il une forme de sécularisation de Dieu ? Dans une tribune traduite par Mizane.info, Khaled Abou El Fadl traite ces différentes problématiques en critiquant le textualisme des législations européennes au profit de l’idée spirituelle d’un état de grâce. Khaled Abou El Fadl est professeur émérite de droit à la faculté de droit de l’UCLA. Il est le fondateur de l’Institut Usuli, un groupe de réflexion islamique pour lutter contre l’extrémisme et l’ignorance.
Les droits de l’homme et le terrorisme sont tous deux de grands concepts.
Les droits de l’homme sont un grand concept de bien ultime ou absolu – à bien des égards, comme l’idée de divinité ou l’idée de lumière.
Le terrorisme, d’autre part, est un grand concept d’un mal ultime ou absolu, tout à fait l’antithèse de la divinité et l’antithèse de la lumière.
Bien que les théologiens, les juristes et les philosophes aient produit une remarquable variété terminologique pour négocier notre idée du bien et notre répulsion à l’idée du mal, nous revenons finalement à cette dichotomie centrale.
Cela a un sens parfait pour les gens de foi parce que c’est la logique d’être dans un état de grâce contre celui d’être dans un état d’absence de grâce; un état de miséricorde contre l’absence de miséricorde; un état de bénédiction contre l’absence de bénédiction.
Et pourtant, aussi puissamment libératrice que soit l’idée du bien, de la lumière et du divin, et aussi remarquablement étouffante que soit celle de l’obscurité, du démoniaque ou de la terreur, nous, êtres humains, avons géré de manière misérable un concept relevant de l’ultime et de l’absolu pour le transformer, dans la pratique, en son contraire.
C’est le véritable défi pour les croyants que pose la notion contemporaine des droits de l’homme.
La tradition islamique des droits naturels
Au risque de passer à côté de nombreuses complications historiques et conceptuelles, il est juste de dire que la genèse des droits de l’homme est dans la tradition des droits naturels, et la genèse de la tradition des droits naturels, à son tour, se trouve dans la tradition de la loi naturelle.
Tout comme dans la tradition chrétienne, il y a eu dans la tradition intellectuelle islamique une bataille antérieure entre ceux qui croyaient que la notion de bien et de mal existe dans une essence primordiale et transcendante, et qu’elle ne dépendait pas d’un commandement divin, et ceux qui ont fait du droit naturel – ce qu’ils appelaient al-husn (beauté) contre al-qubh (laideur), une idée très semblable à l’idée d’obscurité et de lumière – le commandement exclusif de Dieu.
Ces deux factions se sont confrontées tout au long de l’histoire islamique et, comme cela arrive souvent, les deux factions ont fini par être complètement entraînées dans les tendances politiques de l’époque.
Au sommet de la civilisation islamique, les théologiens musulmans – en particulier les théologiens du droit naturel – ont prospéré. Ils ont prospéré à Bagdad, à Damas et, environ un siècle plus tard, en Égypte.
C’est finalement la tradition qui a fait son chemin à travers l’Andalousie vers l’Europe à travers les œuvres d’Ibn Rushd (décédé en 1198) – qui a eu une profonde influence sur Thomas d’Aquin (décédé en 1274) – et Ibn Tufayl (décédé en 1185) – qui a inventé l’idée du contrat social, adoptée par la suite par Jean-Jacques Rousseau (mort en 1778).
Il y avait aussi des penseurs musulmans comme Ibn Baja et Ibn ‘Aqil, qui estimaient qu’il était assez dangereux de faire dépendre exclusivement le « bon » et le « mauvais » du commandement divin, parce que le commandement divin en soi est représenté à travers la volonté de l’Homme.
Ils croyaient que Dieu avait placé son ipséité ou ses attributs dans sa création, et que la distinction entre le bien et le mal ou entre la lumière et les ténèbres, se faisait à travers l’étude de la création divine qui nous permettait de comprendre les attributs de Dieu, étude qui constituait alors la base des droits naturels.
Mais lorsque la civilisation islamique devint une puissance impériale, s’étendant en Europe et ayant un plus grand nombre de personnes sous son contrôle – souvent à travers une occupation militaire pure et simple – l’idée de droits naturels finit par céder la place à la notion de commandement divin que tel qu’il était révélé, à travers le texte, et ce furent les experts du texte qui interprétèrent ensuite le commandement divin, en le rationalisant et le justifiant.

À bien des égards, cette dynamique n’est guère surprenante car nous la voyons se répéter dans d’autres civilisations – ce passage d’une flexibilité intellectuelle (ou, si vous voulez, une tradition d’humanisme, une tradition d’ouverture ou une tradition du don) vers son contraire, où les peuples, les empires et les États deviennent intoxiqués par leur propre pouvoir et ressentent de plus en plus un sentiment de justice morale qui les conduit à faire de la morale quelque chose défini par un groupe d’élite agissant en tant que gardiens et protecteurs de la «vérité» et rendant cette « vérité » toujours plus exclusive.
Dans le cas islamique, ce sont les Ahl al-Hadith qui se considéraient comme les gardiens du texte.
C’est la même école de pensée qui a pris finalement la forme du wahhabisme, l’école puritaine dominante qui s’est propagé à travers l’Arabie saoudite et au-delà.
Ce n’est pas un hasard si la même école qui arrive à sa conclusion logique ultime sous la forme du puritanisme de l’Arabie saoudite – et qui finira par générer certaines formes de terrorisme – est née à une époque où les musulmans vivaient collectivement leur plus grand niveau d’insécurité politique.
Je pense que le cycle historique est sur ce point divin.
C’est comme si une leçon divine ou une instruction divine nous était prodiguée nous enseignant que le peuple qui commence par être porteur de la vérité, en s’attribuant le monopole du commandement divin, finissait par être le peuple qui justifiait finalement le terrorisme.
Du libre choix au textualisme
En dehors de la tradition islamique, nous ne pouvons pas oublier que la loi naturelle, les droits naturels et la tradition des droits de l’homme ont été utilisés abusivement à plusieurs reprises à notre époque moderne pour tout justifier, des formes d’esclavage au colonialisme, de l’impérialisme aux formes d’intervention politique paternaliste.
Ce que je soutiendrai en fin de compte est que la base de ce qui définit le divin, le bien ou le beau, que ce soit au sein de l’islam ou en dehors – est la notion de caractère volontaire ou de choix rationnel.
Assez souvent à l’ère moderne, dans toutes les interventions politiques qui ont détruit les cultures autochtones des peuples – qui les ont converties de force, détruit leur patrimoine ou leur langue, exploité leurs ressources ou, pire encore, les ont tout simplement massacrées – il y a eu ce déni ultime de choix vis-à-vis de l’autre car « nous savions plus » ou « nous savions mieux » que lui.
C’est quelque chose que nous négligeons souvent dans la tradition moderne des droits de l’homme, et que je perçois comme un parallèle au passage d’une école de la bonté naturelle à une école de la bonté strictement révélée : la transition, à l’ère moderne, d’un modèle des droits de l’homme orienté vers la recherche ouverte du bien naturel à un modèle des droits de l’homme comme produit du consensus entre les États souverains – en d’autres termes, une théorie du droit positif où les États négocient et posent ce qui est et ce qui n’est pas un droit de l’homme.
Ensuite, une fois que les États parviennent à un accord par le biais du Pacte international relatif aux droits civils et politiques ou de la Déclaration universelle des droits de l’homme ou de tout autre instrument, cette source scripturaire va déterminer ce qu’est le droit, et même, parfois, justifier une violation de principe.
Très souvent, le textualisme est révélateur de la perte de la vision morale de ce qui est censé être représenté par le principe de la liberté religieuse, l’idée qu’il est fondamental qu’un être humain puisse choisir sa foi.
L’essentiel de ce qui définit l’obligation est la capacité de choisir rationnellement.
En d’autres termes, dans les situations où les gens sont libres de choisir, on peut dire que nous analysons un droit d’une certaine manière, mais lorsque les gens ne sont plus libres de choisir, nous l’analysons d’une manière différente.
Les droits de l’homme ont-ils sécularisé la Divinité ?
Il y a un problème critique concernant la raison et la rationalité qui doit être clarifié à ce stade.
La conception contemporaine des droits de l’homme, fondée sur la notion de contrat social – ou ce que j’appelle le modèle rousseauiste des droits de l’homme, dans lequel la négociation entre les États crée un texte écrit – pose un défi aux communautés religieuses.
Si les États peuvent négocier un texte, le rédiger et le produire, alors pourquoi aurions-nous besoin de Dieu pour la tradition des droits de l’homme ?
Dès lors que nous avons des droits humains, qu’est-ce que Dieu peut ajouter à cette dynamique?
La source divine joue un rôle critique dans la création de la notion d’obligation, de sorte que l’obligation venant de la divinité devient une acceptation de la grâce, une acceptation de la bonté, une acceptation de la miséricorde et d’un état de bénédiction, plutôt que le simple respect formel des mécanismes juridiques ou des instruments du droit.
En d’autres termes, le droit positif, le droit négocié ou le droit scripturaire ne peuvent pas créer un état de grâce, ne peuvent pas créer un état de paix, ne peuvent finalement pas créer un état de lumière digne de représenter la bonté des droits de l’homme.
Ils ne peuvent que mimer l’état de grâce, l’état de lumière ou l’état divin.
Permettez-moi d’aborder cette problématique sous un angle différent, à travers l’un des passages mémorables de Rousseau dans Le contrat social.
N’oubliez pas que Rousseau était responsable d’une idée qui est peut-être venue marquer toutes les traditions laïques en Europe, en particulier dans des pays comme la France – l’idée de religion civile.
Rousseau soutient qu’en principe, nous avons besoin de dieux, et pas d’hommes, pour légiférer.
Il ne défendait pas réellement de rôle pour l’église, mais soutenait que la loi est si difficile que, comme le dit le passage, nous avons besoin d’hommes capables de voir dans l’avenir, d’hommes capables d’être objectifs et ainsi de suite.
D’une certaine manière, il créait cette construction théorique d’un législateur assimilé au divin sans être réellement divin.
Cela a permis alors à Rousseau de faire valoir que dans une société civile, la religion devient une religion civile – religion contrôlée, dirigée et définie par l’État.
Ce modèle est très différent de celui que nous avons aux États-Unis, dans lequel nous parlons d’un État gardant une distance envers toute implication religieuse, et s’il s’implique religieusement, il doit s’impliquer également avec toutes les religions.
Ceci est similaire au modèle proposé par John Stuart Mill (mort en 1873), par opposition à celui de Rousseau.

Le modèle rousseauiste de l’État, en tant que source ultime et absolue de bonté, est celui qui a prévalu depuis le colonialisme dans tous les pays du Moyen-Orient sans exception, et il a permis à l’État d’agir avec un sentiment d’absolu, et d’une manière dénuée d’équivocité et de relativité.
Mais dans le même temps, cette approche limite sévèrement la potentialité de la grâce – le pouvoir ou le potentiel qui provient d’une reconnaissance volontairement individuelle de la divinité.
C’est dans le modèle rousseauiste que l’on finit par se disputer, par exemple, pour savoir quelle religion est compatible ou pas avec la religion civile dominante.
C’est exactement ce que nous voyons se produire en France, en Suisse et dans d’autres pays européens concernant le statut des musulmans.
Souvent, des arguments sont avancés selon lesquels nous ne savons pas vraiment si les musulmans font partie de la religion civile dans la mesure où ils n’auraient pas prouvé leur capacité à faire partie de la tradition religieuse civile.
Par conséquent, leur statut est provisoire et négociable, tandis que les communautés religieuses plus anciennes – juives et chrétiennes – sont déjà considérées comme faisant déjà partie de la tradition religieuse civile étant donné leur ancienneté.
Il s’agit, bien sûr, d’une manière très juridique d’aborder la question, et qui est différente de l’approche aux États-Unis, où nous ne jugeons pas quelle religion est devenue une partie du tissu civique – en supposant, au contraire, que toutes les religions sont sur un pied d’égalité.
Des affaires ont été portées devant la Cour européenne des droits de l’homme pour déterminer si les limitations des pratiques religieuses dans certaines communautés européennes impliquant des musulmans violaient la tradition des droits de l’homme (il y a des cas impliquant d’autres communautés, mais pour la plupart, les cas impliquent des musulmans.) Si vous comparez cela à certains cas aux États-Unis, les différences sont fascinantes.
Souvent à la Cour européenne, les discussions soulignent le fait que les droits de l’homme sont une grande idée, mais une idée si grande qu’il faudrait considérer ou parler plutôt des conceptions européennes des droits de l’homme.
À mon avis, c’est une contradiction dans les termes.
Soit les droits de l’homme sont universels, soit ils ne sont pas universels.
Les droits de l’homme ne peuvent pas être « européens ».
S’ils le sont, alors ce ne sont que des droits européens, pas des droits de l’homme.
Les tribunaux soutiennent souvent que nous devons rester limités à la tradition spécifique de l’Europe; mais parce que nous ne savons pas quelle est la tradition spécifique de l’Europe, nous devons nous en tenir à la Convention européenne des droits de l’homme, à savoir le véritable langage juridique de la convention.
Et parce que nous nous en tenons au langage juridique de la convention sur les droits de l’homme, il s’agit alors de savoir si cette langue incorpore la notion de religion civique et le droit de l’État – c’est-à-dire le pouvoir légitime de l’État dans la définition du rôle que cette religion va occuper dans l’espace public.
En Egypte, de nouvelles églises chrétiennes ont vu le jour et, dans un geste proche de la tradition textualiste française, la Cour suprême égyptienne a déclaré que ces églises n’avaient pas le même statut que l’Église copte car l’Église copte avait une histoire et une tradition qui lui garantissait de faire partie de la religion civique du pays, contrairement à ces nouvelles églises qui n’avaient pas atteint ce statut.
À mon avis, cette lecture sacrifie en fin de compte le principe des droits de l’homme en soi.
Dans cette situation, nous sommes passés de la liberté de penser aux droits de l’homme comme étant l’équivalent d’un état de bénédiction, de grâce ou de bonté ultime – ou ce que j’appelle dans mes écrits , un état de beauté – à un textualisme déterminé par son contexte historique que je trouve suffocant, limitatif et dangereux car il met la religion elle-même au service de l’État devenu, pour toutes les questions pratiques, une sorte de dieu laïc.
Roberto Mangabeira Unger a soutenu l’idée que les êtres humains modernes sont devenus déracinés, instables et si misérables que la solution était de développer une religion laïque des êtres humains – une vision très nietzschéenne, dans le sens où nous devrons convaincre les êtres humains qu’ils sont des dieux, que nous n’avons pas besoin d’un Dieu.
L’antithèse de la grâce
Nous nous trouvons dorénavant à un moment critique, alors qu’il existe une bataille en cours entre deux conceptions de la tradition des droits de l’homme.
Certains préfèrent le modèle nationaliste laïque rousseauiste – que ce soit en France ou en Égypte – où l’État est autorisé à déterminer la place de la religion dans l’espace public, et devient l’arbitre ultime de ce que sont les droits de l’homme et du rôle de la religion.
En revanche, divers mouvements et théoriciens en Syrie, en Jordanie, en Tunisie et au Yémen ont fait valoir que le modèle de l’État nationaliste – qui est résolument laïc, mais contrôle néanmoins le rôle et l’espace de la religion – s’il fonctionne, finit par soutenir (ou, au mieux, donner la victoire à) l’idée des droits civiques plutôt que celle des droits de l’homme.
Nous confondons souvent les deux.
Les droits civiques sont des droits qui sont produits par un consensus réel ou hypothétique de la société.
Les droits civiques sont les droits que vous avez à l’intérieur de vos frontières nationales en raison d’un document constitutionnel ou d’un système de droits appuyés sur un document textuel.
Les droits de l’homme, en revanche, sont littéralement ces droits auxquels tous les êtres humains ont droit.
Ils sont inhérents à leur nature et indéniables.
Les droits de l’homme ne nécessitent pas d’accord ; ils ne dépendent pas de la reconnaissance de quiconque les reconnaît ou les négocie.
Je ne pense pas que nous fassions quoi que ce soit pour la tradition des droits de l’homme lorsque nous soutenons la position des nations dans laquelle l’État prétend être le détenteur de la vérité, ou en définissant l’espace que Dieu peut occuper.
Si les choses fonctionnent bien pour nous, nous soutenons au mieux une tradition de droits civiques.
Il s’agit d’une distinction critique, distinction que les théoriciens, philosophes et théologiens ne parviennent souvent pas à considérer ou même à comprendre correctement.
Soit nous défendons le principe des droits de l’homme – dans son absolu et son universalité, dans sa position aveugle envers la justice et l’égalité des causes, dans son absence de réactivité envers tout élément avec lequel on peut sympathiser en tant qu’être humain – soit nous ne le faisons pas.

Il m’arrive de réaliser une expérience avec mes élèves : je leur livre un récit horrible sur un peuple qui souffre d’une terrible injustice en leur donnant une fausse identité – s’ils sont musulmans, je dis à mes élèves qu’ils sont chrétiens, et vice versa.
Je leur demande leur réaction.
Une fois qu’ils ont rédigé leurs réponses, je leur dévoile l’identité réelle des peuples dans l’histoire.
Je reçois à nouveau leur réaction. Le subtil changement de langage entre les deux réponses est l’espace où se révèle la différence entre les droits civiques et les droits de l’homme.
Les droits de l’homme sont un acte de grâce.
Même si vous ne vous reconnaissez pas comme ayant ce droit, je vous l’étends par respect, comme une extension de ma propre conscience et de mon sens du devoir.
Mon obligation est de présenter le bien et de l’offrir. Que les gens l’acceptent ou non, vous l’offrez.
En l’offrant, vous avez respecté mes droits humains. Et vous avez défendu le principe des droits de l’homme.
En même temps, si quelqu’un ose me forcer à faire quelque chose, il viole mes droits de l’homme et tombe dans un paradoxe et une contradiction et, finalement, dans l’hypocrisie.
Comme la foi elle-même, vous ne pouvez qu’inviter.
Une fois que vous commencez à obliger les gens à aller au-delà de l’invitation et à dire que vous ne les nourrirez pas à moins qu’ils ne se convertissent, ou que vous leur retirerez leurs privilèges, ne payerez pas leurs factures ou ne financerez pas leurs collèges à moins qu’ils ne se convertissent, alors vous venez de pénétrer dans un territoire contraire à la foi, une antithèse de la grâce.
Les droits de l’homme sont comme un état de grâce.
Le Divin ne nous a pas forcés à croire au Divin. Le Divin ne nous a pas obligés.
Si Dieu avait voulu, Dieu aurait pu nous créer tous chrétiens, ou musulmans, ou blancs, ou uniformes.
Mais le fait que Dieu ne l’ait pas fait, en soi, en dit long.
Pour moi, cette réflexion forme la genèse, le début de mon analyse des droits humains.
Khaled Abou El Fadl
A lire aussi :