Dernière partie de l’étude de Gulnaz Sibgatullina, du département d’histoire de l’université d’Amsterdam, consacrée à l’islam russe. L’échec d’une relation de profit mutuel entre les muftiats et l’Etat ressort clairement et l’abandon des doctrines non traditionnelles en forme les marqueurs.
Enfin, la DUM RF a tenté, également sans succès, de promouvoir les idées d’un islam russe libéral universel. Au début des années 2000, le muftiat a adopté le projet d’« humanisme coranique », développé par un chercheur de l’Académie des sciences de Russie, Taufik Ibragim. Ibragim estime que, dans le contexte actuel d’extrémisme d’inspiration religieuse et de stagnation de la pensée musulmane, il est nécessaire de souligner la tolérance du Coran et le caractère humaniste de l’islam en général. Dans cette refonte du Coran, Ibragim met l’accent sur la responsabilité morale et la faculté rationnelle de l’individu ; pour argumenter la compatibilité de sa doctrine avec les réalités russes, il s’appuie également sur l’héritage des Jadids tatars (Kemper et Sibgatullina).
La DUM RF a adopté la philosophie religieuse d’Ibragim comme un élément essentiel d’une nouvelle idéologie islamique. Pourtant, après une période de collaboration active entre la DUM RF et Ibragim entre 2015 et 2007, la notion d’« humanisme coranique » a soudainement disparu du discours public du muftiat. Le projet a été censuré à la suite de scandales entourant deux disciples autoproclamés de Taufik Ibragim (Bekkin).
Les adversaires de la DUM RF lui ont reproché d’avoir adopté la méthode « fondamentaliste » rejetant des siècles d’études du hadith au profit d’un accès direct au Coran. Sous la pression publique, la DUM RF a dû émettre une fatwā (Aliautdinov) contre les « Coranistes » (russe : koranité ), identifiant indirectement le groupe autour du savant comme une secte hérétique.
L’idéologie religieuse russe est conservatrice
L’adhésion générale d’Ibragim au libéralisme politique et aux droits humains internationaux est indéniable, car il se prononce ouvertement en faveur de sociétés respectueuses de la diversité, de la liberté religieuse, du multiculturalisme, de l’équité et de la tolérance. Bien que les réactions négatives proviennent principalement des milieux intra-musulmans, une telle idéologie s’inscrit manifestement mal dans le discours conservateur actuel sur les valeurs familiales en Russie, qui privilégie la souveraineté juridique nationale aux engagements internationaux en matière de droits humains.
Globalement, l’expérimentation idéologique a cessé après 2014 en raison de plusieurs facteurs externes et internes. Parmi les facteurs externes, on compte les événements majeurs sur la scène internationale (la crise syrienne, l’insurrection de Daech, les retombées diplomatiques de l’annexion de la Crimée et le crash du vol MH17), ainsi qu’un tournant conservateur dans le discours public russe après les manifestations de 2011-2013, qui ont contraint le Kremlin à adopter une posture idéologique plus rigide.
A lire aussi : Les fonctions étatiques de l’islam en Russie 1/3
Parmi les facteurs internes, on compte les graves remises en cause de l’autorité du DUM RF, qui ont poussé Gaïnoutdin et ses associés à abandonner des projets risqués et à se concentrer sur le maintien de leur influence politique. Depuis 2011, les relations entre le DUM RF et le Muftiat du Tatarstan (DUM RT) se sont dégradées, aboutissant à un scandale public13 autour d’un nouveau tafsir publié par la DUM RT en 2019.
La tentative de Gainutdin de placer les petits muftiates sous la juridiction directe de la DUM RF en 2020 a conduit à de (nouveaux) éloignements de la DUM de la partie asiatique de la Russie et de la DUM de la République du Bachkortostan (Akhunov). Dans les domaines de l’éducation religieuse, de la littérature et de la production de normes, ainsi que dans l’établissement de contacts avec les organismes islamiques internationaux, la DUM RF est confrontée à une rude concurrence de la part de la DUM RT, du Muftiat du Daghestan et d’une autre institution faîtière créée en 2016, l’Assemblée spirituelle des musulmans de Russie (Dukhovnoe sobranie musul’man Rossii).
Les muftiates, gestionnaires de la norme
Après 1991, l’engagement des muftis envers la théologie islamique visait principalement à légitimer la politique et la législation de l’État d’un point de vue islamique. À cet égard, les autorités islamiques post-soviétiques ont imité les mesures prises par l’Église orthodoxe russe après 1991 et ont repris certaines pratiques employées par les muftis durant les périodes impériale et soviétique.
Au début des années 2000, la ROC a publié plusieurs doctrines sur des questions d’enseignement social (2000) et de droits de l’homme (2008). L’analyse de ces doctrines a montré qu’elles visaient non seulement à clarifier les positions de la ROC sur les questions sociales, mais aussi à servir d’instruments essentiels pour négocier les relations entre l’Église et l’État et mener une « diplomatie religieuse » à l’étranger (Agadjanian ; Stoeckl).
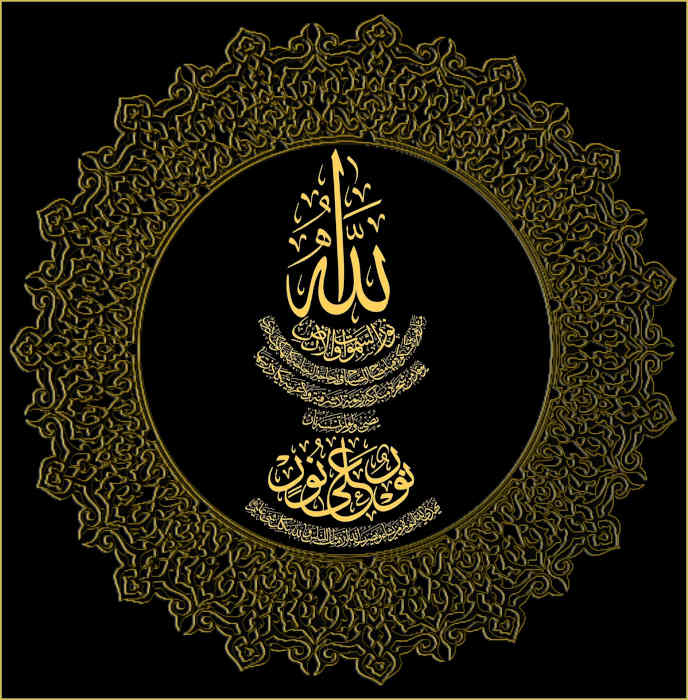
Les principaux documents publiés par les muftiats fédéraux durant la période post-soviétique ont, comme on pouvait s’y attendre, suivi le modèle des doctrines de l’Église, mais seulement dans la forme. En 2015, les muftiats fédéraux ont approuvé la « Doctrine sociale des musulmans de Russie » (Sotsial’naia doktrina rossiiskikh musul’man), qui faisait suite aux « Dispositions fondamentales du programme social des musulmans de Russie » (Osnovnye polozheniia sotsial’noi programmy rossiiskikh musul’man) de 2001.
Ces documents visaient à expliquer aux musulmans de Russie comment concilier les normes prescrites par l’islam avec la citoyenneté d’un État russe laïc. Alors que le document de 2001 abordait principalement des questions liées à la vie musulmane au sein d’un nouveau système politique post-soviétique, la doctrine de 2015 répondait aux « Thèses d’Oufa » de Poutine (Tezisy) et a instruit les musulmans sur la « socialisation » au sein de la société russe dominante.
La doctrine sociale de l’islam, entre stabilisation et contestation
Les doctrines ne sont pas devenues le fondement d’un nouveau contrat social entre l’État et les croyants musulmans, comme les muftiates l’imaginaient. La communauté musulmane n’a participé ni à la discussion ni à la rédaction des documents et est restée largement sceptique à l’égard de ces initiatives (Tuaev).
De plus, l’événement largement symbolique de la signature du document de 2015 ne s’est pas déroulé sans conflit : le refus des autorités musulmanes tchétchènes d’accepter la doctrine a révélé la concurrence profondément enracinée entre les muftiats fédéraux et les dirigeants tchétchènes pour attirer l’attention du Kremlin.14 L’intransigeance des pouvoirs locaux dans le Caucase du Nord a également prouvé l’incapacité du DUM RF ou du TsDUM à consolider leur pouvoir au-delà de la Russie centrale.
Durant la présidence de Poutine, les muftiats ont également tenté de reprendre leur fonction en empêchant l’islam de devenir une force de mobilisation pour la rébellion des musulmans dans un État non musulman.15 Pourtant, en proie à une profonde crise de légitimité, les muftiats n’ont pas réussi à asseoir leur autorité sur les dirigeants musulmans locaux, plus charismatiques et indépendants. Afin de peser davantage dans la définition des normes théologiques, les muftiats fédéraux ont conclu un accord avec l’Union internationale des oulémas musulmans (UISM), qui comptait parmi ses membres des théologiens islamiques influents tels que Yusuf al-Qaradawi et Ali al-Qaradaghi.
A lire également : La domestication politique de l’islam russe 2/3
Ces savants musulmans étaient censés implanter l’idée de « modération islamique » – la doctrine de la médianité de l’islam, al-wasaṭiyya– sur le sol russe. Cette collaboration a été orchestrée par Polosin et soutenue par des fonctionnaires politiques influents et des universitaires laïcs (Sibgatullina). Ce partenariat a donné lieu à la signature de plusieurs documents. La Déclaration de Moscou de 2012, par exemple, visait à donner des interprétations théologiquement « correctes » des concepts controversés de « djihad » et de « califat » afin de « priver les extrémistes [islamiques] de leur fondement idéologique » (Deklaratsiia).
Les conférences de Makhatchkala en 2012 et 2014 ont déclaré le Daghestan (plus tard également la région de Stavropol) dār al-Islām, le « territoire de l’Islam », interdisant ainsi le djihad dans la région comme contraire aux normes islamiques (Fetva). Cependant, ces déclarations régionales, conçues pour soutenir les chefs spirituels musulmans locaux, ont eu peu d’effets pratiques (Vatchagaev). La coopération avec l’UIMS a été interrompue suite à l’intervention russe en Syrie (en 2012, al-Qaradawi a dénoncé la Russie comme « l’ennemi n° 1 » de la communauté musulmane mondiale en raison du soutien de Poutine au régime syrien) (Malashenko).
Les défis de la « sunnification »
En fournissant des interprétations théologiques faisant autorité, les muftiats doivent faire face à l’augmentation constante du niveau d’éducation religieuse parmi les musulmans de Russie. Si, au début des années 1990, il n’existait pratiquement aucun système établi d’éducation religieuse, les années suivantes ont vu la construction de nombreuses écoles, voire d’instituts et d’universités, pour la formation des cadres religieux (Kemper).
Avec l’ouverture des frontières, de nombreux jeunes musulmans ont voyagé à l’étranger pour étudier et ont établi des contacts avec des organisations musulmanes internationales.
Depuis les années 2010, on observe une tendance vers une interprétation plus théologique du concept d’« islam traditionnel », que Matteo Benussi et d’autres ont qualifié de « sunnification ». Autrement dit, le degré croissant d’éducation religieuse – parmi les dirigeants musulmans et au sein de la communauté musulmane – exige de dépasser l’« islamité ethnique » et de s’intéresser de près aux sources.

Cet ancrage théologique vise, d’une part, à établir une tradition avec les écoles théologiques musulmanes de la Russie impériale ; d’autre part, l’argumentation théologique sert un objectif idéologique : satisfaire les besoins des musulmans pieux en quête d’un islam plus « doctrinal », risquant ainsi de quitter l’emprise des muftiates et de rejoindre des mouvements indépendants (Benussi ; Di Puppo).
Ce processus de « sunnification » pourrait expliquer en partie le tournant des muftis fédéraux vers le hanafisme traditionnel pour régler les différends théologiques mineurs au sein de la communauté musulmane. Un bref aperçu de la série des déclarations théologiques adoptées par la DUM RF en 2019-2020 sur les questions liées au mariage et à la famille (DUM RF) révèle, d’une part, le processus d’adoption d’interprétations de plus en plus conservatrices des normes islamiques (Kemper) ; d’autre part, ces documents approuvent la démarche de l’État et de la ROC visant à retraditionnaliser la société au sein de la communauté musulmane.
La dépendance de l’islam russe à l’Etat
Cette contribution a retracé les principales tendances évolutives des relations entre l’État et les muftiates au cours des trente dernières années post-soviétiques, en se concentrant sur les discours produits par les autorités islamiques. Le système des muftiates, les organisations spirituelles pour les musulmans, a survécu à la chute du communisme, notamment parce que, à la fin des années 1990 et au début des années 2000, l’État a exprimé son besoin de partenaires loyaux pour exercer son contrôle sur la population musulmane de Russie.
Dépendantes de l’État pour leurs ressources financières et politiques, les DUM fédérales ont tenté de devenir un équivalent islamique des organisations de la République de Chine, une « Église nationale de l’islam », bénéfique tant à l’État qu’aux DUM pour consolider leur pouvoir. Au fil des ans, les muftiates ont produit trois types de discours afin de (1) marquer leur loyauté envers l’État ; (2) fournir un cadre idéologique pour ancrer l’islam comme religion originaire de Russie ; et (3) aligner les principes islamiques sur le programme politique de l’État. L’analyse de ces discours a montré que malgré des efforts considérables, début 2022, les DUM n’ont pas réussi à parvenir à une dépendance mutuelle (et non unilatérale) dans leur relation avec l’État.
Les limites de l’action pyramidale
Les principaux muftis actuels de Moscou et d’Oufa se sont positionnés comme les successeurs des institutions impériales et soviétiques. Bien qu’il existe certainement des chevauchements dans leurs fonctions de gestion et de contrôle, les prétentions à la continuité ignorent les bouleversements dévastateurs de l’histoire des muftis et des communautés religieuses russes en général, qui rendent ces prétentions infondées. Ni l’État ni l’ oumma russe ne reconnaissent aucun successeur direct (TsDUM) ou supposé (DUM RF) comme institution possédant une tradition à préserver pour des raisons socioculturelles ou politiques.
De plus, les tentatives de créer une organisation faîtière unifiée qui, à l’instar de la République de Chine, pourrait encore contenir une diversité de voix sont a priori vaines, compte tenu de la diversité culturelle, historique et sociale de l’oumma russe. L’idée d’« islam traditionnel » prônée par l’État met l’accent sur cette même diversité culturelle, idéologique et ethnique, complexifiant ainsi davantage les efforts visant à unifier une communauté extrêmement multiforme.
Les projets visant à imposer des idéologies supra-ethniques, comme l’humanisme coranique ou l’al-wasaṭiyya , ne connaissent pas de succès et sont généralement accueillis avec scepticisme par les musulmans ordinaires, car ils sont introduits de manière descendante et conçus sans tenir compte des besoins réels des croyants.
Enfin, les muftis manquent de fondement pour jouer un rôle « messianique » plus large et se rendre utiles à un État engagé dans une politique étrangère ambitieuse. Bien que les muftis fédéraux entretiennent des liens personnels avec les dirigeants du Moyen-Orient, ils ne disposent pas du poids politique nécessaire pour mener une diplomatie religieuse fructueuse. Dépourvus d’autorité au sein des communautés musulmanes de Russie, les muftis n’ont pas non plus réussi à justifier les interventions étrangères de l’État.
La persécution des indésirables
Dans un contexte d’islamophobie prononcée et de restriction constante de leur marge de manœuvre idéologique, les muftis doivent abandonner leur quête de produits idéologiques originaux et se limiter à des discours sur la loyauté et le patriotisme, ce qui revient essentiellement à suivre l’exemple de la République de Chine.
Face à l’absence persistante d’indépendance idéologique des muftis et à leur convergence (attendue) avec la République de Chine, leurs fonctions se limitent de plus en plus à des tâches administratives, tandis que la gouvernance étatique des communautés musulmanes prend de plus en plus des formes de sécurisation et de persécution des communautés et individus indésirables.
Gulnaz Sibgatullina



