Un Observatoire franco-algérien contre les discrimination vient d’être lancé dans un contexte français marqué par la montée en puissance d’un discours politique anti-algérien. Nabil Mati, engagée dans cette dynamique, nous en dit plus dans une tribune à lire sur Mizane.info.
Depuis plusieurs années, le climat politique et médiatique en France pèse lourdement sur la communauté algérienne résidente. Cette tension, déjà perceptible, s’est amplifiée avec l’affaire Boualem Sansal, devenue le symbole d’un discours de disqualification visant l’Algérie et ses ressortissants.
De plus en plus souvent, des propos à tonalité algérophobe s’invitent dans l’espace public, relayés par certains médias et amplifiés par des figures de la droite dure et de l’extrême droite. Ainsi, Éric Zemmour a été qualifié par Jeune Afrique d’entretenir une véritable « névrose algérienne », en raison de ses déclarations hostiles répétées à l’égard de l’Algérie et de ses ressortissants.
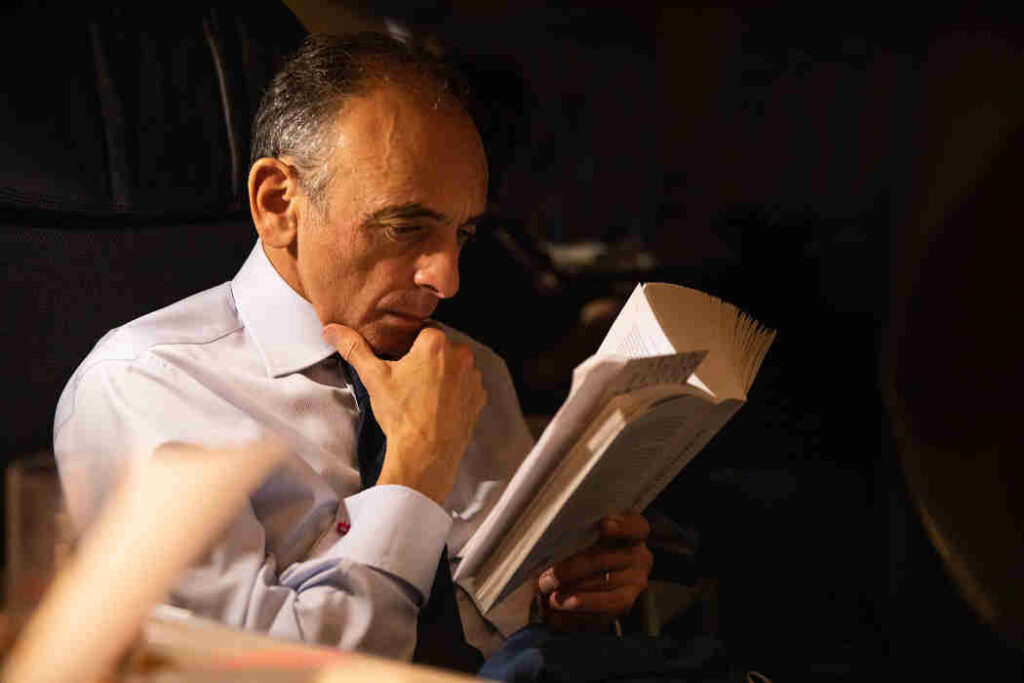
De son côté, Pierre Lellouche affirmait sur CNEWS : « On est en pleine dégringolade, et c’est pourquoi les Algériens s’essuient les pieds sur la France. » Enfin, lors d’un débat télévisé consacré à l’affaire Boualem Sansal, Noëlle Lenoir a tenu des propos particulièrement préoccupants, évoquant « des millions d’Algériens » qui « présenteraient des risques majeurs, pouvant sortir un couteau dans une gare ou foncer en voiture dans une foule ».
Ces dérives verbales, dénoncées par plusieurs associations et personnalités, traduisent une tendance lourde : celle d’une stigmatisation décomplexée d’une communauté tout entière, présentée comme une menace. Ces attaques répétées participent, semble-t-il, d’une stratégie politique consciente : fabriquer un « ennemi intérieur », détourner l’attention des véritables enjeux sociaux et entretenir un climat de peur et de division. Ce phénomène ne relève pas du hasard : il s’inscrit dans une logique où la stigmatisation devient un instrument de contrôle symbolique et de diversion électorale.
Un tournant historique : mobilisation ou résignation ?
Face à cette situation, la communauté algérienne de France se trouve aujourd’hui à un tournant historique. Deux voies s’offrent à elle : celle de la résignation et du retrait, voire du départ anticipé, scénario rêvé par les milieux racistes et xénophobes, ou celle de la mobilisation citoyenne, organisée, pacifique et structurée pour faire face collectivement à ces dérives.

De nombreux acteurs associatifs, intellectuels et citoyens estiment que le temps du silence est révolu. Une nouvelle génération, mieux formée, connectée et consciente de ses droits, refuse d’être spectatrice de sa propre caricature. « Ça suffit, nous ne sommes pas le paillasson de l’extrême droite et de la droite française. Quand ça va mal, c’est la faute des Algériens », nous confie avec fermeté l’un des coordinateurs. Avant d’ajouter : « Le temps de la victimisation est derrière nous. Désormais, celui qui veut nous insulter devra répondre de ses actes devant la justice. »
Naissance d’un Observatoire franco-algérien contre les discrimination
C’est dans cette dynamique qu’est né un collectif d’action et de réflexion, fruit d’initiatives locales et de nombreuses discussions entre militants associatifs sur les réseaux sociaux, notamment sur TikTok. Pour la première fois, un Observatoire franco-algérien contre les discriminations voit le jour en France.
Il rassemble des cadres, des juristes, des ouvriers et des citoyens engagés autour d’un même objectif : recenser, analyser et dénoncer les propos, porter plainte contre les actes racistes ou xénophobes visant la communauté algérienne résidente en France, tout en refusant la fatalité et en construisant un réseau solidaire et structuré.
Il faut rappeler que les Algériens en France constituent la première communauté issue de l’immigration et l’une des plus anciennes. Estimée entre quatre et cinq millions de personnes, entre résidents et Franco-Algériens de plusieurs générations, cette communauté représente une composante essentielle du tissu social français. Ses apports économiques, culturels, scientifiques et artistiques sont indéniables, mais trop souvent passés sous silence.
L’Algérien qui réussit n’est pas toujours valorisé, car il ne correspond pas au récit dominant que certains veulent imposer. Reconnaître cette réalité, ce n’est pas diviser, c’est rétablir la vérité et refuser la caricature. C’est affirmer que la pluralité est une richesse et que la fraternité ne doit pas rester un mot gravé sur les frontons, mais un principe vécu au quotidien.
Aujourd’hui, la mobilisation ne vise pas à opposer, mais à affirmer la dignité, la légitimité et la contribution pleine et entière des Algériennes et des Algériens à la société française. Ce réveil collectif marque peut-être la fin d’une longue période de silence et le début d’une parole assumée, fière et citoyenne militante.
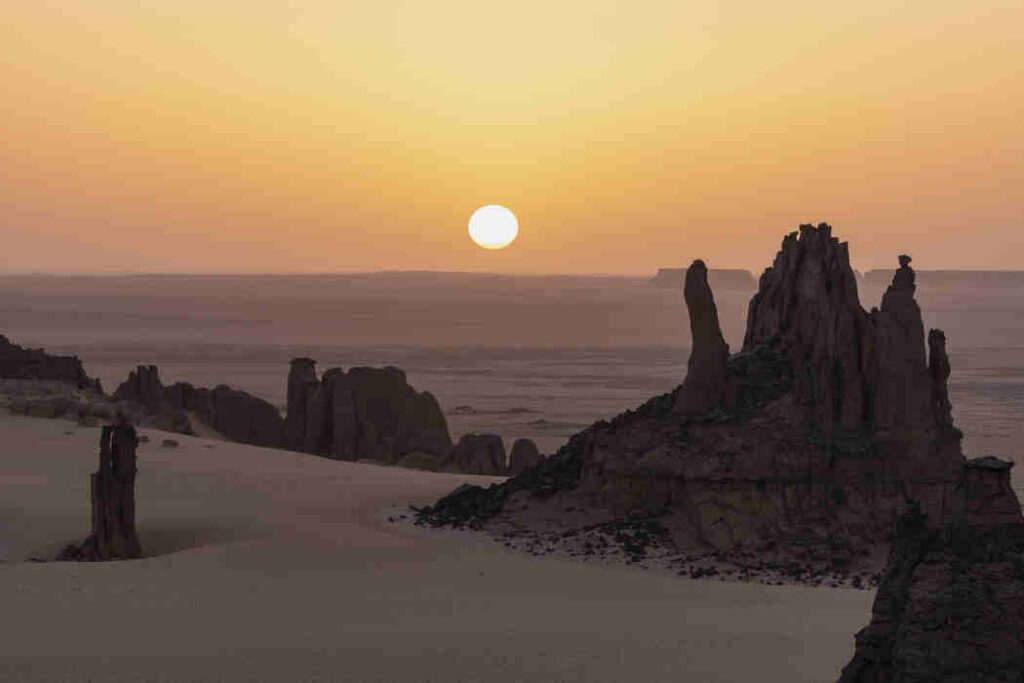
Cette initiative pourrait encourager la création d’autres collectifs déterminés à se défendre, par les voies juridiques, contre les discriminations qui touchent la communauté franco-algérienne. Il est essentiel de le rappeler avec force : la discrimination est un délit, et le droit français offre des recours pour protéger chaque citoyen face aux propos ou aux actes racistes. L’histoire l’a maintes fois démontré : les droits ne se mendient pas, ils se conquièrent par l’unité, la persévérance et la justice.
L’initiative portée par ce collectif illustre un changement d’époque, celui d’une génération qui choisit le dialogue et la justice plutôt que la colère ou la résignation. C’est précisément pour cette raison que l’heure n’est plus à l’attentisme, mais à l’action collective, pacifique et déterminée. L’heure est à la construction d’une société plus juste, où chacun, quelle que soit son origine, peut vivre dans la dignité et le respect.
Nabil MATI
Militant associatif
Enseignant Université Paris
L’École des Hautes Études des Sciences Sociales de Paris
EHESS ( formation anthropologie )
Pour contacter le Collectif : observatoirefrancoalgeriens@gmail.com



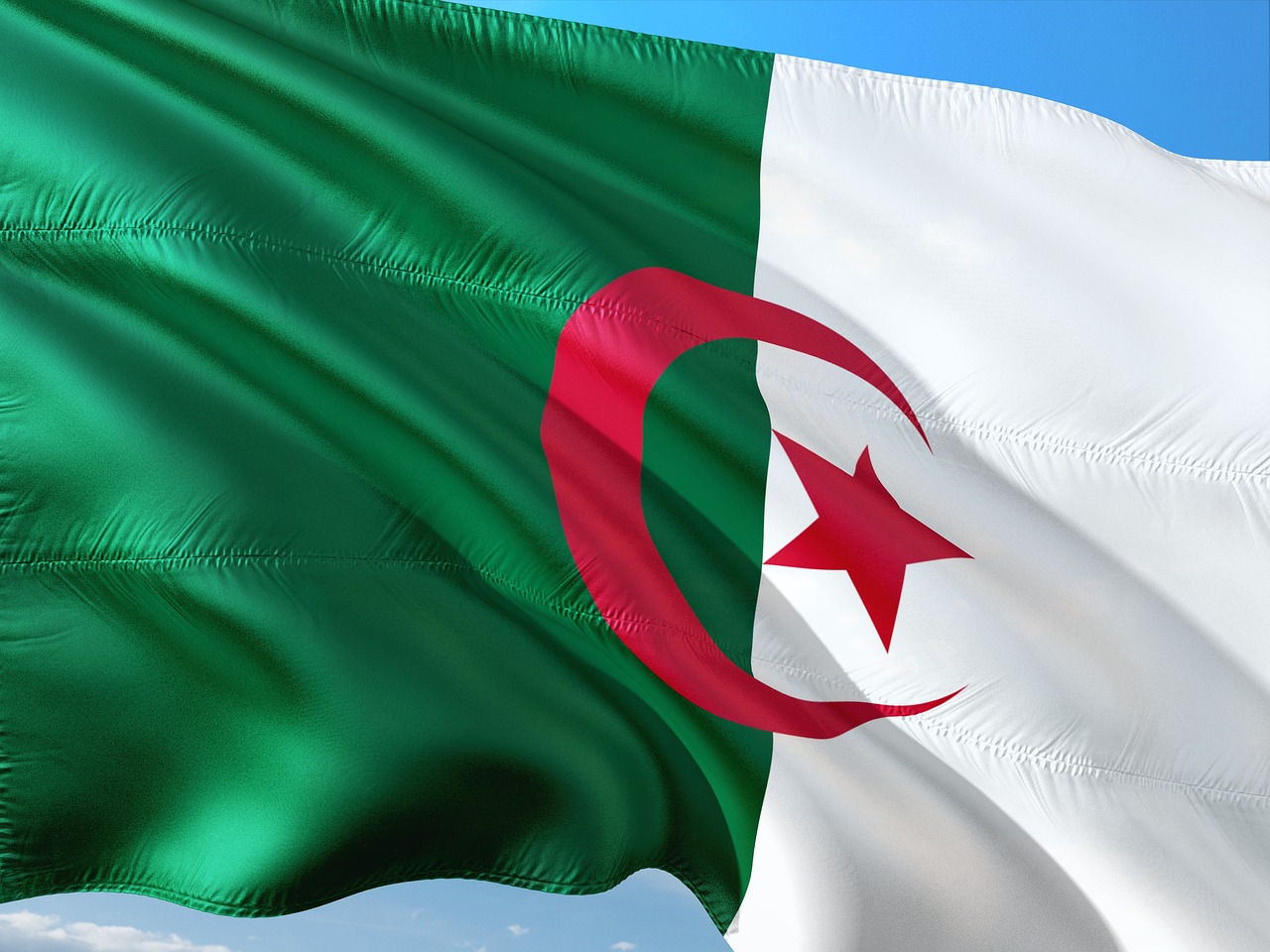

2 réponses
Excellent
Bravo, organisez une collect l argent est le nerf de la guerre des droits