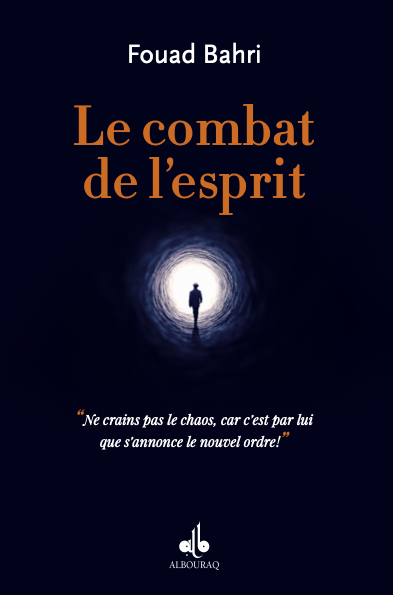On présente souvent le patriarcat comme un produit de la bourgeoisie et plus généralement du capitalisme. Pour les courants féministes, capitalisme et patriarcat iraient de pair. Cette vision réductrice est non conforme au développement de l’esprit bourgeois, comme l’explique le philosophe Alexandre Kojève dans un texte extrait de son ouvrage « La notion de l’autorité » (édition Tel Gallimard).
Notons d’abord que cette théorie (NDLR : la théorie moderne de la séparation des pouvoirs exécutif, législatif et judiciaire) ne distingue que trois Pouvoirs. Le Pouvoir judiciaire correspond évidemment à l’Autorité de Juge, le Pouvoir législatif n’est rien d’autre que l’autorité de Chef, vu qu’il s’agit là d’initiative, de projet, de décisions prises en vue de l’avenir.
Quant au Pouvoir exécutif, il correspond à l’Autorité de Maître s’exerçant dans le présent, étant action par excellence, il exige de son représentant une abnégation totale, la subordination de tout, et de la vie même, à l’État, c’est-à-dire à quelque chose d’essentiellement non biologique. Autrement dit, d’office et sans nulle discussion, cette théorie élimine de l’Autorité politique le quatrième élément constitutif, c’est-à-dire l’Autorité de Père.
C’est donc une amputation de l’Autorité qu’avaient en vue les théories scolastique et absolutiste. Et on est tenté de dire que l’Autorité politique se décompose ou se désagrège (se divise) précisément à cause de cette amputation.
Tout ici est significatif et qu’il y ait amputation, et que le membre amputé soit précisément l’Autorité du Père, et que cette amputation s’effectue tacitement, c’est-à-dire inconsciemment. L’Autorité du Père signifie tradition, détermination par le passé, présence réelle du Passé dans le Présent. La suppression de l’Autorité de Père a donc un caractère nettement révolutionnaire, la théorie constitutionnelle est née de l’esprit de révolte et de révolution, et elle engendre la révolution (bourgeoise) dans la mesure où elle se réalise.

Cette théorie, et la Révolution qu’elle présuppose, implique et engendre sont bourgeoises : le Bour-geois veut oublier ses « basses » origines de « roturier », il renie inconsciemment son passé « honteux ». D’où l’inconscience de l’annulation de l’Autorité de Père. Dans la mesure où le Bourgeois est fier de son passé et se modèle sur lui, il n’est pas révolutionnaire. Il ne le devient que dans et par son opposition au noble.
Or, par cette opposition même, il reconnaît la valeur exclusive de la noblesse, puisqu’il ne voit plus moyen de coexister avec elle. Et il y voit une valeur, puisqu’il veut se mettre à la place du noble. Il nie donc, inconsciemment, la valeur bourgeoise, c’est-à-dire son passé bourgeois qui n’est plus, à ses propres yeux, qu’un passé de roturier. C’est alors seulement qu’il devient « constitutionnel », c’est-à-dire revendique la séparation des Pouvoirs, qui ne sont pour lui désormais qu’au nombre de trois et par cela même il devient, ou est, révolutionnaire.
Mais le Présent, privé du Passé, n’est humain, c’est-à-dire historique ou politique, que dans la mesure où il implique l’Avenir (sinon, c’est un Présent de brutes). Or, l’Avenir est représenté par l’Autorité du Chef, par l’Autorité qui appartient aux « projets » qui dépassent essentiellement le donné et ne sont pas seulement de simples conséquences de ce dernier, déjà virtuellement présents en lui.
L’Autorité politique, amputée de son membre « Père », devient donc nécessairement, dans la mesure où elle reste politique, avant tout une Autorité de Chef (de type C (Chef) [M (Maître). J (Juge)] ou C→ (J. M)). C’est ainsi que la « théorie constitutionnelle », dans et par sa réalisation révolutionnaire « bourgeoise », aboutit nécessairement à la Dictature d’un Napoléon ou d’un Hitler.
Mais puisque le Présent, privé de passé, doit nécessairement impliquer l’Avenir pour pouvoir être humain, voire politique, le Chef-Dictateur doit toujours représenter un « projet révolutionnaire » en voie d’exécution. Ainsi, l’aboutissement logique de la « théorie constitutionnelle » d’un Montesquieu est la théorie de la « révolution permanente d’un Trotski ».
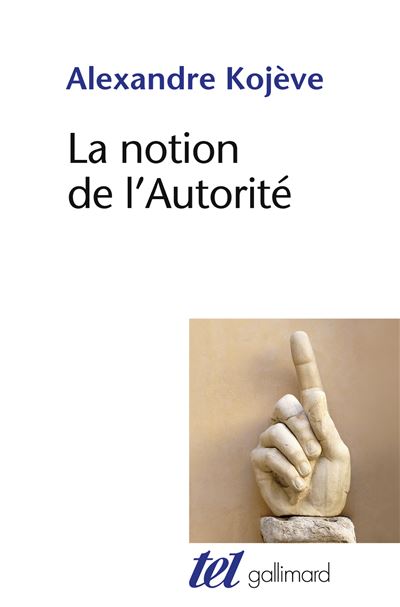
La période « bourgeoise » peut être symboliquement placée entre 1789 et 1940. 1789/1848 : c’est la « révolution bourgeoise » ; 1848/1940, la « domination bourgeoise ». Dans la période « révolutionnaire » la Bourgeoisie est tournée contre le Passé et vers l’Avenir. Aussi, en s’appuyant sur l’Avenir, a-t-elle pu transcender le Présent également du côté du Passé : tout en reniant le Passé immédiat de l’ « Ancien Régime », elle a pu – ou aurait pu et dû – accepter la codétermination par le passé « historique».
Mais en 48, l’Avenir est revendiqué par une autre « classe ». Plus exactement, l’Avenir intervient dans le Présent sous forme d’un « projet révolutionnaire » autre que celui de 89. La Bourgeoisie, créée en tant qu’Autorité politique par le projet de 89, n’accepte pas le projet de 48 et le combat.
Elle est donc tournée à partir de cette date fatidique non seulement contre le Passé, mais encore contre l’Avenir : elle se renferme dans le Présent. C’est ainsi seulement qu’elle est réellement présente : c’est seulement après 48 qu’elle est vraiment ce qu’elle est ; elle seule, par opposition à tout ce qui n’est pas elle ; l’esprit bourgeois est né en 48.
Du même coup, par la négation de l’Avenir, se rompt tout lien avec le Passé quel qu’il soit. Le Présent étant seul réel, la Bourgeoisie se réalise en tant que telle : c’est la période de sa domination. Mais un Présent sans Avenir ni Passé n’est qu’un Présent naturel, non humain, non historique, non politique.
La domination de la Bourgeoisie n’est donc qu’une disparition progressive de la réalité politique en tant que telle, c’est-à-dire du Pouvoir ou de l’Autorité de l’État : la vie est dominée par son aspect animal, par les questions d’alimentation et de sexualité.
L’humain se maintient encore dans la mesure où il y a un reste de transcendance du Présent soit par le Passé, soit par l’Avenir ; mais le Passé et l’Avenir impliqués dans le Présent n’ont plus de valeur active, ils n’y sont plus « en acte ; c’est leur présence « virtuelle », « idéelle » ou idéale, c’est-à-dire purement « esthétique » ou « artistique ». Tradition végétant sous forme de « Romantisme » et la Révolution du futurisme » ; le Présent « classiciste », étant privé de son élément propre, qui est l’action effective, est privé de toute vie. Il n’y a donc pas de Classicisme bourgeois.
Toute Tradition proprement dite, c’est-à-dire ayant une valeur et une réalité politiques, est nécessairement orale ou spectaculaire, c’est-à-dire directe. Un écrit est, de par sa nature, détaché de son support matériel – de son auteur qui le fixe dans le temps.
Le passé présenté seulement par écrit n’est pas, pour moi mon passé, je m’en désintéresse très facilement : exposé dans un livre, le passé de mon pays ne diffère pas sensiblement du passé de la Chine, par exemple : j’ai tendance à mettre tous les écrits sur le même plan et à discuter les théories qui y sont exposées comme si elles étaient conçues en dehors du temps.
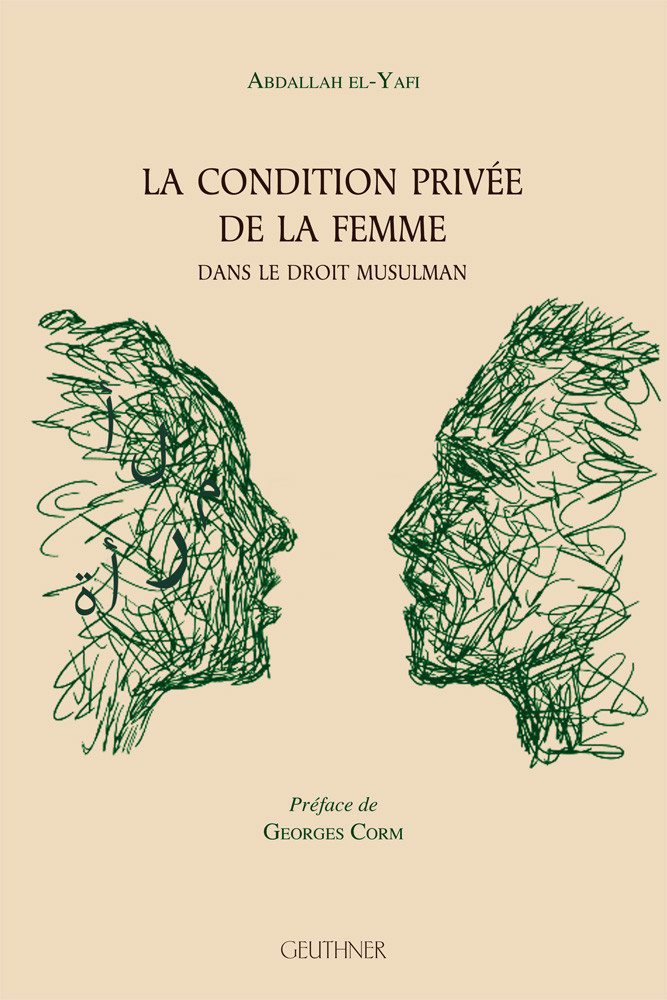
Donc, les événements de 48, en détruisant le lien politique avec le Passé, devaient toucher avant tout la tradition orale : c’est elle qui doit faire défaut dans la période de domination bourgeoise.
On peut dire aussi que l’Autorité de Père est ancrée dans le Village, tandis que la Ville a tendance à ne pas la « reconnaître », c’est-à-dire à la détruire. Le Village « vit la durée », la Ville « fait passer le temps ». Or la durée, c’est-à-dire la totalité du temps, et non seulement son « instant », implique nécessairement le Passé : c’est dans et par le Passé que l’« instant » fugitif dure et existe.
Le passage, le flux du temps, par contre, est provoqué par la pression de l’Avenir : c’est in statu nascendi que le Présent est actif », « virulent », « actuel ». La Ville a donc tendance à oublier le Passé en pensant à l’Avenir, qui « actualise » le Présent instantané, tandis que le Village vit la durée du Présent en le projetant sur le Passé (retour des saisons, etc.).
Autrement dit, c’est le Village qui a une tendance naturelle à reconnaître une Autorité de Père, tandis que la Ville reconnaît volontiers une Autorité de Chef, qui exclut l’élément « Père » et s’oppose à lui. La théorie « constitutionnelle » du Pouvoir amputé (et par suite divisé) ainsi que sa réalisation politique impliquent donc et présupposent une hégémonie de la Ville sur le Village : c’est une théorie, et une réalité, essentiellement citadines.
On peut se demander ce que devient l’Autorité politique amputée, c’est-à-dire privée de son élément « Père ». Si l’Autorité de Père est maintenue, en étant seulement projetée hors de l’Autorité politique, elle viendra se fixer dans la Famille. Cette Famille autoritaire sera par définition opposée à l’État (sans Autorité de Père). Nous retombons donc dans le cas du conflit antique (paion) entre la Famille et l’État (cf. Antigone de Sophocle) qui, étant essentiel, doit aboutir tôt ou tard à la destruction de l’un des adversaires.
Alexandre Kojève
A lire également :