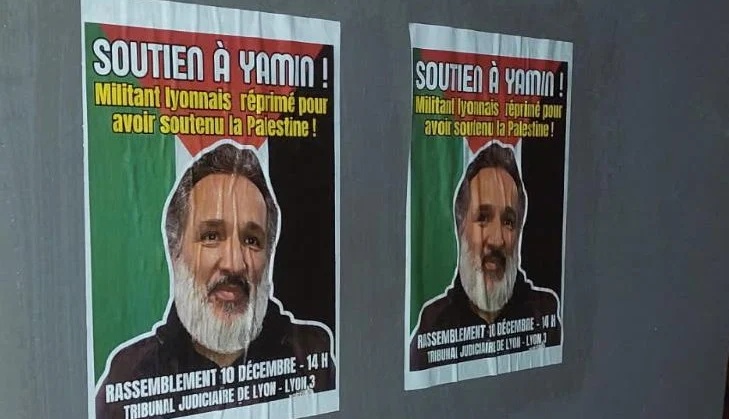Konstantina D. Oikonomou nous dévoile dans ce long passage d’un texte consacré à la notion gramscienne de l’interrègne, une présentation du fonctionnement réel des institutions internationales et la manière dont elles valident l’ordre géopolitique dominant.
La notion d’interrègne éclaire le paradoxe de l’ordre actuel. Le droit semble perdurer, mais son autorité est séparée de son application. Gramsci a identifié l’interrègne comme une période intermédiaire, marquée par des symptômes morbides révélant la fragilité de l’hégémonie. Transposée en droit international, cette condition se manifeste par la coexistence d’interdictions solennelles et de leur violation systématique.
Plus le droit international est invoqué, plus sa complicité avec les asymétries matérielles devient visible. Au cœur de ce paradoxe se trouve l’ontologie du droit. De la conception de la souveraineté de Hobbes à la théorie du commandement d’Austin , en passant par le décisionnisme exceptionnaliste de Schmitt , le droit a souvent été compris non comme un système autonome de normes, mais comme une expression de l’autorité politique.
Le droit international ne fait pas exception : son efficacité dépend moins de la normativité intrinsèque que de la capacité des institutions et des États à en assurer le respect. Lorsque cette capacité faiblit, le droit ne disparaît pas, mais révèle sa dépendance au pouvoir.
L’idée de révolution passive de Gramsci clarifie le mécanisme. Dans les moments liminaires, les transformations surviennent non pas pour transcender les relations existantes, mais pour les stabiliser sous de nouvelles formes. Le droit international ne se dissout pas face à la violation ; il se réajuste. Les violations sont absorbées par des doctrines en évolution, des notions élargies de légitime défense, des invocations élastiques de la nécessité humanitaire qui érodent le principe de non-intervention, ou la paralysie des organismes chargés de l’application qui ratifient discrètement des faits accomplis.
Ce qui apparaît comme une rupture est en réalité une réarticulation, assurant la continuité par l’adaptation. Cette compréhension résiste aux interprétations téléologiques du progrès. Le droit international n’avance pas inexorablement vers l’universalité ou l’émancipation. Il oscille entre normativité et pouvoir , entre invocation et érosion. L’interrègne n’est donc pas une rupture temporaire, mais la révélation du double caractère du droit : normatif dans le langage, politique dans l’action.
Irak 2003 : du Kosovo à la normalisation des violations
L’invasion de l’Irak en 2003 est largement reconnue comme le moment où les fondements de l’ordre juridique international d’après 1945 ont été le plus profondément ébranlés. Pourtant, la généalogie juridique de cette rupture remonte un peu plus tôt, à l’intervention de l’OTAN au Kosovo en 1999.
Menée sans l’autorisation du Conseil de sécurité, la campagne de bombardements de l’OTAN contre la République fédérale de Yougoslavie était justifiée non par sa légalité, mais par sa légitimité. L’intervention était défendue comme un impératif moral visant à prévenir une catastrophe humanitaire, même si elle manquait de fondement dans le cadre de la Charte des Nations Unies.

Les débats qui ont suivi au sein des Nations Unies et de la communauté internationale au sens large ont cristallisé la tension entre légalité et légitimité : le droit pouvait-il être écarté au nom d’objectifs politiques ou éthiques supérieurs, et une telle exception pouvait-elle coexister avec le maintien formel de l’interdiction du recours à la force prévue par la Charte ?
Le Kosovo a ainsi marqué le début d’un changement discursif et pratique. L’affirmation selon laquelle une action illégale pouvait néanmoins être légitime a déstabilisé la cohérence normative du jus ad bellum. Elle a suggéré que le droit international pouvait tolérer des violations exceptionnelles dès lors qu’elles étaient justifiées rhétoriquement par des appels à la nécessité humanitaire.
Ce précédent n’a pas démantelé l’interdiction d’emblée, mais il en a fracturé l’autorité. Il a jeté les bases d’un nouveau mode d’argumentation dans lequel la légalité pouvait être suspendue au profit de valeurs prétendument supérieures, institutionnalisant ainsi la logique même de l’exception.
Si le Kosovo a ouvert la voie à cette ambiguïté, l’Irak l’a étendue jusqu’à la transformer en rupture structurelle. L’invasion de 2003 a non seulement constitué une violation flagrante du droit international, mais a aussi démontré que l’interdiction du recours à la force pouvait être totalement écartée lorsqu’elle entrait en conflit avec des visées géopolitiques.
L’article 2(4) de la Charte des Nations Unies interdit sans équivoque la menace ou l’emploi de la force contre l’intégrité territoriale ou l’indépendance politique des États. Les deux exceptions qu’il reconnaît – la légitime défense au titre de l’article 51 et l’autorisation du Conseil de sécurité au titre du Chapitre VII – étaient manifestement absentes. Aucun mandat du Conseil de sécurité n’a été émis, et la doctrine de la légitime défense n’a été invoquée qu’avec une extension sans précédent de sa portée.
Les États-Unis et leurs partenaires de la coalition ont avancé l’argument de la légitime défense préventive et de la défense collective, affirmant que la possession présumée d’armes de destruction massive par l’Irak constituait une menace imminente. Il s’agissait pourtant d’une déformation du concept. La légitime défense, telle que codifiée dans la Charte et réaffirmée en droit international coutumier, requiert une attaque armée.
Une action préventive contre une menace hypothétique n’a aucun fondement juridique. La réinterprétation des résolutions du Conseil de sécurité de la guerre du Golfe de 1990-1991 autorisant un recours à la force renouvelée était tout aussi peu convaincante, rejetée par la majorité des États et des autorités juridiques. Il ne restait plus qu’un acte d’agression unilatéral déguisé en langage de nécessité.
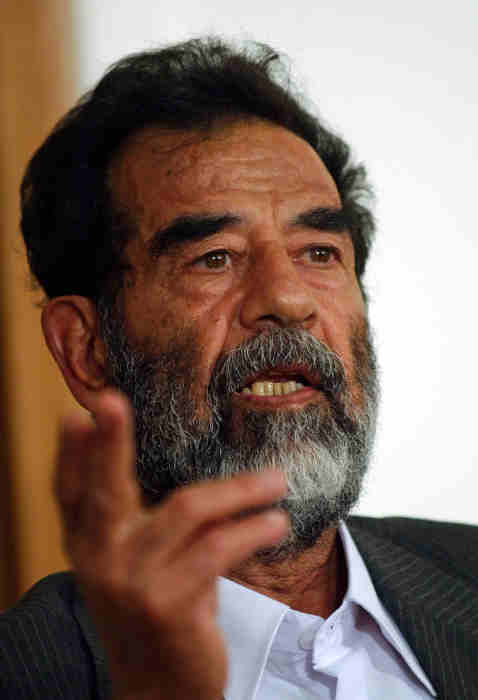
L’importance de 2003 ne réside pas seulement dans la violation elle-même, mais dans son absorption par l’ordre international. Aucune sanction significative n’a suivi. Le Conseil de sécurité a été contourné et est resté paralysé.
L’Assemblée générale a exprimé sa désapprobation, mais n’a pas eu la capacité d’y imposer une force contraignante. Il en a résulté non pas la disparition de l’interdiction du recours à la force, mais sa transformation en précédent , un cadre suffisamment souple pour accueillir des exceptions. À partir de ce moment, les notions extensives de légitime défense et de nécessité humanitaire ont circulé dans le cadre de la grammaire opérationnelle du droit.
En ce sens, l’Irak n’a pas marqué la fin du droit international, mais sa transformation . Il a révélé que le système pouvait survivre même à sa violation la plus flagrante en reconstituant la violation dans sa grammaire opérationnelle.
Si le Kosovo avait mis en évidence la tension entre légalité et légitimité, l’Irak a démontré que la ligne pouvait être entièrement franchie, en considérant l’agression comme une défense et l’illégalité comme une nécessité. Telle est l’essence de l’interrègne : le droit ne s’effondre pas, il se recalibre, préservant sa forme tout en vidant sa substance.
La campagne qui a suivi contre l’EI en Syrie a confirmé ce changement. À partir de 2014, la coalition menée par les États-Unis a lancé des frappes aériennes massives sans le consentement du gouvernement syrien et sans autorisation explicite du Conseil de sécurité.
Pour justifier cette atteinte à la souveraineté, les membres de la coalition ont invoqué la doctrine ambiguë du « manque de volonté ou de capacité », présentant leurs actions comme une légitime défense collective de l’Irak et comme un élément de la guerre mondiale contre le terrorisme. Ce que l’Irak avait démontré comme une normalisation des violations s’est transformé en Syrie en une doctrine de pratique, où des mesures exceptionnelles ont été routinisées et ancrées dans les structures de l’ordre international.
(…)
Gaza : légitime défense et érosion des normes humanitaires
À Gaza, l’interrègne se manifeste avec une clarté particulière dans le discours sur la légitime défense. Israël a toujours affirmé agir dans les limites de la légitime défense , présentant les opérations militaires de grande envergure comme des réponses légitimes aux attaques armées. Suite à l’attaque terroriste du Hamas d’octobre 2023, Israël a de nouveau invoqué l’article 51 de la Charte des Nations Unies.
L’applicabilité de cette disposition aux attaques armées menées par des acteurs non étatiques dans des conditions d’occupation reste l’objet d’une intense controverse juridique . Sans résoudre ce débat, il est clair que les opérations militaires ultérieures d’Israël constituent un élargissement considérable du droit qu’il revendique. La Charte envisage la légitime défense comme un droit temporaire et exceptionnel, exercé « jusqu’à ce que le Conseil de sécurité ait pris les mesures nécessaires au maintien de la paix et de la sécurité internationales ».
Dans la pratique, cependant, Israël a constamment invoqué ce droit pour justifier des politiques de sécurité et des opérations militaires de longue durée, le considérant moins comme une garantie provisoire que comme une justification permanente du recours à la force. Il n’a jamais été question de légitimer des occupations prolongées ou des campagnes systématiques contre les populations civiles. En présentant des décennies d’occupation et des offensives militaires récurrentes comme des exercices de légitime défense, Israël transforme une exception étroitement délimitée en un permis généralisé d’usage de la force.
Ce recours massif à la légitime défense s’inspire du précédent de 2003, lorsque la doctrine a été étendue au-delà des limites fixées par la Charte et, en l’absence de riposte institutionnelle efficace, cette distorsion s’est ancrée dans la pratique. Ce qui était autrefois exceptionnel est devenu paradigmatique. Le discours qui a permis à l’Irak de se défendre a migré vers d’autres contextes, offrant un langage permettant aux États de normaliser le recours à la force tout en préservant l’apparence d’une loyauté juridique.
Cette trajectoire est également révélée par l’attaque israélienne de juin 2025 contre l’Iran. Dans ce cas, la force a été employée en l’absence d’attaque armée en cours et sans l’immédiateté requise par l’article 51. Pour étayer sa justification, Israël s’est appuyé sur des arguments confondant jus ad bellum et jus in bello, confondant les prétentions de défense anticipée avec les affirmations de proportionnalité et de nécessité militaire.

Ce qui a commencé comme une prétention exceptionnelle en 2003 s’est transformé en un modèle récurrent, permettant aux États de subordonner presque tout recours à la force au langage juridique de la défense.
Une fois le recours à la force normalisé sous cette rubrique élargie, l’attention se porte sur la sphère humanitaire. Là encore, l’érosion des normes est évidente. Les principes fondamentaux du droit international humanitaire – distinction entre combattants et civils, proportionnalité dans l’usage de la force et interdiction de la famine et des châtiments collectifs – ont été systématiquement mis à mal. À Gaza, les infrastructures civiles ont été détruites à grande échelle, la famine a été utilisée comme méthode de guerre et des populations entières ont été déplacées et assiégées . Chacune de ces pratiques, si elle est avérée, constitue une grave violation des Conventions de Genève et du Protocole additionnel I.
Mais ce qui est le plus frappant, ce n’est pas seulement la survenance de ces actes, mais leur justification par le langage juridique. Les principes de proportionnalité et de nécessité sont invoqués non pas pour restreindre la violence, mais pour la rationaliser. Les normes mêmes conçues pour protéger les civils deviennent des mécanismes permettant de calibrer les niveaux de dommages acceptables. Le droit international humanitaire, en ce sens, ne s’effondre pas ; il s’adapte. Il permet de rendre intelligible la violence extrême, à condition qu’elle puisse être formulée dans la sémantique de la proportionnalité ou de la nécessité militaire.
L’impasse du Conseil de sécurité, aggravée par les réponses fragmentées et largement symboliques d’autres organismes internationaux, renforce cette situation. Même lorsque des déclarations faisant autorité sont émises – comme l’avis consultatif de la Cour internationale de Justice sur les territoires palestiniens occupés, qui a souligné les obligations contraignantes d’Israël, puissance occupante, et des États et organisations tiers concernant l’illégalité de l’occupation – elles sont de fait ignorées .
Cette inaction n’est pas simplement le symptôme d’une impasse géopolitique, mais démontre la capacité structurelle de l’ordre international à tolérer des violations persistantes. Ainsi, Gaza illustre comment les doctrines et les normes se muent en instruments de légitimation. La doctrine de la légitime défense, étendue au-delà de ses limites prévues en Irak, refait surface comme une justification permanente de l’occupation et de la violence à grande échelle.
Les normes humanitaires, vidées de leur substance par une application sélective, deviennent des outils de calibrage plutôt que de protection. Le droit persiste, mais seulement comme un langage rendant la violence acceptable.
De l’effondrement à l’exposition
Le récit conventionnel de l’effondrement suppose que l’ordre international, autrefois cohérent et contraignant, se désintègre aujourd’hui sous la pression géopolitique. Pourtant, la trajectoire qui débute avec le Kosovo en 1999, passe par le 11 septembre et l’Irak en 2003, puis s’étend à Gaza et à l’Ukraine, et révèle non pas une dissolution, mais une transformation. Il ne s’agit pas seulement de violations.
Ce sont des moments où les violations ont été reformulées comme des précédents, fournissant de nouveaux fondements de légitimité qui ont progressivement remodelé la grammaire du droit et de l’ordre internationaux. Ce qui a suivi n’a pas été la disparition de la légalité, mais sa reconstitution adaptative. Chaque dérogation aux règles , que ce soit au nom de la nécessité humanitaire, de la légitime défense préventive, de la lutte contre le terrorisme ou de la survie existentielle, a produit un vocabulaire justificatif qui a circulé dans les tribunaux et le discours institutionnel.
Ce vocabulaire n’est pas resté rhétorique. Il s’est infiltré dans le raisonnement juridique et a recalibré des concepts autrefois considérés comme sacrosaints. L’interdiction du recours à la force, la distinction entre combattants et civils, le principe d’intégrité territoriale, tout cela a été redéfini non pas par un amendement formel, mais par la pratique de la violation tolérée.
La conséquence est claire. L’érosion des interdictions les plus fondamentales a abouti à la normalisation de l’agression elle-même. Ce que Nuremberg définissait comme le crime international suprême et ce que la Charte des Nations Unies consacrait comme l’interdiction impérative du recours à la force est aujourd’hui de plus en plus redéfini comme la légitime défense, l’action préventive ou la sécurité collective.

L’accumulation de précédents a généré un environnement permissif, où les futurs recours à la force sont anticipés et rationalisés plutôt que limités. De fait, un manuel juridique de l’agression a émergé, permettant de présenter les violations comme une continuité plutôt qu’une rupture. L’interrègne n’est pas un vide ; c’est une condition génératrice dans laquelle le droit persiste précisément en absorbant ses propres transgressions, les transformant en matière première de son évolution.
Cette dynamique a une résonance benjaminienne : le droit, en tant que « technologie de la violence », se préserve non pas en interdisant la force, mais en la gérant, la requalifiant et la redéployant. Ce qui apparaît comme une violation est le mécanisme même par lequel l’ordre international se reproduit.
Cet état liminal expose un système longtemps privé de véritable consensus, désormais mis à nu par l’absence d’une grande puissance ordonnatrice unique, étiré au-delà de ses téléologies libérales d’universalité et de « fin de l’histoire », une arrogance démasquée par ses propres contradictions. Il s’agit d’un espace contesté où se déploient des trajectoires concurrentes, qu’il s’agisse de maintenir l’ordre tel qu’il est, de préserver des éléments de l’ordre existant, de le réformer progressivement ou de poursuivre une reconstitution plus radicale.
Le défi n’est donc pas de déplorer l’érosion d’un âge d’or mythique des règles, mais de confronter les enjeux politiques de cette transformation. Si l’agression est devenue banale, c’est parce que l’ordre s’est adapté pour s’y adapter. Reconnaître cette condition ne revient pas à accepter la paralysie, mais à insister sur le fait que la résistance et des avenirs alternatifs doivent être imaginés dans l’espace même où la loi et l’ordre révèlent leurs limites, car l’interrègne est moins une exception que la condition génétique de l’ordre international lui-même.
Il ne s’agit pas d’abandonner l’héritage juridique et politique de Nuremberg, de la Convention sur le génocide ou des Nations Unies, mais de le réarticuler à travers une conception plus juste et pluraliste de l’ordre. Perpétuer la situation actuelle risque de conduire irréversiblement à un ordre plus régressif.
Konstantina D. Oikonomou
Konstantina D. Oikonomou est maître de conférences et chercheuse en relations internationales et droit international au Département de science politique et de relations internationales de l’Université du Péloponnèse, en Grèce. Ses recherches portent sur les liens entre relations internationales et droit international.