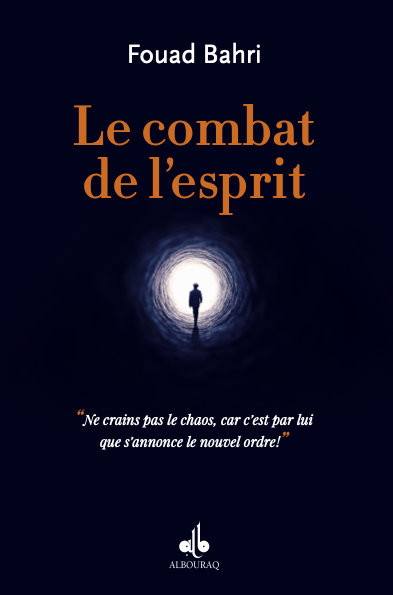Qu’est-ce que le moralisme et de quoi, au juste, est-il le symptôme ? Une chronique écrite au scalpel, signée Fouad Bahri, à lire sur Mizane.info.
Le moralisme est la tentation de substituer à l’efficience pratique de l’acte moral, l’inflation de sa représentation par la médiation du langage. Le moralisme vide ainsi la morale de son contenu et plombe sa signification. Il s’efforce toujours d’en épuiser les ressources, d’en liquider la valeur et met un point d’honneur à en déplacer le centre de gravité là où prolifère les appels d’air, au bord de l’abime.
Le terrain de chasse de la morale se trouve presque toujours dans l’acte pur. Lorsque le discours s’empare de la morale, il tend à en dévoyer la forme, à en accentuer les traits, au risque de la difformité.
L’acte moral est à la fois plus radical et plus modeste que toutes les envolées lyriques et judiciaires de tous ces procureurs auto-proclamés gardiens solennels de la conscience universelle, dont les jugements assénés depuis les hauteurs inclinées d’une tour de Pise, surplombante mais chancelante, et aussi éloignée de nous que possible, nous fracturent le crâne sans la moindre once de compassion. Leur discours est lourd comme une pierre, mais leur parole creuse sonne faux.
C’est un fait que le discours ne peut jamais compenser le défaut d’action, sauf quand la parole a exceptionnellement valeur d’acte, quand le dire sobre et solennel possède les vertus singulières d’un faire opérationnel. L’acte moral, une fois accompli, remplit la conscience et l’émancipe de toute velléité discursive, en l’affranchissant de tout propos futile. La morale est acte ou n’est pas.
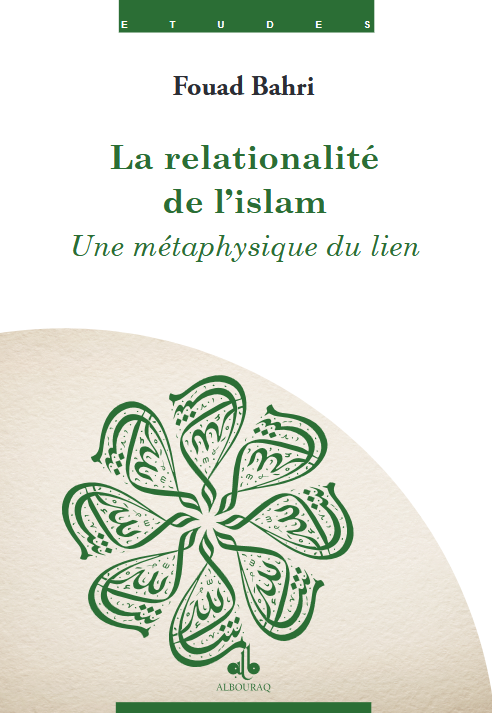
« Ô vous qui avez cru ! Pourquoi dites-vous ce que vous ne faites pas ? » (Coran, 61, 2). Vous n’avez pas à dire ce que vous faîtes, vous devez faire ce que vous dites ou mieux, vous devez faire et ne rien dire. Nos actes parlent pour nous ou contre nous mais leur langage est toujours authentique. Nos paroles seules, privées d’effet, vide de toute réalité, mettent à nu notre vanité, notre tendance néantisée, quand le silence enraciné, par la beauté de sa puissance, envahit le monde de sa présence et se fait volontiers miroir de Dieu.
La parole n’est jamais plus légitime que lorsqu’elle soigne les blessures et oriente le regard dans la bonne direction. Sois des nôtres, aime-nous et tu auras gagné le droit de nous dire quoi faire et comment y parvenir. Alors ta parole, aussi brève que l’éclair, visera juste et illuminera notre route, parce que tu chemineras à nos côtés.
Brève car en débordant de son lit, la parole morale inonde et tue les cultures saines du labeur exigent, de l’effort quotidien et anonyme qui ignore les mises en scène. Par cet écart, ce déferlement sauvage dans la steppe mondaine, le langage creuse un fossé inévitable entre l’être et le paraître. Le bavardage vide le cœur plus vite que la fournaise assèche un lac.
La fausse bonne conscience, cette bonne conscience acquise à moindre frais, alimente par ses excès une niche morale inépuisable, rente confortable pour épargnant bavard mais sans scrupules. Il est plus que certain que de cette denrée rare (le scrupule), il faut savoir se montrer avare. Le procureur n’est jamais rien d’autre qu’un substitut. En bon ventriloque d’un Surmoi inquisitorial, sa générosité sans bornes lui inspire de réparer les désordres du monde et d’assumer ses responsabilités par la faveur du Verbe.
Au demeurant l’éloquence fera effet, et tâchera d’en imposer au non initié, en commençant par surenchérir sur la vénérable « centralité axiale » ou par déclamer sur un ton affecté la « sacralité » intemporelle du Bien, à moins qu’elle nous fredonne ce sempiternel refrain du devoir de « témoigner en faveur de la justice ». Ainsi soit-il.

Pourtant, quand les foudres s’abattent sur la cité, que le châtiment tombe et que la barbarie se lève, tu verras les donneurs de leçon prendre la tangente en catimini et sur le mode « tout le monde aux abris », « sauve qui peut » ou « Dieu reconnaîtra les siens » ! Et oui, le fonctionnaire a aussi le droit de déposer ses CP. On appelle ça, l’éthique de la bonne conduite en temps de crise. Repli stratégique, fuite ontologique.
Le moralisme, saches-le, est toujours présent, trop près pour être aperçu, dissimulé dans les recoins de notre âme, telle une ombre sans forme aspirant à être sans exister. Un cheikh sans provision.
Gesticulation bien inutile. Sans savoir être, comment espérer enseigner aux autres ce qu’ils devraient faire, ce qu’il se doivent de faire dans l’instant ? Soustraire à nos regards et aux leurs la fragilité vacillante de leur être par la vacuité bruyante d’un discours sans substance se révèle désormais la seule option pour ces prestidigitateurs nantis de talents mais dénués de convictions.
L’action, toujours, nourrit l’être et en témoigne. La seule morale que nous acceptons est celle qui émane de soi et abreuve les racines de notre monde. L’intention sincère en est le point le départ, la quête de Dieu l’objectif, la réalisation son obsession.
La parole éthique n’est donc jamais rien d’autre que le reflet fidèle de l’acte pur, et ce dernier pas autre chose que le fruit tombé d’un arbre de vie et de savoir dont les racines, longues et robustes, s’enfoncent profondément au fond de la forteresse humide et intime de nos cœurs, continents cachés aux rivages baignés et vivifiés par ces effluves célestes que l’on appelle aussi l’amour de Dieu.
Fouad Bahri
A lire du même auteur :