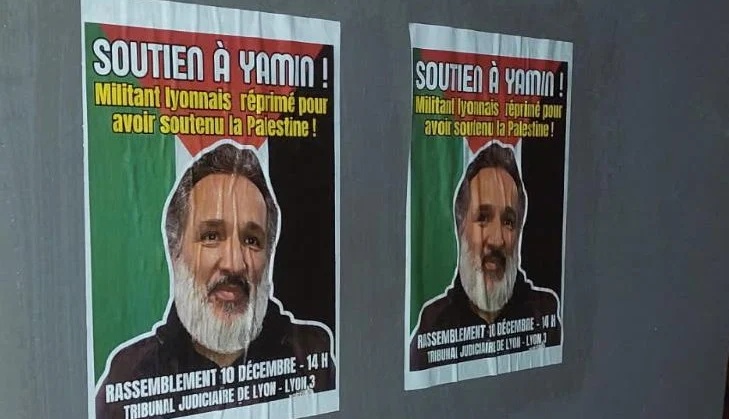Dans sa dernière chronique publiée sur Mizane.info, l’intellectuelle Faouzia Zebdi-Ghorab, auteure de nombreux essais, aborde la question des cimetières musulmans et du droit à la dignité de mourir dans son pays.
Cimetières musulmans en France : le dernier tabou républicain
Cinq ans après l’électrochoc de la crise sanitaire, (Notre article de mai 2020), le constat est accablant : les promesses d’aménagement ont accouché de quelques mètres carrés en plus et d’une communication autosatisfaite.
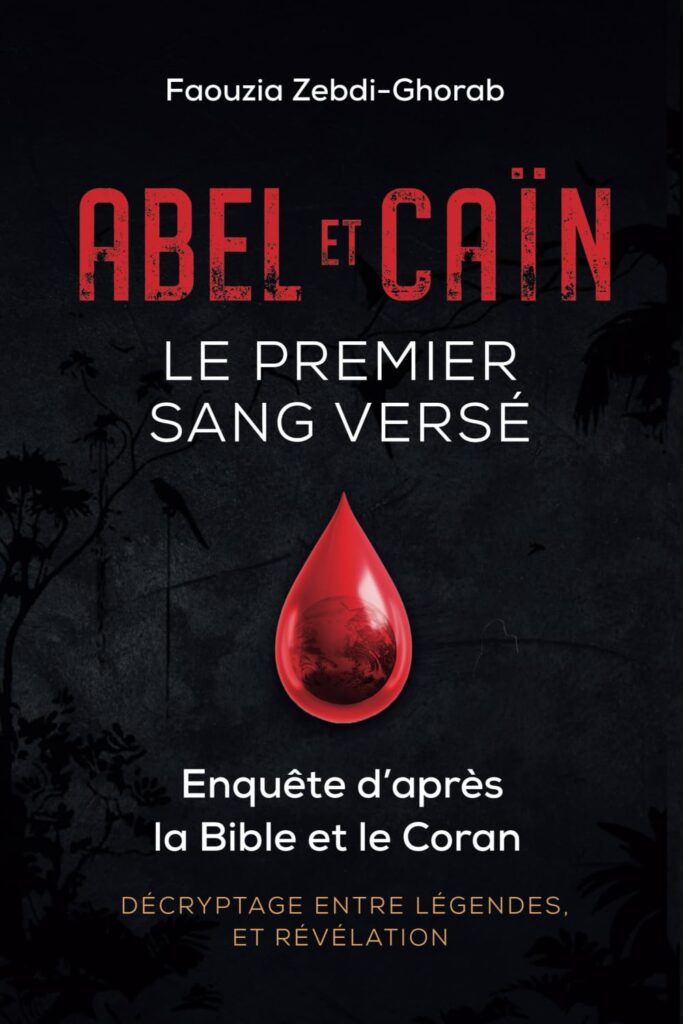
La réalité, elle, est toujours aussi brutale : attendre des semaines pour une place, voir son parent enterré à des kilomètres, ou devoir le renvoyer dans un pays que lui-même ne reconnaissait plus comme le sien. Un exil posthume, voilà ce que la République propose à des citoyens à qui elle a refusé, de leur vivant, l’ancrage total. Le symbole est aussi violent que silencieux.
Une expansion lente et inégale
On dira que des efforts sont faits. Certes. Des extensions ici, des projets là. Mais tout cela demeure périphérique, à la marge, et surtout soumis aux aléas politiques locaux. L’État, lui, reste enfermé dans une lecture rigide, presque fétichiste, de la laïcité : la loi de 1881, qui interdit toujours les cimetières confessionnels.
Une loi sacralisée au nom d’un principe abstrait, alors même qu’elle produit des absurdités concrètes. Comme si reconnaître les spécificités spirituelles d’un mort menaçait l’ordre républicain.
La loi de 1881 et l’impasse des cimetières musulmans en France
Depuis la crise sanitaire, les pouvoirs publics ont timidement pris en compte la situation. En 2023, un amendement à la loi sur l’organisation funéraire a facilité l’extension des carrés confessionnels dans certaines zones urbaines. Mais à condition qu’aucune opposition locale ne s’exprime.
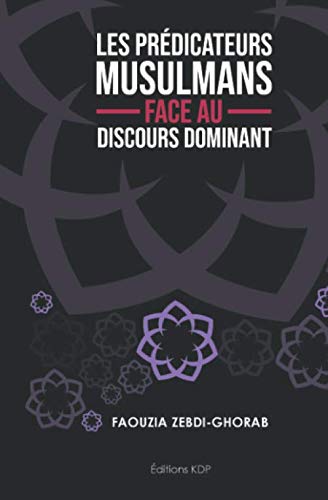
Toutefois, la loi de 1881 interdisant la séparation confessionnelle dans les cimetières reste en vigueur. La création de nouveaux cimetières musulmans demeure donc impossible, sauf dans des contextes très particuliers comme en Alsace-Moselle où le droit local prévaut.
Le prix de l’ancrage : des concessions inaccessibles pour des citoyens invisibles
Face à la lenteur administrative et aux blocages juridiques, certains acteurs privés tentent d’apporter des solutions. Des entreprises de pompes funèbres proposent aux familles d’acheter des concessions longue durée dans des carrés existants, mais les coûts prohibitifs limitent cette option.
D’autres réflexions portent sur la possibilité d’inhumations en pleine terre dans certaines régions rurales où l’espace n’est pas un problème, mais cela impose aux familles de faire plusieurs dizaines, voire centaines de kilomètres pour visiter leurs proches disparus.
Une administration kafkaïenne
Les jeunes générations veulent être enterrées ici, parce qu’elles sont d’ici. Mais elles se heurtent à une administration kafkaïenne, à des lenteurs coupables, à une hostilité parfois à peine voilée. Derrière cela, une société qui n’a pas encore fait le deuil de son imaginaire de l’assimilation totale. Une société qui veut bien des citoyens croyants tant qu’ils se taisent sur leur spiritualité.
La neutralité ou l’obsession de l’effacement identitaire
Le droit à une sépulture conforme à ses croyances n’est pas une faveur : c’est une exigence minimale de dignité. Il ne s’agit pas d’islamiser les cimetières, mais de cesser de vouloir neutraliser la mort comme on veut neutraliser les identités. La neutralité n’est pas l’indifférence. Elle ne consiste pas à nier les différences, mais à les organiser avec égalité au moins devant la mort!
Une revendication simplement humaine
Pour ceux qui croient encore en l’action politique et qui sollicitent les élus pour diverses causes, il est crucial d’inscrire la question des cimetières musulmans en France dans les doléances à venir. Souvent, les attentes se concentrent à juste titre, sur des améliorations visibles du quotidien. Mais la mort fait aussi partie de la vie et constitue donc un dossier à part entière.
Entre racines profondes et attachements récents
Beaucoup, en lisant ces lignes, considéreront peut-être ce sujet comme secondaire, voire accessoire. Il ne s’agit pas de les blâmer, mais de les inviter à reconnaître que cette question peut revêtir une importance profonde pour de nombreux musulmans vivant en France. Cette divergence de perception s’explique en grande partie par un décalage d’expérience.
D’un côté, il y a ceux issus de parcours migratoires récents, dont sont souvent issus les responsables d’instances musulmanes, les prédicateurs, ou les cadres des mosquées. Pour eux, le lien à la terre française peut rester partiel, marqué par un attachement encore fort au pays d’origine, rendant la perspective d’une inhumation à l’étranger plus acceptable, voire naturelle.
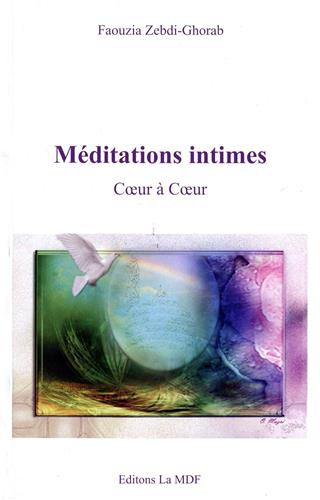
De l’autre côté, il y a celles et ceux, de plus en plus nombreux, qui sont nés, de parents nés ici, ont grandi, et ont construit toute leur vie ici. Qu’ils soient d’ascendance afro-maghrébine installée depuis plusieurs générations ou convertis d’origine française, tous partagent un rapport intime, parfois conflictuel, mais profondément enraciné avec la France.
Pour les uns, l’idée d’être enterré ailleurs n’est administrativement pas possible et pour les autres, elle peut représenter une forme de déracinement posthume, une violence symbolique difficile à nommer. Il est essentiel de comprendre cette diversité de trajectoires et de sensibilités pour appréhender pleinement l’enjeu humain et spirituel que représente la question de l’inhumation en France.
Ce que révèle le refus d’une terre
Ne pas entendre cette réalité, c’est risquer de la voir se transformer en fracture. Un problème ignoré ne disparaît pas : il s’aggrave. En attendant, l’inquiétude demeure. Combien de temps faudra-t-il encore pour que chaque citoyen de confession musulmane puisse reposer en paix, sur la terre où il est né et a vécu toute sa vie ?
Combien de générations faudra-t-il enterrer à contre-cœur, avant qu’on comprenne enfin que le droit à la terre, même posthume, est le socle de toute humanité — car seule l’humanité se donne des rites pour honorer ses morts.
Quel message supplémentaire ce manquement traduirait-il ? Sinon celui d’une appartenance encore conditionnelle, toujours à reconfirmer, même après la mort. Refuser à certains le droit d’être inhumés là où ils ont vécu, aimé, contribué, c’est prolonger dans la tombe ce doute insidieux sur leur légitimité à être d’ici.